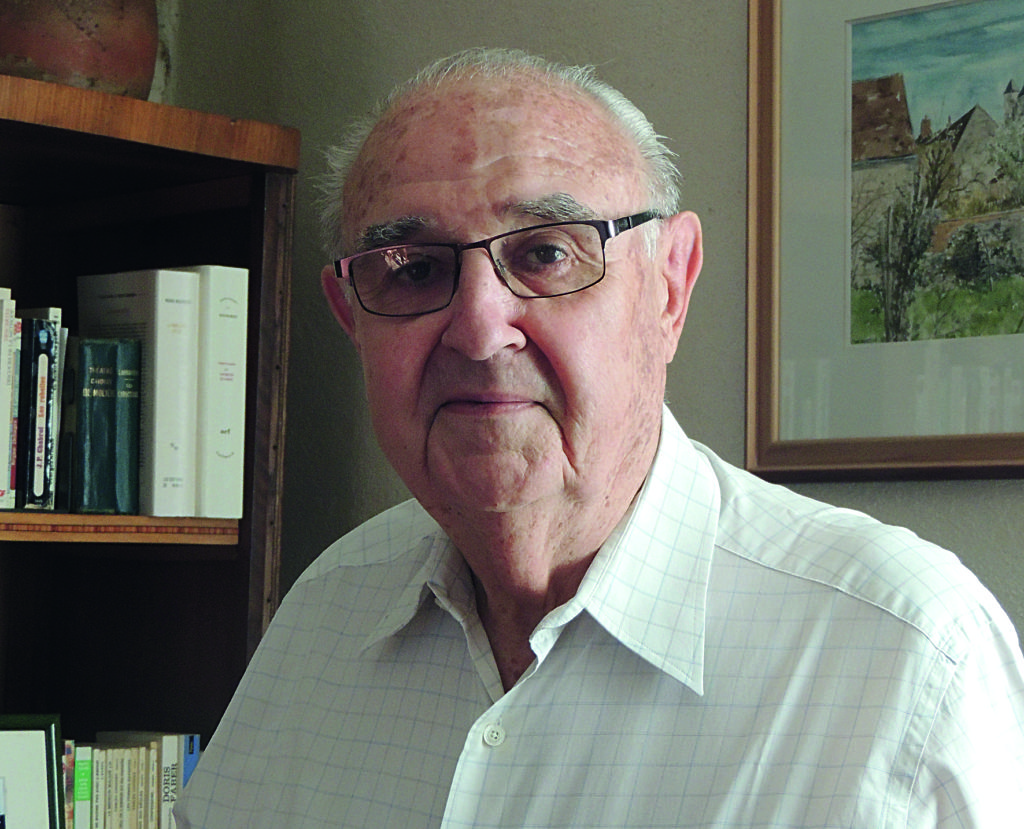
Par Jacques Chauvineau, président d’Objectif OFP
Plus personne – ou presque – ne nie la réalité du changement climatique. Sa montée en puissance menace l’humanité d’un chaos planétaire, écologique et politique. La France, engagée par la COP21 et par l’accord de Paris, doit a minima respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Cet objectif doit s’insérer dans une action de fond pour une économie plus écologique, plus compétitive, porteuse de comportements nouveaux, renforçant l’attractivité des métropoles, des territoires, des ports.
La démission de Nicolas Hulot renforce cette exigence.
Les transports sont au centre de cet enjeu. Il faut en maîtriser la croissance, privilégier les modes les moins impactants. Sans report modal, quels que soient les progrès de la route, nous allons à une congestion routière endémique pénalisant la qualité de vie, la compétitivité, alimentant le réchauffement.
Le rail, par son efficacité énergétique et écologique, par son aptitude au transport de masse, doit s’emparer de ces enjeux. Il y faut une volonté politique. Mais il faut aussi, adossé à son nouveau pluralisme, qu’il propose à la nation un aggiornamento stratégique.
La révolution numérique, le suivi de la position et de la vitesse des trains, l’automatisation de la conduite, l’attelage virtuel de trains, une maintenance prédictive, la numérisation du fret… ouvrent des modalités d’exploitation novatrices. Elles recèlent des réserves de capacité, de flexibilité, d’accessibilité des sillons fret, de gestion de la complexité nouvelle née de la concurrence, et bien d’autres progrès associant maîtrise du climat et compétitivité.
Associer la qualité du temps du voyage et un maillage territorial dense, ferroviaire et intermodal
Au fil des ans l’offre aux voyageurs s’est polarisée sur les marchés des liaisons TGV en concurrence avec l’avion avec aller-retour dans la journée, et de la mobilité quotidienne, TER et Transilien. Ces services n’utilisent qu’une fraction du réseau. Ils traitent peu le marché mal connu et sous-estimé, de la mobilité occasionnelle pour motif personnel, de loisir ou familial, moins contrainte par le temps, longtemps porteuse du lien des Français avec le train.
Il faut renouer avec l’écoute des besoins de ce marché, tisser une offre, y compris transfrontalière, conçue au contact des territoires et de responsables de ligne, comportant des correspondances sécurisées, des connexions intermodales (autocar, pistes cyclables, randonnées, trains touristiques…). Le train a besoin de créativité : Intercités vitrines des régions, conçus avec des professionnels du tourisme et du design, valorisant le confort, la qualité du temps à bord, l’accueil de l’enfant, cet oublié du train ? Trains-hôtels de nuit ? Découverte de l’Europe, ciblée vers les jeunes, associée à un réseau d’hébergements ? Développement des chemins de fer touristiques, mariage du rail et des terroirs ?
Réhabiliter le fret ferroviaire au service d’une nouvelle logistique
La France, avec ses façades maritimes, le lien transmanche, connectée à sept pays, liée, via certains d’entre eux, au Maghreb et au continent africain, occupe une position logistique privilégiée. Elle doit valoriser cet atout économique, s’engager dans l’Europe des corridors ferroviaires fret européens, prolongés par des corridors nationaux, contribuer à maîtriser la dérive vers le tout routier, attirer de nouvelles activités.
Encore faut-il connecter ces corridors aux ports, aux territoires, aux métropoles. Nos ports, comparés à ceux d’Europe du Nord, ont un retard ferroviaire abyssal. Maîtrisant désormais leurs installations ferroviaires, ils doivent, avec l’aide de SNCF Réseau, reconfigurer leur hinterland ferroviaire, l’élargir à l’Europe, mobiliser des sillons.
L‘importance de la séquence territoriale ferroviaire est, de longue date, étonnamment sous-estimée en France. C’est pourtant là que se joue une nouvelle logistique de proximité au contact des chargeurs, clé d’une relance du « wagon isolé » (10 % du fret ferroviaire en France, 45 % en Allemagne), du développement du combiné diffus par l’ouverture d’ITE à d’autres chargeurs. C’est là que se joue l’engagement des métropoles pour une logistique urbaine réduisant la pollution, dans laquelle le mode ferroviaire doit s’impliquer. Ce sont ces champs qu’explorent, sans aucune aide, impactés par les grèves, les OFP, PME/TPE à l’origine de 10 % du trafic fret.
N’attendons pas que la Chine vienne réveiller le rail français. Sortons de la théorie qui a fait des ravages, du déclin inéluctable du fret ferroviaire en France et de l’utopie d’un mode routier à vocation universelle.
Régions et décentralisation du rail : vers des liens nouveaux avec les territoires et les métropoles
L’inquiétude grandit sur l’avenir des territoires et des villes moyennes, composante forte de notre identité nationale, et de leur coexistence avec les métropoles. En charge des TER, du développement économique, de la formation professionnelle, les régions doivent pouvoir s’approprier et valoriser leur potentiel ferroviaire territorial, voyageurs et fret. L’insertion des régions dans l’espace ferroviaire européen est un enjeu national.
SNCF Réseau a besoin d’une organisation décentralisée forte, partenaire des régions des métropoles et des territoires, dotée de marges de manœuvre. Il faudra une impulsion politique car la culture ferroviaire centralisée se méfie de la diversité territoriale. Des « clusters » portuaires et territoriaux peuvent aider à ouvrir ces chemins nouveaux.
Dans cet esprit, il faut, avec les régions, franchir le Rubicon d’une vision prospective et d’un choc d’innovation pour les lignes capillaires, sortir de l’alternative fermeture ou immobilisme.
Engager et gagner la bataille de la productivité
Le rail français, comparé à l’Allemagne, affiche un surcoût de production pouvant aller jusqu’à 30 %, lié à une « inflation ferroviaire » supérieure à l’inflation générale. Il faut éliminer cette inflation ferroviaire. Il y va de la crédibilité du rail, de son retour à un endettement maîtrisé. Il y va de sa compétitivité et de l’éthique du service public dont le coût est supporté par les contribuables.
Les causes profondes de ce déficit de productivité sont à élucider. Outre la densification de l’utilisation du capital lourd, infrastructures et matériel roulant, la baisse massive des charges de structure est un enjeu majeur. Une part des gains pourrait être redéployée vers des organisations locales et des emplois de terrain créateurs de valeur, au contact des territoires et des clients, en capacité d’intervention en cas d’incident. La reconquête de la productivité doit faire l’objet d’un débat de fond avec les partenaires sociaux.
Cet enjeu crucial n’ôte rien à l’obligation pour la puissance publique de prendre des mesures stimulant le report modal vers les modes moins polluants.
Un réseau public, moderne, connecté à l’Europe, aux ports, aux territoires
La chute du fret, la stagnation des Intercités, le mauvais état des infrastructures ont conduit à la sous-utilisation du réseau. La viabilité du réseau exige de le « nourrir », d’en densifier l’utilisation par des services créateurs de valeur. Cette idée simple et forte est en rupture avec l’idée passive, technocratique, revenue en force, du retour à l’équilibre par la fermeture de lignes ou l’abandon des activités non rentables. C’est l’erreur du plan fret de 2003 qui a fait chuter le trafic de 40 %, sans résorber le déficit, faisant de la France une exception européenne.
Un réseau n’est pas la juxtaposition de lignes indépendantes. C’est aussi un système d’interactions et de péréquations entre ses lignes. 25 % du trafic fret utilise des lignes capillaires. Sans correspondances fiables l’offre aux voyageurs se « rétrécit ». Le rail a besoin d’offres diversifiées, de nouveaux services, de créativité. Il a besoin des activités voyageurs et fret… SNCF Réseau est légitime à explorer et susciter des utilisations et des utilisateurs nouveaux du réseau public, pourvoyeurs de compétences et d’idées nouvelles.
Il faut à la fois moderniser le réseau, le projeter dans l’Europe ferroviaire, repenser son ancrage local. La vision radiale du réseau doit s’élargir. Les métropoles, les territoires, les ports en ont besoin : cela passe par un maillage territorial intermodal, élargi au transfrontalier pour les voyageurs et, pour le fret, par la conquête d’un réseau maillé par les ports, les points frontière, les concentrations industrielles, les métropoles, le réseau des territoires et de leurs activités agricoles ou PME.
L’humanité va devoir aller vers un nouveau développement maîtrisant le climat et les enjeux territoriaux. Les transports ont un rôle déterminant à jouer, à toutes les échelles, du local au planétaire. La France, face à ce défi, s’est mise dans une posture politique forte. Le mode ferroviaire et ses industries doivent se repenser et se mobiliser en conséquence, concevoir une croissance créative offrant aux jeunes générations de cheminots un projet à hauteur des valeurs techniques et humanistes qui ont marqué l’histoire du rail.
Jacques Chauvineau a été responsable de la recherche commerciale créée en 1969 qui a introduit les sciences humaines à la SNCF et lancé l’idée de Corail. Membre du cabinet de Charles Fiterman lorsqu’il était ministre des Transports, il a également été directeur de l’Action Régionale qui a permis la naissance du TER avec les régions. Il a été représentant de la SNCF au CESE et administrateur de RFF.
Il est aujourd’hui président d’Objectif OFP dans la continuité d’une mission « Fret ferroviaire et développement territorial » qui lui avait été confiée en 2004 par Gilles de Robien, alors ministre des Transports.









