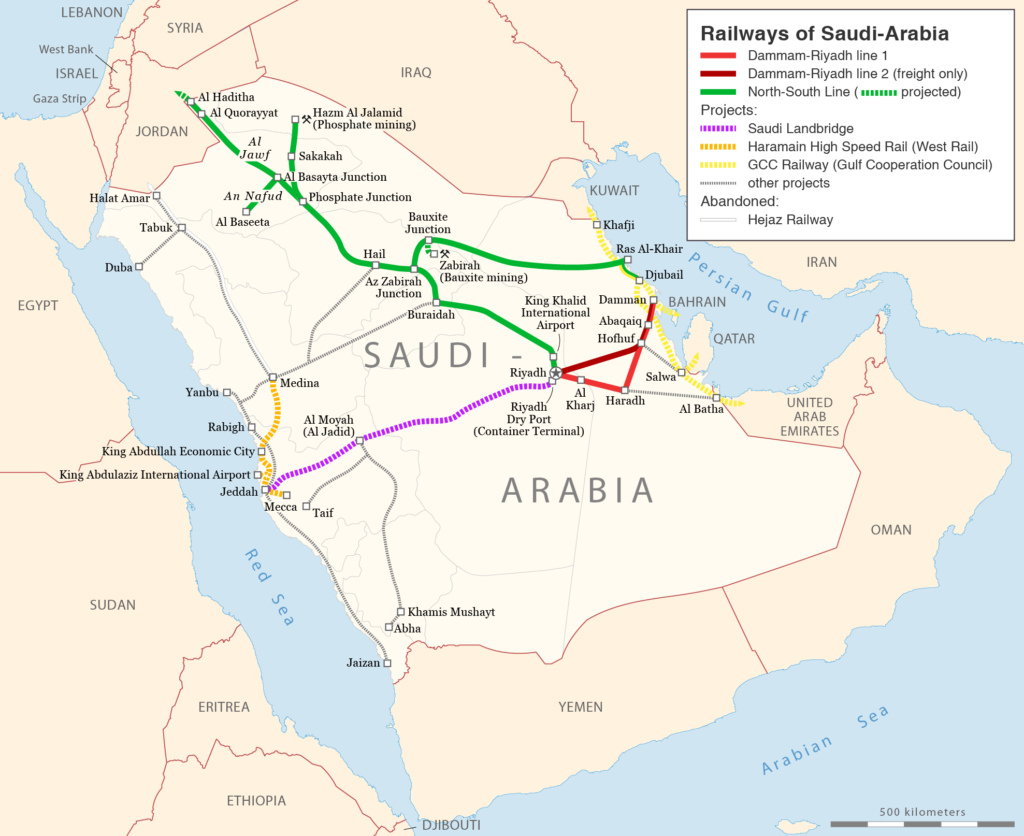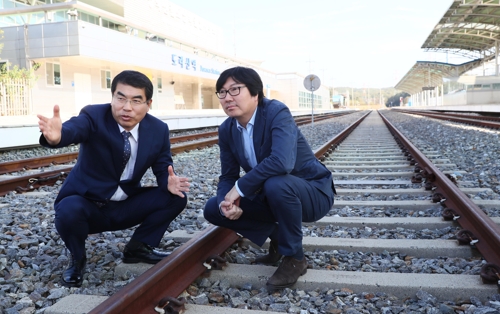La sûreté est l’une des priorités des transporteurs. Avec la montée de la menace terroriste, comment les transports s’adaptent-ils à ce nouveau risque ? Comment concilier au mieux sûreté et mobilité ? VR&T Evénements a posé ces questions aux directeurs sécurité de la SNCF, de la RATP, d’Aéroport de Paris et au directeur général d’Itirémia.
« Pour faire face aux enjeux de sécurité et de sûreté, la SNCF emploie 3 000 personnes formées, assermentées et armées », explique Céline Sibert, la directrice de la Sûreté. La SNCF a aussi installé des caméras et utilise des drones. « Nous réalisons 12 millions de voyages par jour dans des espaces ouverts, ce qui fait de nous une cible potentielle pour les terroristes », rappelle de son côté Stéphane Gouaud, directeur de la Sécurité à la RATP. Pour sécuriser ces voyages, la régie s’appuie sur 6 000 agents de station, 1 000 agents internes de sécurité et sur 40 000 caméras.
Dans les aéroports, tout est pensé pour sécuriser les avions. Mais les voyageurs arrivant d’abord dans des aérogares, ouvertes à tous, les questions de sûreté sont identiques à celles qui se posent dans les grandes gares ferroviaires. « On y trouve des militaires du dispositif Sentinelle, 2 700 policiers de l’air et des frontières, des agents de surveillance générale, chargés de faire ouvrir sacs et manteaux, et des services de renseignements, énumère Alain Zabulon, directeur de la Sûreté, du Management des risques et de la Conformité d’Aéroports de Paris. Le passager se rend ensuite aux contrôles, où l’on scanne ses bagages cabine et où il passe sous un portique. Ces vérifications répondent à une procédure normée au niveau international. Passé cette zone, il accède à la zone d’embarquement à accès restreint. Depuis novembre 2015, les contrôles à l’entrée et la sortie de l’espace Schengen ont été généralisés, ce qui a rallongé les procédures, car la police aux frontières (PAF) ne se contente plus de vérifier les passeports, elle interroge des fichiers à distance. » Pour réduire les temps de contrôle, ADP a mis en place 37 sas automatiques pour les détenteurs de passeports à puce biométrique. Leur nombre sera doublé l’an prochain, et ADP passera à la reconnaissance faciale pour augmenter la fluidité. « L’objectif est que 90 % des voyageurs passent l’inspection filtrage en moins de dix minutes. »
Sébastien Budillon est directeur général d’Itirémia, une filiale de la SNCF qui fait travailler, selon la saison, entre 600 et 2 000 collaborateurs assurant des prestations d’accueil, d’assistance et d’accompagnement des voyageurs pour le compte de la SNCF ou d’Air France. « Nous avons une double sensibilité à la sécurité et la sûreté, et une compétence sur la partie fluidité des flux de voyageurs. Nos prestations d’assistance s’articulent autour de moyens humains et d’équipements qui visent à faciliter l’accès à la gare et aux services. Le contact humain permet de donner des consignes, mais également de recevoir des questions et de distiller une forme de réassurance pour le compte des gestionnaires de plateformes pour lesquels nous travaillons », indique Sébastien Budillon.
Comment garantir la protection des données privées ?
Les attentats ont changé les mentalités. Il y a quelques années, l’utilisation de caméras faisait débat, maintenant cela rassure. Même chose pour l’inspection visuelle. Il n’y a pas si longtemps on n’aurait pas accepté d’ouvrir son sac ou son manteau pour des inspections, désormais on s’y plie volontiers, rappelle Céline Sibert. Aujourd’hui les industriels travaillent sur des projets de caméras capables de détecter le stress ou de rapprocher les individus filmés avec le fichier des personnes recherchées…
La RATP teste des algorithmes de détection des signaux anormaux pour pouvoir utiliser les images de ses 40 000 caméras pour faire de la prévention. « Attention à ne pas sous-estimer la complexité juridique qu’il y aura derrière les projets qui se développent, prévient Alain Zabulon, car dès lors qu’il y a collecte des données personnelles, le Cnil va s’en mêler, et ce sera à l’Etat de prendre position. »
Quelle formation pour les agents chargés de la sécurité ?
Lors de leur recrutement, les agents de sécurité SNCF suivent une formation de quatre mois sur les techniques d’intervention, le tir, la déontologie, mais aussi en droit pénal. Une fois en poste, ils bénéficient de formations complémentaires plusieurs fois par an. Comme la loi Savary permet à ces agents d’agir en civil armé, leur formation a été complétée par un stage de quatre jours sur cette technique d’intervention.
« La RATP recherche 110 agents de sécurité, mais nous sommes très sélectifs. Nous avons besoin de 65 CV pour trouver un candidat qui réponde à nos exigences », indique Stéphane Gouaud. Ces agents suivent une formation qui a été modifiée pour tenir compte de la menace terroriste et de la loi Savary qui leur permet d’effectuer fouilles et palpations. « Les 4 700 agents de sécurité aéroportuaire chargés de l’inspection et du filtrage des bagages en soute à ADP font l’objet d’une habilitation du centre national des activités privé de sécurité avant de suivre une formation de plusieurs semaines qui leur permet d’être embauchés. ADP procède alors à une nouvelle enquête, tandis que les équipes cynophiles qui interviennent sur nos aéroports sont certifiées par l’aviation civile », décrit Alain Zabulon. « Nos collaborateurs opérant dans l’espace bagages objets trouvés suivent une formation de 130 heures sur la sécurité du bagage, la lecture de l’imagerie et bénéficient d’un recyclage régulier, décrit Sébastien Budillon. Pour assurer notre mission au contact du public, nous faisons suivre à nos agents une formation de sécurité complétée depuis trois ans par de la sensibilisation à la sûreté. »
Quid des menaces internes ?
« La loi Savary permet de procéder à une enquête administrative pour certains salariés sur certains postes, ou en cas de doute. On utilisera cette faculté pour des postes sensibles. C’est un progrès conséquent », estime Stéphane Gouaud. « Nos salariés travaillant pour les consignes et objets trouvés font aussi l’objet d’une enquête », poursuit Sébastien Budillon, tout en reconnaissant que pour les recrutements pour des missions de courte durée, les vérifications ne peuvent se faire.
« Le métier d’agent de sûreté aéroportuaire est l’un des plus surveillés : ces agents travaillent sous une caméra, font l’objet d’enquêtes, de contrôles inopinés. Après trois manquements à la procédure, ils ont obligation de suivre une formation, et s’ils échouent à cette formation, ils peuvent perdre leur emploi », souligne Alain Zabulon. ADP fait aussi appel à des visiteurs mystère pour détecter les faiblesses.
Comment sont traités les colis suspects ?
Sur les six premiers mois de l’année, 5 000 bagages abandonnés ont été signalés à la SNCF. « En Ile-de-France, 4 900 bagages suspects ont impacté 1,5 million de voyageurs, précise Céline Sibert. Dans la quasi-totalité des cas, il s’agit d’oublis, mais on ne peut pas laisser passer un doute, on va toujours jusqu’au bout de la procédure. » Ce qui implique parfois d’avoir à évacuer des gares, ou d’interrompre la circulation. Pour lutter contre ce fléau, la SNCF utilise des chiens formés à détecter la présence d’explosif. Ils ont permis de réduire le temps d’intervention de 52 à 11 minutes.
A la RATP on recense sept colis suspects par jour. La « levée de doute » se fait aussi avec des équipes cynophiles. « Les chiens ont permis de diminuer le taux d’interruption de trafic de 60 à 25 % », signale Stéphane Gouaud.
« Dans les aéroports, les bagages abandonnés sont un cauchemar, car à chaque signalement il faut mettre en place un périmètre de sécurité et attendre les démineurs. Chaque intervention dure en moyenne 52 minutes », se désole Alain Zabulon. Car il s’agit le plus souvent de bagages abandonnés par des voyageurs qui ont préféré se délester d’une partie de leurs affaires plutôt que d’avoir à payer les taxes de surcharge. Pour réduire le nombre d’intervention, ADP voudrait expérimenter un système de vidéo traçant le propriétaire du colis abandonné, ce qui permettrait d’intervenir rapidement en lui infligeant une amende et en l’obligeant à reprendre son bagage avant qu’il ne passe le contrôle de sécurité. « Mais c’est encore de la science-fiction », reconnaît le directeur de la Sûreté.
Quel coût pour les transporteurs ?
ADP y consacre 500 millions par an provenant de la taxe de sécurité de 11,5 euros prélevée sur chaque billet d’avion. Cette taxe finance les 4 700 agents et les équipements. « Cette dépense est restée contenue dans le temps, parce que nous avons gagné en productivité et mis en concurrence nos partenaires. Mais pas question de faire des économies sur ce poste », assure Alain Zabulon.
De leur côté, RATP et SNCF s’accordent à reconnaître une facture élevée, mais sans en donner une estimation globale. « A la RATP, le budget sécurité s’élève à 100 millions annuels, mais sans prendre en compte le personnel », explique Stéphane Gouaud. « A la SNCF, il y a des financements supportés par le propriétaire des gares, par SNCF Réseau, ainsi que des conventions d’exploitation qui concourent au financement du personnel ou à la mise en place de dispositifs, sans compter la sécurité privée… En agrégeant tout ça on aurait des sommes conséquentes que je n’ai pas », affirme Céline Sibert.
Bientôt un PC unique
En attendant de nouveaux progrès technologiques, les transporteurs se félicitent du projet de mise en place d’un commandement unique pour toutes les forces de sécurité de la police, de la préfecture, de la RATP, de la SNCF ainsi que des réseaux de grande couronne prévu pour 2019.
Toutes les informations, issues de la vidéosurveillance ou des ondes radios, y seront centralisées dans le but d’améliorer la sécurité tous ensemble. C’est un impératif car comme le rappelle Alain Zabulon : « La menace terroriste va durer, d’où la nécessité d’élever notre niveau de résilience et de ne plus seulement se reposer sur l’Etat. L’époque de paix est révolue et l’Etat a besoin de relais dans la société civile, de pouvoir s’appuyer sur la police municipale et la sécurité privée qui auront un rôle de plus en plus important pour faire face aux menaces. C’est un défi qui s’inscrit dans la longue durée. »
�Valérie Chrzavzez-Flunkert