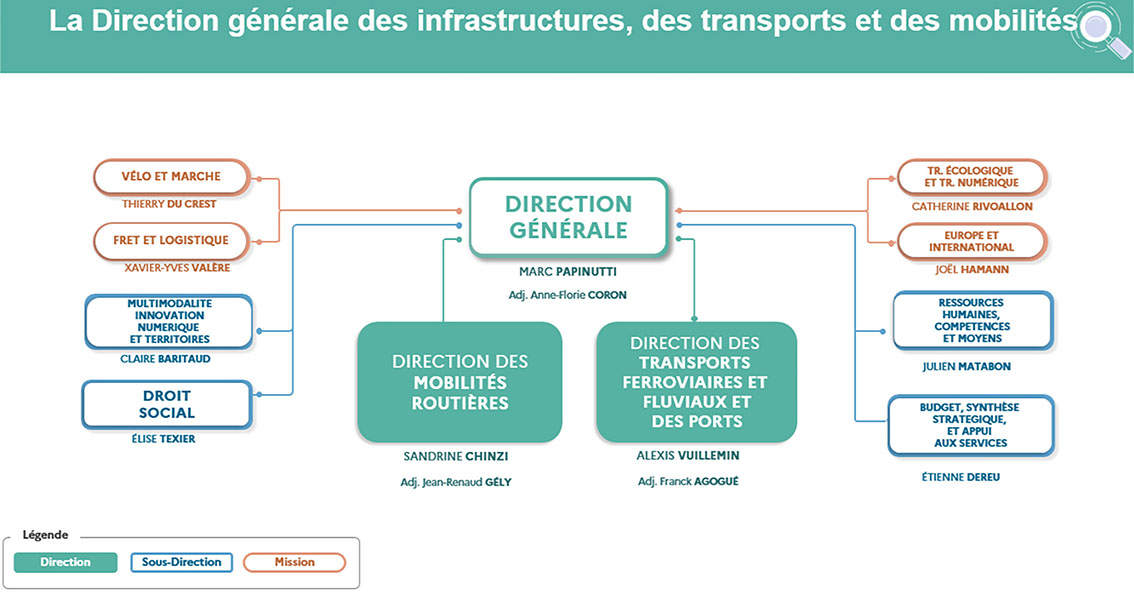Qui dit ouverture à la concurrence, dit multiplication des acteurs. Comment faire en sorte que les voyageurs effectuent un trajet « sans couture », sans se poser de questions sur le transporteur aux commandes ? C’est ce thème qui a été abordé lors de la table ronde organisée le 12 mai en amont de la cérémonie de la remise des Grands Prix des Régions.
Alors que l’ouverture à la concurrence des TER se prépare de plus en plus activement, les associations d’usagers s’inquiètent d’un risque de « morcellement ferroviaire ». Elles redoutent la mise en place de tarifications très différentes d’une région à l’autre, de correspondances pas toujours adaptées ou de la multiplication d’applications locales.
L’arrivée de nouveaux opérateurs va conduire à de nombreuses transformations, reconnaît Jean-Aimé Mougenot, le directeur TER délégué de SNCF Voyageurs. Pour assurer une qualité de service élevée aux voyageurs, il juge essentiel d’innover. « Il ne faut pas continuer à travailler comme avant, mais faire en sorte que les Régions puissent développer et adapter leur offre afin de répondre à des besoins qui évoluent », conseille-t-il. Certaines Régions ont commencé à le faire. Pour prendre en compte les changements de comportements suscités par la crise sanitaire, l’Occitanie propose par exemple des abonnements financièrement intéressants pour ceux qui télétravaillent trois jours par semaine. La Région a aussi lancé un dispositif de post-paiement à destination des moins de 26 ans les incitant à prendre le train, avec un système de tarification dégressif. Jean-Aimé Mougenot plaide pour la personnalisation du service, clé selon lui de la réussite du transport de demain. Pour répondre à cette attente, les régions Normandie et Grand Est développent un outil permettant de renseigner par SMS les voyageurs du TER, avant, pendant et après leurs voyages.
» LA PERSONNALISATION DU SERVICE EST LA CLÉ DE LA RÉUSSITE DU TRANSPORT DE DEMAIN » Jean-Aimé Mougenot
De son côté, SNCF Voyageurs a conçu une plateforme proposant un service de transport à la demande en partenariat avec des chauffeurs payés à la prestation. L’objectif est d’offrir une solution aux habitants des zones peu denses. L’outil est expérimenté par les Pays de la Loire.
Transdev, qui a remporté un des deux lots de TER mis en concurrence par la région Sud sur l’axe Marseille – Toulon – Nice (la SNCF a remporté le lot Etoile de Nice) prépare la transition à venir avec la SNCF et la Région. Claude Steinmetz, le directeur ferroviaire de Transdev, rappelle que l’objectif est d’offrir plus de qualité, de fluidité et une totale transparence à l’usager. Il insiste sur la nécessité de réussir le transfert des 163 cheminots qui seront affectés au service ferroviaire qu’assurera à partir de 2025 Transdev. Une préoccupation sociale partagée par la SNCF, qui devra également réaliser le transfert de 600 salariés pour exploiter, à partir de 2024, l’Etoile de Nice, via sa filière SNCF Sud Azur.
A la recherche de standards pour créer de la valeur
Pas concerné pour le moment par la reprise d’une ligne ferroviaire, Didier Cazelles le directeur général adjoint de Keolis France, sait déjà, en tant qu’exploitant routier de lignes régulières, à quel point une billettique harmonisée est importante. « Nous sommes multiopérateurs et dans certaines régions il y a un système d’incitation lié aux recettes. Mais pour le client c’est transparent : il n’y a qu’une marque et une billettique commune. Le fait qu’il y ait plusieurs opérateurs reste invisible pour l’usager », explique-t-il. « Dans une logique de Délégation de Service Public avec une responsabilité d’opération de marketing de conquête et d’innovation, nous faisons des pilotes d’Open paiement sur carte bancaire ou Smartphone que les Régions peuvent ensuite élargir avec l’ensemble des opérateurs », poursuit-il. Harmoniser la billettique est une nécessité, souligne Didier Cazelles qui invite les opérateurs travaillant sur un même réseau à réaliser un travail de coordination pour y parvenir. L’objectif commun, rappelle-t-il, est de reconquérir les 10 % de clients qui ne sont toujours pas revenus à bord du transport public du fait de la crise sanitaire.
Pour y parvenir, il faut, poursuit-il, faciliter le parcours client, mettre au point des standards de service plus exigeants et personnaliser davantage les voyages. La gestion des données le rend possible. A la Région de l’organiser.
» L’OBJECTIF EST D’OFFRIR PLUS DE QUALITÉ, DE FLUIDITÉ ET UNE TOTALE TRANSPARENCE À L’USAGER » Claude Steinmetz
Observant l’ouverture à la concurrence des TER en France, Didier Cazelles voit émerger des modèles différents : « Une région a choisi un modèle d’exploitation en infra, une autre attribue le matériel et confie l’exploitation, la régénération des voies et des gares et une troisième a préféré retenir une logique mixte. »
Pour dégager de la valeur, il préconise de faire émerger un modèle industriel standard. Acheter un matériel en plus grande quantité permettrait aux Régions, comme aux opérateurs, de gagner sur les prix d’achat. Une préconisation qui semble être entendue dans les appels d’offres routiers, où les exigences de standard de service se renforcent. « Le métier se transforme. On passe de l’artisanat à des process. Ce qui ne nous empêche pas de jouer un rôle de conseil, ni de partager des innovations », rapporte le directeur de Keolis.
Pour Jean-Aimé Mougenot la standardisation est aussi amorcée dans le ferroviaire avec le marché Régiolis, une rame automotrice construite par Alstom déclinable en plusieurs versions que les autorités organisatrices peuvent personnaliser. « C’est un marché de trois milliards qui va concerner des centaines de matériel encore en cours de livraison », détaille-t-il, avant d’ajouter que l’on peut aussi espérer faire des économies en travaillant sur des innovations plus frugales, avec du matériel ferroviaire hyper léger et moins cher, pour raccorder le fer aux transports en commun sur des lignes à faible densité.
Harmoniser en prenant en compte les spécificités de chaque région
Michel Neugnot, le vice-président chargé des mobilités en Bourgogne-Franche-Comté, estime en revanche que vouloir avoir un système unique dans le cadre de l’ouverture à la concurrence serait une erreur, car chaque Région a sa spécificité, son histoire, son réseau. A ceux qui s’inquiètent de l’arrivée de nouveaux opérateurs, il rappelle qu’il y a déjà une multiplicité de trains : TER, TGV, TET et du service librement organisé. Le tout étant organisé par SNCF Réseau, sans que cela ne pose de problème. C’est SNCF Réseau qui autorise la circulation sur les sillons, intervient en cas de problème et gère la reprise du trafic selon les spécificités liées au monde ferroviaire.
L’harmonisation des correspondances ne lui semble pas non plus problématique. Selon l’élu, le système fonctionne déjà entre différentes catégories de trains et avec les cars routiers. En revanche, Michel Neugnot estime qu’il faudra un jour changer les distributeurs de billets régionaux permettant l’achat de titres de transport sans réservation, qui datent de 1994 et qui n’ont pas été conçus pour prendre en compte une tarification complexe. Dans sa région, l’élu compte y pallier notamment grâce à l’achat des billets via des téléphones ou des tablettes.
» LE MÉTIER SE TRANSFORME. ON PASSE DE L’ARTISANAT À DES PROCESS. CE QUI NE NOUS EMPÊCHE PAS DE JOUER UN RÔLE DE CONSEIL, NI DE PARTAGER DES INNOVATIONS « Didier Cazelles
La Bourgogne-Franche-Comté a prévu d’ouvrir la totalité de son réseau à la concurrence à partir de janvier 2026. « La loi de décentralisation de 2002, qui a transféré la responsabilité des TER aux Régions, a permis de réaliser des avancées dans la gestion des trains par rapport à la situation antérieure. Cette nouvelle étape doit permettre d’améliorer encore les transports publics, en ayant cette fois une démarche qui soit multimodale. » La LOM a donné aux Régions les compétences pour l’ensemble des mobilités et la Région va se saisir de cette possibilité pour travailler en coordination avec les AO urbaines afin d’augmenter la part des transports publics et donc lutter contre le réchauffement climatique.
Pour identifier ce que chaque entreprise, y compris la SNCF, peut lui apporter, afin de proposer de nouvelles offres dès le 1er trimestre 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté recourt au sourcing. Elle travaille aussi à l’élaboration d’un MaaS intégrant l’ensemble des acteurs. « Nous voulons proposer une offre de transport multimodale, prenant en compte le dernier km, avec un système de billettique indépendant, qui mélangera toutes les solutions, y compris le car, le covoiturage et l’autopartage et permettra de délivrer un seul et même ticket regroupant le paquet de titres de transport nécessaires au voyage de son utilisateur. Un billet payable en une seule fois, pour que les choses soient simples », détaille Michel Neugnot qui prévoit également de mettre en place des kiosques dans les gares, où seront proposé des services de type de conciergerie, blanchisserie, ventes en circuit court, livraisons de courses…
Vers une multiplication des systèmes de billettique
La région Bourgogne-Franche-Comté veut prendre en charge la billettique. « On y travaille depuis trois ans. Ce n’est pas un long fleuve tranquille, mais on va arriver à quelque chose de correct avant 1er janvier 2026 », assure Michel Neugnot qui annonce que dans sa région, on pourra prendre son billet sur Mobigo, ou via un numéro Allo billet pour les personnes n’ayant pas accès à la plateforme. Il justifie : « Il faut que chaque Région avance sur ce sujet, car si on attend le grand outil que la Fnaut réclame, il faudra patienter jusqu’à la fin du siècle. »
De son côté, Claude Steinmetz prévient : « La pire des choses serait que chaque opérateur gère sa billettique. Ce serait une régression inutile. Ce n’est pas la démarche des nouveaux entrants. On a besoin d’une SNCF forte sur ce thème et de concertation, y compris entre régions, pour parvenir à faire en sorte que l’ouverture à la concurrence soit quelque chose de simple, de positif, qui fonctionne bien, à l’instar de ce qui se fait en Suisse ou en Allemagne. »
Michel Neugnot souhaite plus d’interconnexions entre le système billettique de sa région et l’agence de voyages de la SNCF, SNCF Connect, afin que les voyageurs qui souhaitent franchir les frontières régionales, puissent le faire de façon simple, tant pour l’information que pour la réservation. Jean-Aimé Mougenot explique : « Nous travaillons déjà comme une agence de voyages. Sur le site SNCF Connect on pourra trouver un billet combinant trains, cars et TAD. Avec la profusion de possibilités de voyages, quelqu’un qui prendra un billet à un guichet en gare trouvera la continuité de son parcours au-delà du train », assure-t-il avant d’ajouter : « La somme des possibilités de voyages doit permettre de les faciliter. Et pour cela, il faut que les différents sites soient interconnectés et puissent progressivement proposer l’ensemble des prestations de chaque Région. Notre travail est de servir à tout le monde un système d’information et d’achat simplifiant les choses. Ce qui va nous demander de passer d’un système monolithe à un système modulaire. »
» GARES & CONNEXIONS TRAVAILLE À LA MISE EN PLACE DE STANDARDS DE SIGNALÉTIQUE, D’ANNONCES, DE RITUELS D’AFFICHAGES DES TRAINS 20 MINUTES À L’AVANCE, AFIN D’APPORTER UN MÊME NIVEAU DE SERVICE À TOUTES LES GARES EN FONCTION DE LEUR TYPOLOGIE « Eliane Barbosa
Pour le directeur TER délégué, il n’y aura pas de compétition entre SNCF Connect et les sites de MaaS que les Régions mettent en place, car l’enjeu n’est pas de se faire concurrence. Le but est de parvenir à réussir l’objectif du patron de la SNCF en doublant la part du ferroviaire en 2030. Pour faciliter les échanges d’information et l’interconnexion des sites, SNCF Voyageurs est en train d’élaborer une prise TER. « Une passerelle, une boîte logicielle sur laquelle les AO pourront se brancher sur le système d’information centrale SNCF Connect, afin de faciliter les échanges d’informations », résume Jean-Aimé Mougenot qui relativise la difficulté : « On retrouve la même problématique entre les transports régionaux et le national qu’entre les AO urbaines et le transport régional. » Il prévoit qu’à l’avenir ceux qui se déplaceront dans leur région auront le réflexe d’utiliser le MaaS local, tandis que les voyageurs venant de l’extérieur se tourneront vers SNCF Connect.
Dans la Région Sud, Transdev et la SNCF avancent sur la billettique. « SNCF assurera la distribution, mais on n’a pas encore parlé de la gestion des situations perturbées, de la modification des billets, de l’annulation, de l’ajout d’options », précise Claude Steinmetz qui prévoit de traiter tous ces thèmes avant l’ouverture à la concurrence. « On a jusqu’à juin 2025 pour trouver des solutions, ce qui compte tenu de la complexité du dossier nous laisse juste le temps, mais nous sommes sereins », affirme-t-il.
Des gares en voie de standardisation
Gares & Connexions n’est pas concernée par l’ouverture à la concurrence des TER, mais sa directrice des Opérations et des territoires, Eliane Barbosa, compte profiter de cette étape pour redynamiser les 3 000 gares qui ont été confiées à la filiale de SNCF Réseau. Il s’agit d’en faire des hubs d’échanges multimodaux et de proposer de nouveaux services aux voyageurs, de manière à les inciter à prendre davantage le train. C’est tout l’objet du programme Place de la gare.
Gares & Connexions, qui est depuis 2018 le gestionnaire unique des gares, doit en effet garantir à tous les nouveaux opérateurs le même niveau de qualité de service, de confort, d’accessibilité, de propreté, d’information voyageurs, de sécurité, mais aussi de réassurance dans les parcours de transport ferroviaire ou multitransporteurs. Les équipes d’Eliane Barbosa travaillent à la mise en place de standards de signalétique, d’annonces, des rituels d’affichages des trains 20 minutes à l’avance, afin d’apporter un même niveau de service à toutes les gares, en fonction de leur typologie, quelle que soit la région où elles se trouvent.
» IL FAUT QUE CHAQUE RÉGION AVANCE SUR LE SUJET DE LA BILLETTIQUE, CAR SI ON ATTEND LE GRAND OUTIL QUE LA FNAUT RÉCLAME, IL FAUDRA PATIENTER JUSQU’À LA FIN DU SIÈCLE « Michel Neugnot
La loi d’orientation des mobilités donne la possibilité aux Régions qui le souhaitent, de prendre la main sur les petites gares. Si cela arrivait, « Gares & Connexions disparaîtrait et la garantie d’homogénéité aussi », prévient la responsable de Gares et Connexions. Pour les gares régionales, le décret mono-transporteur prévoit que des gares TER puissent voir leur gestion confiée au nouvel opérateur si la région le décidait.
Mais à ce stade, aucune Région n’a choisi de le faire. « En tant que spécialiste des gares, nous souhaitons continuer à exercer notre mission pour toutes les gares, pour tous les Français, mais nous avons aussi un devoir de pédagogie et souhaitons aider les Régions à regarder là où cela pourrait être pertinent pour elles de reprendre la main, et là où nous avons tout notre rôle à jouer pour leur apporter de nouveaux services attendus par nos clients. Les contrats de performances que nous voulons signer avec les Régions doivent aussi servir à cela », précise Eliane Barbosa.
Valérie Chrzavzez-Flunkert
Les Régions légitimes pour prendre la main sur la tarification
Michel Neugnot est favorable à la liberté tarifaire dans chaque Région et ne voit pas en quoi cela peut poser problème. « Sur les TGV, il n’y a pas de prix normés », rappelle t-il tandis que Jean Pierre Serrus abonde : « Ce n’est pas un privilège pour la région qui finance le TER d’avoir la main sur les tarifs ».
Le TER est le premier budget de la Région, rappelle Jean-Luc Gibelin, le vice-président chargé des transports en Occitanie, région qui n’ouvrira pas ses lignes à la concurrence. « Dans notre région, une offre de qualité combinée à une gamme tarifaire attractive, a permis au trafic des TER de retrouver, et même dépasser, son niveau d’avant Covid », annonce l’élu. Selon lui, la mise en oeuvre d’une politique tarifaire régionale efficace permet de développer le trafic du TER. Si Claude Steinmetz juge naturel que les Régions aient la main sur l’animation tarifaire, il les encourage tout de même à réaliser un effort d’harmonisation pour simplifier la vie des usagers. «Elles pourraient, par exemple, se mettre d’accord sur les âges à partir desquels les voyageurs ont le droit à des réductions. »
Accès aux dépôts et aux matériels, deux points clé dans l’ouverture à la concurrence
La position de Transdev est connue : il faut un atelier dédié en propre pour pouvoir faire les sauts de performance attendus par la région. En Sud Paca,, Transdev travaillera avec Alstom. « Nous serons responsable de la maintenance, mais nous travaillerons avec le constructeur pour profiter de son savoir faire», précise Claude Steinmetz.
Le directeur ferroviaire de Transdev rappelle que son entreprises bénéficiera de rames neuves dans la région. Ailleurs, si elle est amenée à récupérer du matériel auprès de la SNCF, « cela supposera qu’un état des lieux et que des informations précises soient donnés pour le transfert. La transparence doit être la règle. Je suis persuadé que ce sera le cas », conclut Claude Steinmetz.
Un système billettique universel proposé aux collectivités
Née en 2012, Ubitransport est une start-up mâconnaise qui accompagne les collectivités et les opérateurs privés dans l’optimisation de leurs réseaux de transports collectifs via des solutions de paiement en ligne, de gestion dématérialisée des titres de transport et de numérisation des informations pour les voyageurs. Sébastien Hurtaux son directeur général se félicite d’avoir déjà équipé 200 réseaux de transports répartis dans 10 régions de France : «Ubitransport gère les titres de transport et favorise le partage d’informations, en temps réel, entre conducteurs, opérateurs, collectivités et usagers », précise-t-il. La solution proposée concerne les transports scolaires, interurbains, urbains et à la demande. L’entreprise qui a obtenu une levée de fonds de 45 millions en 2019, exporte désormais son savoir-faire au-delà de nos frontières.