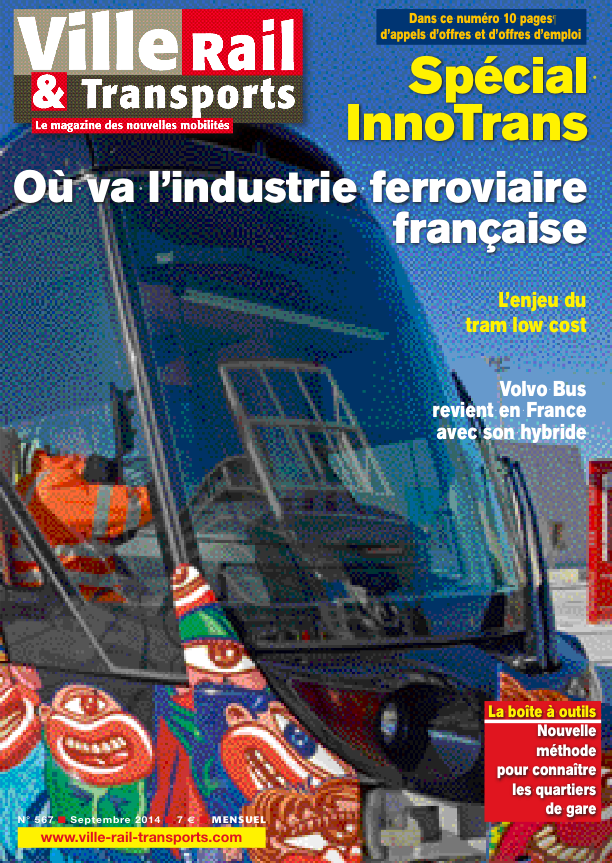Le 22 juillet, Hitachi a présenté à Londres sa gamme de rames automotrices électriques. Destinées en un premier temps au marché britannique, elles sont conçues pour gagner l’Europe continentale. Après les trains à grande vitesse pour la desserte du Kent, un nouveau défi est lancé aux constructeurs européens. Pourront-ils résister à la concurrence d’une industrie japonaise rompue au transport de masse, alignant des performances inégalées en termes de régularité ou de fiabilité ?
En juillet aussi, le chinois CRCC (China Railway Construction Corp.) remportait un contrat de construction de 150 km de lignes pour le métro de Moscou. Car la concurrence mondiale ne se fait plus seulement sur les matériels mais sur les infrastructures.
Le décor est planté. On a vécu longtemps dans l’idée qu’il y avait trois grands constructeurs mondiaux, Alstom, Siemens, Bombardier. Et que c’était peut-être un de trop. Aujourd’hui, les trois grands sont pris en tenaille. De plus gros qu’eux sont apparus : CSR et CNR, deux Chinois. Le Japonais Hitachi a implanté au Royaume-Uni le siège de son activité ferroviaire. Parallèlement, en Europe même, des constructeurs de taille plus modeste, pesant toutefois de 1 à 2 milliards d’euros de CA, ont une influence considérable sur le marché en se mettant à l’écoute des « petits » clients : le Suisse Stadler, le Tchèque Skoda, les Polonais Solaris et Pesa, les Espagnols Caf et Talgo, l’Allemand Vossloh.
Une autre raison pousse à la baisse des prix : alors que les Espagnols s’étaient lancés dans d’énormes efforts d’équipement et renforçaient leur industrie ferroviaire, la violence de la crise a conduit à l’interruption des programmes dans la péninsule. Les industriels ou les ingénieries, en surcapacité, arrivent « comme des morts de faim » sur le marché mondial. Dans une moindre mesure, n’est-ce pas ce chemin que prend le secteur en France ?
En Allemagne, le ferroviaire résiste, avec un CA de 10,4 milliards d’euros pour l’industrie, le double de celui des industriels français. Et un carnet de commandes bien rempli. « Les Allemands sont sur une autre planète », soupire-t-on à la Fédération des industries ferroviaires. Mais, en France, tout le monde a l’air d’accord pour dire : l’heure est grave. Il faut se mettre en ordre de marche. C’est maintenant ou jamais. Plus précisément, on entend : nous avons cinq ans devant nous.
La vente à General Electric des activités énergie d’Alstom laisse Alstom Transport un peu seul. Ce n’est pas un problème, assure l’industriel. Il n’empêche. Alstom va devoir stabiliser son capital. Sinon de bons experts prédisent qu’il ne résistera pas à l’offensive d’un prédateur. Pour caricaturer ce qu’on entend dire le plus souvent ; soit il renforce son partenariat avec le russe TMH, soit il se fait avaler un jour ou l’autre par un Chinois.
Pas question pour autant de nier les succès industriels d’Alstom, qui a enregistré dernièrement une commande historique de 600 trains de banlieue, pour 4 milliards d’euros, en Afrique du Sud. Mais, selon un observateur, sur les segments de marché, « Alstom a perdu des places à peu près partout ; et il est souvent à contretemps sur les segments en développement ». Il faut dire que l’attelage avec l’opérateur historique ne l’aide pas énormément.
L’état du fret national ne pousse pas à l’investissement dans les locomotives. Sur le service (SAV, deuxième monte, maintenance), Alstom est tout petit. Car pour l’essentiel de ces activités, les opérateurs historiques de transport, RATP et SNCF, conservent leurs positions industrielles. Il y a bien des trams mais Alstom n’a pas de vrai marché intérieur, sur un segment en forte croissance qui représente 30 à 40 % du marché mondial. Difficile de faire état de son savoir-faire quand on n’a pas de vitrine nationale. En trains classiques, pour des raisons identiques, le constructeur n’a pas de produits TET à 200-250 km/h.
Sur les métros automatiques, il est présent, mais plutôt outsider, alors que le secteur connaît une croissance à deux chiffres.
En grande vitesse, l’image reste bonne mais il y a beaucoup de concurrence. Et le marché n’est pas considérable. On connaît les difficultés de la SNCF, qui, assure-t-on, « ne veut pas du TGV du futur ». En interne, si jamais la SNCF se résout à acheter, elle n’a pas arrêté sa position. Au sein de l’entreprise, la direction du Matériel et SNCF Voyages ont des approches différentes. Culture technique d’un côté, de l’autre, prix à la place. Les arbitrages ne sont pas rendus.
Aussi, redoute le monde industriel, si la crise des TGV n’est pas réglée (et comment le serait-elle ?), il y a un risque de rupture de la chaîne de production. Une date circule. La SNCF s’apprête à repousser à 2022 au plus tôt l’achat de nouvelles rames. Sans difficulté. Sans même aller jusqu’à la position maximaliste : 228 rames sur 400 suffiraient à desservir un réseau noyau limité aux LGV. Et si on considère que le parc est excédentaire, il suffit de radier les rames à mesure qu’elles viennent à obsolescence. Résultat, dit un proche du dossier, Alstom pourrait être conduit à fermer son bureau d’études grande vitesse dès 2016. Il ne peut plus être question de se gargariser avec l’expression : « TGV du futur ».
L’activité en France du fleuron de l’industrie nationale ne reflète donc pas la structure du marché mondial. Qui plus est, ça tire un peu dans tous les sens. Lors des dernières années, l’évolution du système, avec ses transferts de savoir-faire entre SNCF et industriels, s’est traduite par de moins bons partages d’expérience. La réforme ferroviaire qui vient d’être votée ne convainc guère que la SNCF. La constante inexistence de politique des transports laisse la SNCF mener le jeu ferroviaire en fonction de ses intérêts de groupe multimodal. L’Etat prétendu stratège raconte des balivernes (TGV du futur, relance du fret !). Fer de France, qui regroupe toute la profession, au sens large, ingénieries, autorités organisatrices, exploitants, gestionnaires d’infrastructures, industriels, a donc fort à faire pour que ce petit monde coordonne ses énergies afin d’aller, comme on dit, chasser en meute sur le marché mondial. En attendant, les industriels tirent comme ils le peuvent leur épingle du jeu, en comptant un peu sur le marché national… Un peu, beaucoup, mais pas trop.
Il y aurait pourtant beaucoup à faire. L’état général du réseau n’est pas brillant. Ne parlons pas de l’Ile-de-France. Comme le dit le récent Cahier des ingénieurs et scientifiques de France, intitulé « La filière ferroviaire française à la croisée des chemins », en note et par litote : « le réseau RER d’Ile-de-France n’a pas actuellement des performances qui en font une vitrine attractive à l’international ». Un espoir, bien sûr : « le programme de rénovation mis en place devrait y remédier ».
A
 Spécial InnoTrans : où va l’industrie ferroviaire française
Spécial InnoTrans : où va l’industrie ferroviaire française