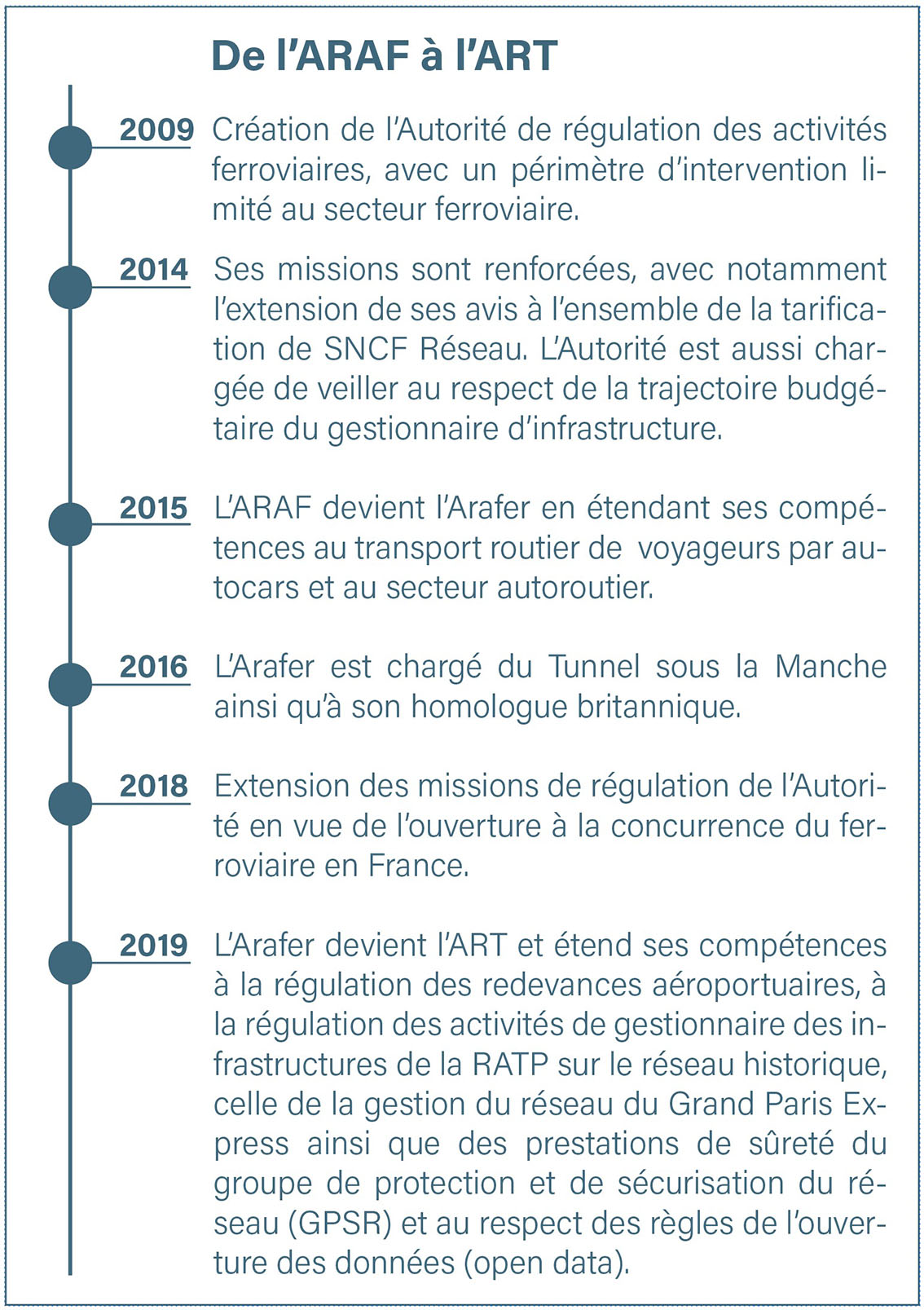Le Train, Midnight Trains, Kevin Speed et Railcoop, quatre nouveaux acteurs du monde ferroviaire, sont venus présenter, le 24 janvier, leur projet devant le Club VRT. Et leur parcours du combattant qui passe par la levée de fonds, des partenariats avec des investisseurs, l’acquisition du matériel, le recrutement de personnel…
Ils sont apparus en quelques années sur la scène ferroviaire française : Le Train, Midnight Trains, Railcoop, Kevin Speed… Et peu à peu, ils avancent leurs pions même si les obstacles sont nombreux sur leur chemin. Ce foisonnement d’initiatives constitue-t-il un phénomène franco-français ? « Le cadre légal français est intéressant pour les entrepreneurs. Il permet de voir émerger de nouveaux opérateurs », constate Stéphane Coppey, sociétaire de Railcoop. Adrien Aumont, l’un des fondateurs de Midnight Trains nuance ses propos. « L’herbe est quand même plus verte ailleurs. En Belgique, il existe une loi qui permet aux trains de nuit de ne payer ni infrastructure, ni l’énergie, pour aider les entreprises à s’implanter. En France, il existe effectivement un cadre légal, mais son application ne suit pas. Le gestionnaire d’infrastructure fait le moins d’efforts possible et le gouvernement pas grand-chose. On a le droit de se lancer, mais il faut se débrouiller », estime l’entrepreneur. Qui rappelle aussi la situation aux Pays-Bas : « Pour aider le lancement d’une compagnie de train de nuit privée dans ce pays, l’Etat lui accorde des garanties pour le leasing du matériel ».
Acquérir du matériel, étape clé
Une étape importante a été franchie par la société Le Train : le 23 janvier, elle a annoncé avoir choisi, au terme d’un appel d’offres européen, le constructeur espagnol Talgo pour lui commander dix rames. En souhaitant à l’avenir aller encore plus loin, au gré des besoins et des développements, car « lancer une compagnie ferroviaire uniquement avec dix rames n’aurait aucun sens », commente Alain Getraud, le directeur général du Train. La commande représente plus de 300 millions d’euros,.
Les rames seront issues de la plateforme Avril développée par Talgo. Elles seront aménagées de façon à pouvoir embarquer des pièces de grande taille, par exemple des planches à voile, et disposeront de 40 places de vélo par rame. « Nos ingénieurs travaillent avec ceux de Talgo sur un aménagement intérieur complètement différent de celui qu’on connaît en France et en Espagne », précise le dirigeant. Une antenne R&D sera basée sur le Ferrocampus à Saintes en Charente-Maritime.
» LANCER UNE COMPAGNIE FERROVIAIRE AVEC SEULEMENT DIX RAMES N’AURAIT AUCUN SENS » Alain Getraud
Le partenariat signé avec Talgo comprend la maintenance de la flotte pour 30 ans. « Nous visons une pénétration du marché ferroviaire du Grand Ouest en 2025 », ajoute Alain Getraud, qui espère toujours conclure les négociations engagées avec la SNCF sur la cession de dix rames qui pourraient ensuite être rétrofitées. Des discussions ont aussi lieu avec d’autres opérateurs.
« Pourquoi construire du neuf quand on peut réutiliser du matériel ? », interroge d son côté Stéphane Coppey. Le projet de Railcoop s’appuie sur l’acquisition de matériels d’occasion. « Sur des trajets d’une à deux heures maximum, le confort de véhicules d’occasion réaménagés sera suffisant », assure le porte-parole de Railcoop. D’autant, constate-t-il, qu’il n’y en pas énormément de disponible sur le marché. « Nous n’avons pas eu la partie facile avec la SNCF, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes a joué le jeu en nous donnant accès à ses rames » , ajoute-t-il. Les rames X 72500, récupérées par la société coopérative, n’ont pas bonne presse, en raison des problèmes de fiabilité qu’elles ont accumulés. Des travaux de remise à niveau ont été effectués avec succès, affirme Railcoop.
Trouver des trains de nuit s’avère peut-être encore plus compliqué. Ou plus exactement trouver un industriel qui en construit encore. « Nous avions d’abord envisagé d’acquérir du matériel d’occasion, mais avons finalement décidé de l’acheter neuf », raconte de son côté Adrien Aumont. Un investissement conséquent mais qui permet une exploitation pendant 40 ans.
Après avoir fait le tour des constructeurs en Europe, l’entrepreneur affirme avoir trouvé la perle rare. Mais refuse d’en dévoiler le nom pour le moment. Les actifs seront portés par une rosco qui louera les trains à la compagnie. La prochaine étape sera une levée de fonds pour un lancement, espèrent ses fondateurs, d’ici 2025. « On communiquera lorsqu’on aura réussi, probablement avant l’été ».
La start up cherche aussi le partenaire adéquat sur la maintenance. « Le mieux, c’est que le constructeur en prenne la responsabilité, mais cela peut aussi être dans la main dune Rosco, ou être confiée à des experts », poursuit Adrien Aumont. Selon lui, le vrai problème pour un opérateur qui prévoit de partir de Paris, c’est le foncier. « Nous voulons opérer depuis la gare de Lyon et cherchons un dépôt de maintenance à proximité de cette gare. Pour les trains de nuit nous avons besoin de maintenance de jour, là ou des trains roulant de jour sont entretenus la nuit », souligne-t-il.
Frilosité des investisseurs
Pour aller plus loin, Railcoop a besoin de 43 millions d’euros. Mais, si les sociétaires sont enthousiastes, les investisseurs sont frileux. Pour avancer, la coopérative travaille sur fonds propres. Elle a abondé à hauteur de 5,7 millions d’euros son capital social, via des titres participatifs. Elle a aussi obtenu des garanties d’emprunt venant de régions. L’Occitanie lui a donné son feu vert, à hauteur de 4,5 millions d’euros et la coopérative attend la réponse de quatre autres régions. En guise d’assurance, Railcoop souhaiterait obtenir des engagements de long terme sur les sillons. « Nous avons besoin d’engagements dans le temps pour pouvoir construire un business plan à l’abri des incertitudes », indique Stéphane Coppey.
» NOUS SOMMES EN DISCUSSION AVEC SNCF RÉSEAU POUR SIGNER UN ACCORD-CADRE DE LONGUE DURÉE » Laurent Fourtune
Pour acquérir les trains dont elle a besoin, la société Kevin Speed est en discussion avec des fonds d’investissement. Elle souhaite un train équipé de nombreuses portes latérales, pour pouvoir circuler rapidement, et étant capable de rouler à 300 km/h, tout en résistant à des accélérations et freinages rapides pour être omnibus. Laurent Fourtune affirme avoir signé un protocole d’exclusivité avec un constructeur français. « Le train est prêt, mais il faut des rails pour le faire circuler et nous sommes en discussions avec SNCF réseau pour signer un accord-cadre de longue durée », ajoute-t-il.
Recrutements sur fond de pénurie
Pour attirer des candidats dans un marché en tension, Alain Getraud veut jouer la carte de la séduction. « Il faut être sexy, car nous ne sommes pas la SNCF. Nous n’avons pas sa capacité à offrir un statut ou un parcours professionnel. Heureusement nous arrivons à embaucher car le ferroviaire a du sens : nous sommes vus comme une entreprise engagée éthiquement ».
Comme il ne compte pas déshabiller son voisin pour trouver le personnel dont il aura besoin, « cela ne serait pas sain », Alain Getraud a mis en place des formations avec Getlink. « Nous avons adapté les modules pour former sur simulateur dans un premier temps, et demain sur le rail » Le DG du train assure être capable de former à la conduite en 9 à 12 mois. Il souhaite aussi féminiser les métiers du rail, y compris les métiers techniques. « Nous avons l’ambition de parvenir à la parité, à terme. Pour cela, nous travaillons sur la reconversion de personnel venant, notamment, de la santé »
» IL FAUT ODNNER EN VIE AUX MEILLEURS DE VENIR CONDUIRE DES TRAINS, PARCE QUE C’EST UN MÉTIER DE DINGUE « Adrien Aumont
« Au démarrage nous n’aurons pas besoin de beaucoup de conducteurs », assure Adrien Aumont. Pour les attirer, le salaire peut être une réponse. L’attractivité de l’entreprise en est une autre. « Des talents, des rock-stars du métier viennent vers nous et acceptent nos grilles salariales », constate le créateur de Midnight Trains qui souhaite contribuer à transformer l’image du conducteur, pour créer des vocations. « Il faut donner envie aux meilleurs de venir conduire des trains, parce que c’est un métier de dingue. Nos formations sont importantes, mais nous devons aussi rendre ce métier cool, générer de la passion pour les jeunes générations » Midnight Trains veut mettre en place une culture d’entreprise qui lui permette de recruter des collaborateurs experts et passionnés à tous les niveaux, à l’instar de Nicolas Bargelès (ex de RFF, de Thello et d’Eurostar) qui a rejoint l’entreprise en tant que directeur des Opérations.
Pour lancer son offre, Kevin Speed aura besoin de recruter 500 cheminots d’ici à 2027. « Nos conducteurs seront actionnaires et nous mettrons en place un plan de participation. Car même si on a affaire à des passionnées, ils exercent des métiers exigeants avec des contraintes. Il faut le compenser et que cela paye », souligne Laurent Fourtune.
Création de valeurs
« L’Europe doit aussi jouer un rôle, aider le développement du rail en garantissant les emprunts et en facilitant l’accès au marché d’entreprises comme les nôtres », plaide Stéphane Coppey qui en attend aussi une harmonisation des réseaux, tant du point de vue technique, que de l’organisation. « Les douanes restent un handicap majeur au développement du rail. On parvient à passer les frontières facilement en avion et en camion, c’est encore compliqué en train », déplore-t-il. « On n’a jamais eu autant besoin de trains, les gens en réclament, mais on n’arrive pas à en acheter. C’est pour cela que les entrepreneurs du rail sont importants », affirme Laurent Fourtune. « Il y a de la demande de la part des clients, de la place sur le rail, c’est l’occasion de re développer le chemin de fer. Ce qu’a fait la SNCF en France est remarquable, mais on a besoin de faire encore mieux et différemment. Chacun dans notre domaine, nous sommes des aiguillons qui serviront à faire progresser le système, même si nous resterons petits. »
» L’EUROPE DOIT JOUER UN RÔLE, AIDER LE DÉVELOPPEMENT DU RAIL EN GARANTISSANT LES EMPRUNTS ET EN FACILITANT L’ACCÈS AU MARCHÉ D’ENTREPRISES COMME LES NÔTRES » Stéphane Coppey
Il faut faire comprendre que les nouveaux entrants ont un rôle à jouer dans le développement du rail, ajoute Adrien Aumont. Il se souvient que, lorsqu’il a commencé à annoncer ses intentions de lancer une entreprise ferroviaire, personne n’y croyait. « Il faut accélérer le mouvement et comprendre qu’il n’y aura pas que des gros opérateurs. Il y aura aussi des petites entreprises créatrices de valeur. On sait que ce ne sera pas facile, mais ne nous plaignons pas trop et continuons ».
Valérie CHRZAVZEZ
Le Train vise le Grand ouest
L’ouverture à la concurrence doit être l’occasion de créer un choc d‘offres, de manière à engendrer un report modal et augmenter la part du fer, explique Alain Getraud, directeur général de la société Le Train. « Partout où il y a eu ouverture à la concurrence, il y a eu un effet d’induction bénéfique à l’opérateur historique », rappelle-t-il. Les nouveaux entrants arrivent en effet avec des services et des positionnements différents de ceux de l’entreprise historique.
Relevant des besoins de dessertes insatisfaits dans le Grand Ouest, l’entreprise née en Charente en 2020, veut lancer des liaisons à grande vitesse entre Bordeaux-Angoulême, Bordeaux-Nantes ou encore Bordeaux-Rennes. Alain Getraud prévoit de faciliter les réservations et les échanges de billets et de travailler sur les connexions, afin de rendre le voyage le plus simple possible. Le Train n’aura pas de classe à bord, mais des ambiances différentes et promet une qualité de service équivalente à Inouï. S’il n’est pas question de jouer la carte du low cost, Le Train assure que ses tarifs seront moindres que ceux de l’opérateur public. Après une période de montée en puissance de 3 à 5 ans, Le Train vise un marché de 3 à 5 millions de passagers, avec une dizaine de lignes.
Railcoop veut faire revivre les lignes abandonnées
Née il y a trois ans, Railcoop est une coopérative qui a obtenu sa licence d’opérateur et son certificat de sécurité, et compte aujourd’hui 13 700 sociétaires. Mais elle peine à convaincre les investisseurs à la suivre : elle dispose d’environ 8 millions d’euros. Il lui en faudrait près de 43 millions.
En attendant de pouvoir se positionner sur le marché des voyageurs (entre Bordeaux et Lyon pour commencer, avant d’enchainer avec un Lyon-Nancy ou Thionville, puis un Toulouse-Rennes), Railcoop a lancé une première ligne de fret palettisé entre Capdenac et St Jory,.
« Une ligne qui n’a pas décollé et qu’on a réorientée sur du transport de bois pour la société Fibre Excellence », reconnaît Stéphane Coppey, l’un des sociétaires de la coopérative.
« Le choix des lignes tient compte de critères écologiques, économiques et d’aménagement du territoire, mais vise aussi à faciliter le report modal, par rapport à l’avion et la voiture. Une dizaine de lignes ont été déclarées à l’ART », précise encore Stéphane Coppey.
Kevin Speed travaille sur la grande vitesse low cost
La toute jeune société Speed Kevin veut être l’easy.Jet du ferroviaire et proposer une vingtaine de trains omnibus pour les déplacements domicile-travail en les rendant accessible à tous. « Notre objectif est de prendre des parts de marché à la voiture en s’adressant à ceux qui se déplacent quotidiennement pour aller travailler. La plupart le font en voiture, car pour être « commuters » en TGV aujourd’hui, il faut pouvoir consacrer 6 000 à 7 000 euros à ses déplacements. Seuls les plus riches et les cheminots qui ne payent pas le train peuvent se le permettre », constate le concepteur de Speed Kevin, Laurent Fourtune. Cet ancien directeur des Opérations d’Eurotunnel (qui est aussi passé par IDFM et la RATP) veut jouer sur les prix en s’inspirant de l’expérience italienne. « En baissant les tarifs de commuting de 30 %, il a été possible d’y doubler le trafic des commuters », rappelle-t-il.
Avec cette offre, Laurent Fourtune entend apporter sa pierre à l’édifice et contribuer au doublement de la part du ferroviaire comme le souhaite Jean-Pierre Farandou. « Comme les autres nouveaux entrants, nous allons aiguillonner SNCF voyageurs et la pousser à faire mieux », dit il, persuadé que la demande est là. « Malgré le prix élevé des trains, ils sont complets. Il faut en ajouter. Et comme l’argent public manque, il y a un vrai enjeu à trouver de l’argent privé », conclutt le patron de Kevin Speed.
Midnight Trains rêve d’hôtels sur rail
Après avoir vendu sa société KissKissBankBank, Adrien Aumont souhaitait lancer un projet compliqué. Il ne pouvait pas mieux trouver que le secteur ferroviaire, affirme-t-il aujourd’hui. A cela s’ajoute sa volonté de faciliter ses voyages en Europe (son amie a peur de l’avion) tout en ayant le moins possible d’impact environnemental. D’où l’idée de relancer des trains de nuit, plus exactement de les réinventer avec des couchages privatifs, une literie confortable, une bonne sonorisation et des lieux de vie à bord : restaurant, bar…, le tout avec une fréquence quotidienne, permettant de connecter les grandes villes d’Europe situées entre 800 et 1 500 km de Paris.
Adrien Aumont mise aussi sur le digital pour la distribution… et tout le reste. « En cas de retard, nous voulons pouvoir rembourser les voyageurs avant même qu’ils n’arrivent à destination, sans formalités à réaliser » Ces « hôtels ferroviaires » seront proposés à un prix compétitif. « Un tarif équivalent à ce qu’un voyageur dépense en avion, en prenant en compte les options (bagages en soute et réservation des sièges) et le prix du taxi pour se rendre à l’aéroport. Le train de nuit étant cher à produire, nous ne pouvons pas le vendre à bas prix, mais voyager avec nous ne coûtera pas plus cher qu’en avion », promet le fondateur de Midnight Trains.
La future compagnie table aussi sur la clientèle d’affaires qui pourrait représenter 30 % des voyageurs. « Voire davantage. Car si le choix d’un voyage bas carbone est un choix moral pour le particulier, pour les sociétés, c’est une obligation. Nous avons la sensation que le voyage professionnel sera un marché important et allons proposer un produit de qualité pour y répondre »