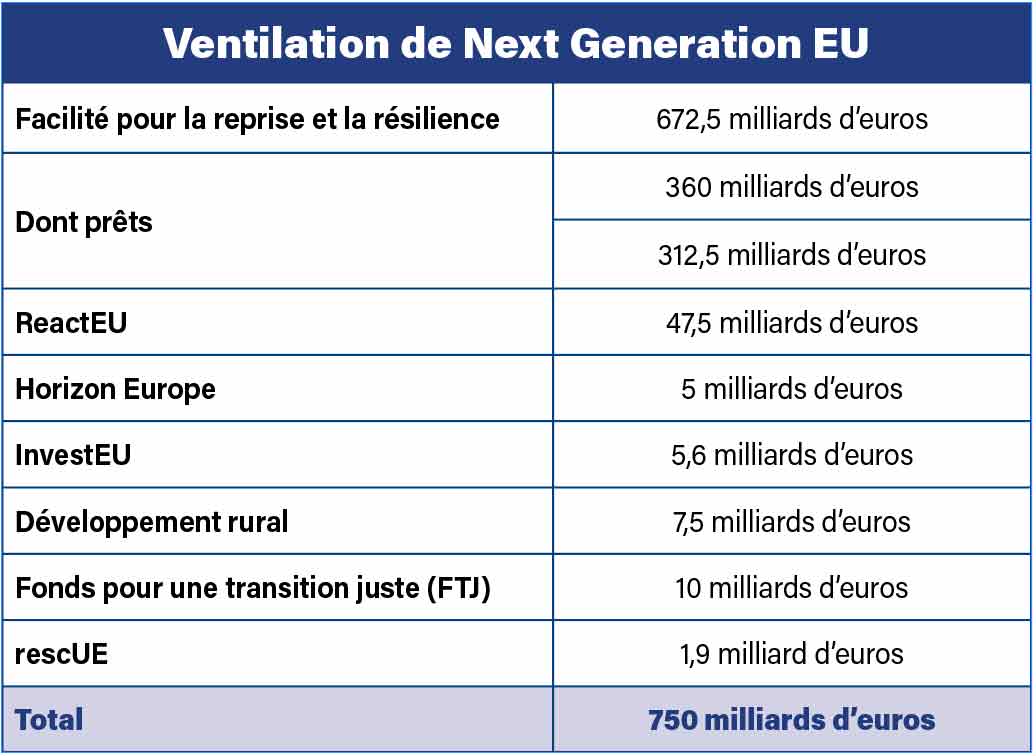Le grec Apóstolos Tzitzikóstas, ancien gouverneur de la région de Macédoine-Centrale, a pris le 1er décembre ses fonctions de commissaire européen, en charge des Transports durables et du tourisme. Membre de Nouvelle Démocratie, le parti de centre-droit au pouvoir en Grèce et affilié au Parti populaire européen, Apóstolos Tzitzikóstas intègre la nouvelle équipe de la Commission von der Leyen.
Lors de son audition devant la commission des Transports et du Tourisme (TRAN) du Parlement européen, le 4 novembre à Bruxelles, Apóstolos Tzitzikóstas a défendu la poursuite du Pacte vert pour l’Europe (Green Deal), pilier de la politique de développement durable initiée lors du premier mandat d’Ursula von der Leyen.
« Pendant mon mandat de gouverneur de la région de Macédoine-Centrale, j’ai encouragé la transformation de la mobilité urbaine dans la ville de Thessalonique (capitale de la Macédoine-Centrale, NDLR) en rendant les transports plus écologiques, plus intelligents, plus durables et plus abordables. J’ai mis mis en œuvre des politiques spécifiques de réduction des émissions des véhicules dans ma région, en encourageant l’utilisation de véhicules électriques. J’ai soutenu la mobilité active, en installant notamment de nouvelles stations de recharge électrique et en étendant le réseau de pistes cyclables« , a rappelé Apóstolos Tzitzikóstas.
Le commissaire aux Transports s’est engagé à présenter dès 2025 un plan d’investissement dans les transports durables. Il promet de s’engager pour l’achèvement du réseau complet RTE-T d’ici à 2040. « Les fonds nécessaires à cette entreprise sont énormes : rien que pour le réseau central, nous avons besoin de 515 milliards d’euros. Il va donc de soi que nous nous battrons lors des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel de l’Union européenne« , a-t-il indiqué.
Teresa Ribera à la Concurrence
La socialiste espagnole Teresa Ribera, ancienne ancienne ministre de la Transition écologique du gouvernement de Pedro Sánchez, a été nommée vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une transition propre, juste et compétitive. Les dossiers de concurrence dont elle aura la charge pourraient s’avérer déterminants dans le secteur des transports. Dès le 3 décembre, deux jours après son entrée en fonction, la nouvelle commissaire a prévenu que l’interdiction de la vente de voitures à moteur à combustion prévue par l’UE en 2035 ne serait « pas retardée« .
La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a déjà chargé le nouveau commissaire aux Transports d’élaborer une feuille de route industrielle ambitieuse pour l’industrie automobile européenne, face à la pression exercée par la Chine. » La compétitivité doit s’appuyer sur la durabilité« , a rappelé Apóstolos Tzitzikóstas lors de son audition par les députés européens. « Les transports sont le seul secteur dont les émissions continuent d’augmenter par rapport à 1990« , a-t-il encore rappelé.