Entretien avec Eric Cazeaux, directeur de la division Mobility de Siemens France
Après avoir remporté les automatismes des lignes de métro 14, 1 et 4 de la RATP, Siemens s’est vu attribuer par la SNCF le système d’exploitation des futurs trains du RER E. Depuis les débuts de Méteor, l’industriel joue un rôle de premier plan dans la modernisation du système de transport en Ile-de-France. Entretien avec Eric Cazeaux, sur les perspectives en France et dans le monde des solutions modernes de mass transit. Ville Rail & Transports. Vous avez créé à Toulouse le centre mondial du Val, tout en gardant les automatismes à Châtillon (voir VR&T n° 582 de décembre 2015 ou ici). N'est-ce pas étrange de séparer automatismes de métro et métros automatiques ?
Eric Cazeaux. Ce sont deux métiers assez différents, qui se complètent. D’un côté, nous fournissons les automatismes aux exploitants, comme la RATP ou la SNCF en France, sans matériel roulant. Et ces automatismes ne sont pas destinés à fonctionner sur un seul type de trains. A titre d’exemples, nos automatismes équipent les trains Siemens à Riyad, mais aussi les trains d’autres constructeurs à Barcelone, à New York, ou encore à São Paulo. Ce que nous cherchons en ce cas, c'est à intégrer harmonieusement nos systèmes à de nombreux trains, à de nombreux enclenchements, à de nombreuses portes palières ou autres systèmes de protection des quais. Cette capacité d'intégration est essentielle ; elle constitue une véritable compétence de nos équipes.
L'approche pour le Val et le Neoval est différente. Il n'y a qu'un seul matériel roulant, un seul enclenchement, un seul poste de conduite ou de supervision, auxquels il faut être intimement intégré. Il ne s'agit pas ici de rechercher de l'ouverture et de la variabilité, mais plutôt de la fermeture, garante de performance et de réduction des coûts.
VR&T. Vous espériez que la ligne 18 du Grand Paris Express soit équipée d'un Val. Mais la SGP a fait le choix d'un métro à roulement fer et au gabarit du métro parisien. Qu'en pensez-vous ?
E. C. Je le regrette, mais il y a heureusement d'autres opportunités en France et dans le monde pour le Val ou le Neoval. Voyez notamment l’appel à candidature pour un people mover de cinq stations destiné à l'aéroport de Los Angeles. Il s'inscrit dans une vaste opération de modernisation de cet aéroport, qui est l'un des tout premiers au monde. Il y a d’autres projets à Hongkong, à Londres, en Chine, à Dubaï, dont les appels d'offres ne sont pas encore publiés.
VR&T. Y a-t-il d'autres perspectives que celles des dessertes d'aéroports ?
E. C. Oui, dans les grandes métropoles, et notamment en Chine. Certes, la Chine ralentit, mais elle allait tellement vite qu'elle continue à avancer. Et elle connaît des besoins importants. Il existe une volonté très forte de construire, dans les villes, des feeder lines, qui peuvent être des tramways, des métros légers ou des monorails. Les grandes métropoles qui disposent déjà de réseaux de métro lourd importants avec de longues interstations ont besoin de ces lignes pour rabattre plus facilement les populations des zones denses vers leurs réseaux. Les besoins existent également pour les métropoles de moindre importance qui n'ont pas encore de réseau de métro. Les tramways peuvent répondre à leurs besoins, de même que les monorails ou les métros légers.
Sur le sujet des tramways, la Chine a une approche différente de la France. Le tramway a partout une fonction première qui est de transporter des passagers, mais il a en France deux objectifs secondaires : la rénovation urbaine et l'exclusion de l'automobile par l'occupation de l'espace. La Chine, elle, a besoin de transporter des gens massivement. Les Chinois s'intéressent donc à la performance du système et à sa capacité à ne pas trop occuper la voirie. Car le phénomène de congestion auquel leurs villes sont aujourd'hui confrontées devient létal.
VR&T. Où en est le marché des automatismes de métro ?
E. C. Il s'agit toujours d'une activité assez forte grâce, notamment, à de grands marchés clé en main au Moyen-Orient. Malgré la baisse du cours du brut, les pays de cette région continuent à investir, essentiellement dans des métros sans conducteur de grande et moyenne capacité ainsi que dans des projets d’APM. Spécialistes du métro sans conducteur, nous nous positionnons sur le marché des automatismes.
VR&T. Et en France ?
E. C. L’actualité en France, c’est l'appel d'offres en cours pour la rénovation des lignes B et D du métro de Lyon. En Ile-de-France, nous sommes engagés dans la rénovation du RER E et l’automatisation intégrale de la ligne 4 du métro parisien. Quant au métro automatique du Grand Paris Express, l’appel d’offres vient de sortir pour la ligne 15 Sud.
VR&T. Vous avez remporté Nexteo, le nouveau système d'exploitation des trains conçu pour Eole, qui va équiper le RER 2N NG. Que représente Nexteo ?
E. C. C'est un système qui préfigure ce que seront les systèmes d'exploitation des RER franciliens. Cela concerne donc des longueurs de ligne très importantes et un grand nombre de trains. Nexteo, qui est un CBTC, va apporter aux RER les fonctionnalités des systèmes d'automatismes les plus modernes. Il va les doter des réserves de capacité et d’une possibilité d'absorption des perturbations qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Dans les systèmes qui ne sont pas des CBTC, aussi performants soient-ils, en cas de perturbation, la reprise de la marche est assez longue. Le principe du CBTC, avec son canton mobile et déformable, offre une grande souplesse alors qu'un système de cantonnement fixe est beaucoup plus contraignant. Nexteo permettra ainsi de faire passer dans le nouveau tunnel est – ouest 28 trains à l'heure.
VR&T. C'est le système tout entier que vous fournissez et maintenez ?
E. C. Oui, et c'est une véritable nouveauté. Il s’agit d’un marché de conception-réalisation accompagné de deux tranches de maintenance de 15 ans. A ma connaissance, c’est une première dans ce domaine en France.
VR&T. Nexteo, c'est pour toute l'Ile-de-France ?
E. C. Il revient à la SNCF – ou au Stif – de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une stratégie Next, et une instance, Nexteo, qui est l'application de Next à l'axe est – ouest. Nexteo est le germe de Next. Ce n'en est pas la fin. Il faudra sans doute des adaptations pour appliquer le système à un axe RER nord – sud car chaque ligne à ses spécificités, mais qui ne nécessiteront pas de recommencer à partir de zéro.
VR&T. Avec Nexteo, la SNCF va donc mettre les RER au niveau des métros ?
E. C. Encore faut-il pour cela que le système soit complété. Avec Nexteo nous fournissons un système de supervision de la zone dense. Mais si l'on s'en tenait là, les extrémités, est ou ouest, resteraient encore sous le contrôle de supervisions de zone, à la différence de ce qui se fait à la RATP, où un centre de contrôle unique est chargé de la performance de toute la ligne. Dans la culture ferroviaire nationale qui est celle de la SNCF, l'exploitation se fait par zones, ce qui ne permet pas la gestion dynamique de l'ensemble de la ligne d'un RER. C'est pourquoi SNCF Réseau a prévu d'équiper les extrémités est et ouest, où il n'y a pas Nexteo, d'un ATS, c'est-à-dire d'un système de supervision qui va permettre à la ligne E d'être exploitée comme une seule ligne, et non pas comme des segments traversant des régions. L'appel à candidature pour ce système a été lancé.
VR&T. Le vendredi 22 janvier, la ligne 1 du métro parisien, que vous avez entièrement automatisée avec la RATP, s'est arrêtée pendant plusieurs heures. Que s'est-il passé ?
E. C. J'ai sur ce sujet un devoir de réserve vis-à-vis de notre client, la RATP. Je relèverai simplement qu'il n'y a eu aucun impact sur la sécurité. Toutes les décisions prises par les systèmes ont garanti la sécurité des personnes. Ce qui est fondamental.
VR&T. Après avoir automatisé en service la ligne 1, vous avez remporté le contrat pour la ligne 4. Est-ce le même système ? Le même défi ? Quelles différences entre les lignes ?
E. C. Le système CBTC est globalement le même sur les deux lignes. Il a fait ses preuves d’adéquation aux besoins d’exploitation du métro parisien et bénéficie du retour d’expérience de l’automatisation de la ligne 1. Le contrat Paris ligne 4 confirme notre compétitivité et la confiance de la RATP en Siemens pour le passage en sans conducteur d'une ligne existante. Les défis principaux sont les mêmes, notamment la transition douce vers l’automatisation intégrale sans perturbation de l’exploitation pour les voyageurs et l’atteinte immédiate d’excellence en matière de disponibilité et de qualité de service en général. Les différences entre les deux projets portent plutôt sur les conditions de son déploiement : phasage du déploiement du système sur la ligne 4 prenant en compte l’extension de la ligne vers le sud, cohabitation de trois types de trains là où un seul était nécessaire sur la ligne 1, évolution de la réglementation, notamment en matière de cybersécurité.
VR&T. Les automatisations de lignes anciennes constituent-elles un marché important pour vous dans le monde ?
E. C. La rénovation des lignes anciennes vers des technologies modernes à base de CBTC est déjà depuis plusieurs années un véritable marché pour nous en France comme à l'export, suivant la dynamique lancée par Paris et New York à la fin des années 90. L'objectif pour nos clients est avant tout d'augmenter la capacité de transport et la disponibilité de leurs lignes, tout en réduisant leurs coûts de possession. Ainsi la plupart des grandes villes en développement disposant de métros « historiques » engagent ce type de programme de modernisation sur la durée, le plus souvent à l'occasion d'une rénovation complète des flottes de trains.
Propos recueillis par
François DUMONT



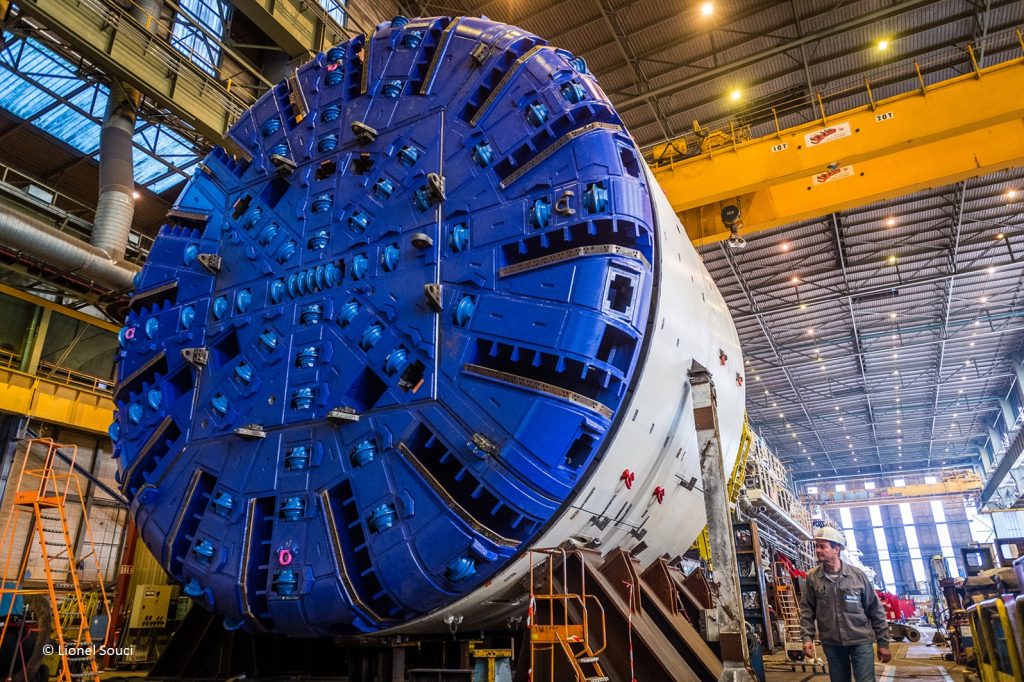


.jpg)