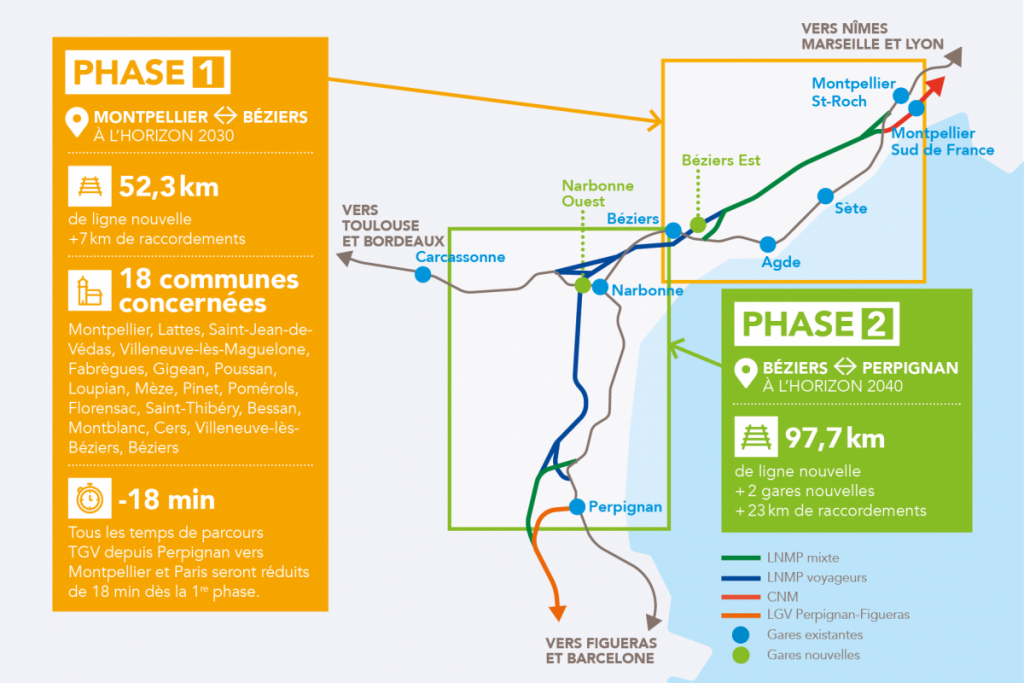Préoccupant. C’est, en substance, le jugement de la Cour des comptes qui s’est penchée sur la situation financière d’Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports collectifs de la région qui assurent chaque jour 9,4 millions de déplacements.
La crise sanitaire, qui a fait chuter le nombre de voyageurs dans les transports collectifs et donc les recettes (même si elles ne représentent que le tiers des recettes de fonctionnement d’IDFM), a mis à mal les finances d’IDFM. Si l’Etat a renfloué ses comptes en 2020 et 2021 -en lui apportant la première année, plus d’1,4 milliard d’euros, puis 800 millions d’euros l’année suivante-, sa contribution s’est essentiellement faite sous forme d’une avance remboursable, qui engage IDFM jusqu’en 2036.
Cette pression budgétaire survient à un moment où des investissements massifs sont engagés pour moderniser le réseau francilien (création de neuf nouvelles lignes de métro automatique pour le Grand Paris Express, et de tramway (lignes 9 à 13) ; prolongement de lignes et mise en place de 120 nouvelles dessertes de bus). « L’ensemble représente une extension du réseau (métro, RER) de près de 20 %, dont la moitié pour le GPE, et près de 150 gares et stations supplémentaires », rappelle la Cour des comptes dans un rapport présenté le 16 février sur « les transports collectifs en Ile-de-France ».
Avec une dette évaluée à 7,626 Md€ fin 2021, le recours à l’emprunt est inévitable, estime le gendarme des finances publiques qui juge impossible, en l’état actuel, de poursuivre le rythme de + 30 % d’investissements programmés sur la période 2021 – 2030. D’autant qu’avec la mise en service de ces nouvelles lignes, tout particulièrement celles du Grand Paris Express, IDFM va devoir faire face à de nouvelles dépenses de fonctionnement (on évoque un milliard d’euros supplémentaires de frais de fonctionnement annuels pour le Grand Paris Express) dont on ne sait toujours pas comment elles seront financées.
Puisqu’il est difficile de reporter les investissements, il faut prévoir de nouvelles recettes. Les premières pistes envisagées par la Cour passent par une augmentation des contributions actuelles qui participent au budget d’IDFM. En commençant par une augmentation du prix du ticket payé par les usagers. L’abonnement mensuel Navigo est bloqué depuis plusieurs années à 75,20 €. Son augmentation se justifierait par l’ouverture des prolongements de métro (lignes 4 et 12) ou encore de tramway (ligne T13). Pourrait s’ajouter l’augmentation des contributions versées par les collectivités parties prenantes d’IDFM. Il s’agirait de rapprocher leurs versements (actuellement de + 1,1 % par an) du niveau d’investissement (+ 4,1 %).
En revanche, les auteurs du rapport estiment plus compliqué d’élever le montant du versement mobilités acquitté par des entreprises, qui serait déjà au maximum de leurs possibilités.
Les « Sages » de la rue Cambon envisagent également de nouveaux leviers, telle qu’une contribution des automobilistes franciliens par le biais de péages ou d’éco -contributions sur le carburant. Parmi les autres idées figurent une taxe sur la valorisation immobilière lors des mises en service des lignes et des gares, ou encore la perception de taxes foncières, de droits de mutation ou l’imposition des plus-values.
Dans sa réponse à la Cour, le Premier ministre renvoie sur IDFM à qui il « appartient, dans l’exercice d’une compétence qui lui est dévolue, d’explorer les leviers, aussi bien en recettes qu’en dépenses, pour tendre vers l’équilibre financier du système de transports collectifs franciliens« . Refusant toute nouvelle taxe, Jean Castex rejette tant la hausse suggérée des contributions des automobilistes franciliens qu’une éventuelle contribution immobilière.
De son côté, Valérie Pécresse écrit qu’il « conviendrait d’offrir à Ile-de-France Mobilités de nouvelles ressources fiscales pour financer l’exploitation des projets en cours de réalisation et à venir, notamment le Grand Paris Express, comme le Premier Ministre s’y était engagé dans un courrier du 21 janvier 2020« .
Reste que la solution la plus simple, qui consisterait à augmenter les tarifs, n’est pas à l’ordre du jour. Elle a déjà été repoussée à plusieurs reprises par la présidente de région, également candidate LR à la présidentielle. Côté IDFM, on estime que la priorité est de faire revenir les 20 % de voyageurs qui ont déserté les transports publics avec la crise. Dans ces conditions, annoncer une hausse des tarifs risquerait d’être contre-productif.
Philippe-Enrico Attal