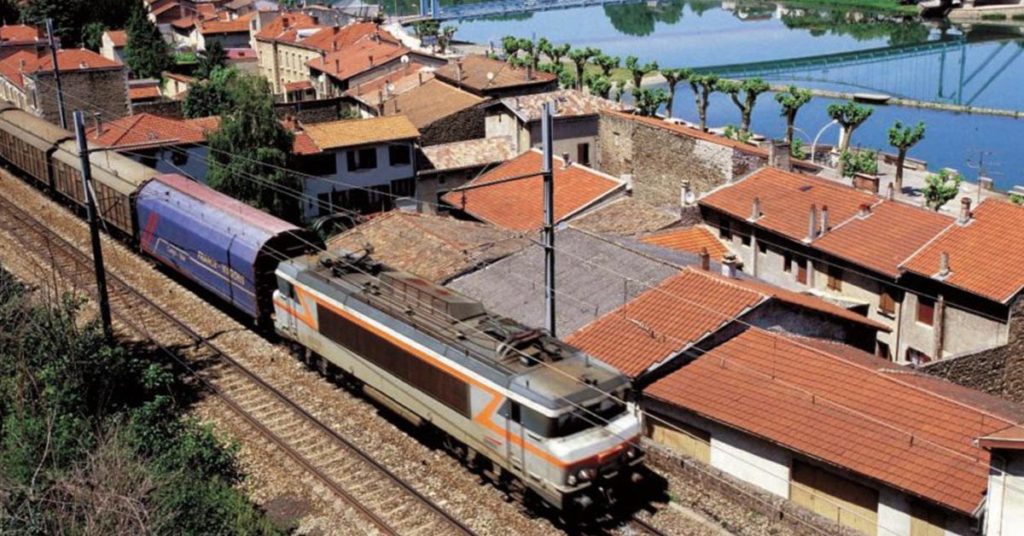Une bonne nouvelle pour le transport public. C’est le jugement de Thierry Mallet, le PDG de Transdev, également président de l’UTP (Union des Transports Publics), après l’accord annoncé hier soir entre l’Etat et Ile-de-France Mobilités pour éponger les pertes subies par les transports franciliens avec la crise sanitaire. « J’espère que l’accord entre IDFM et l’Etat servira de référence pour l’ensemble des transports publics », commente-t-il.
Les transports publics en province ont eux aussi subi de plein fouet la crise. Selon l’UTP, les recettes commerciales sont en chute libre : au total, les pertes sont estimées à deux milliards d’euros pour cette année. En ajoutant les pertes liées au Versement mobilités (taxe versée par les employeurs de plus de 11 salariés), estimées à deux milliards, l’addition approche les quatre milliards. Hors Ile-de-France, les pertes s’élèvent à 1,4 milliard d’euros.
Redonner confiance
Les opérateurs de transport ont également dû faire face à des coûts supplémentaires du fait des contraintes sanitaires (masques, nettoyages renforcés…). Thierry Mallet réclame donc à l’Etat un plan de soutien, sur le modèle de ce qui a été fait « en Allemagne, qui a débloqué six milliards d’euros pour les transports publics, aux Pays-Bas (1,5 milliard) ou aux Etats-Unis avec 25 milliards ».
Selon l’UTP, ce soutien devrait se traduire dès 2020 « par une compensation de la baisse du Versement mobilités et des pertes de recettes commerciales, un taux de TVA réduit à 5,5 % en 2021, un soutien adapté en 2021, en fonction de l’évolution des recettes fiscales et commerciales ».
Louis Nègre, le président du Gart, rappelle que toutes les données ont été fournies à Bercy sur les pertes financières enregistrées par les autorités organisatrices en province. « Bercy a reconnu la fiabilité de nos chiffres. Nous avons une base sur laquelle nous pouvons travailler », affirme le maire de Cagnes-sur-Mer. D’autant que maintenant, les exécutifs se sont mis en place, parfois avec retard suite aux élections municipales.
Louis Nègre invite aussi toutes les autorités organisatrices des mobilités à présenter des projets de transport qui pourraient entrer dans le plan de relance présenté le 3 septembre par le gouvernement. Les fonds apportés aux mobilités du quotidien dans ce plan se montent à 1,2 milliard d’euros. Ils s’ajoutent aux 400 millions d’euros qui étaient déjà budgétés pour les transports publics.
Enfin, autre enjeu pour le secteur, qui organise la semaine du transport public du 16 au 22 septembre ; il va falloir redonner confiance pour que les Français remontent à bord des transports en commun, sans crainte d’être contaminés par la Covid-19. Lors de la première semaine de rentrée, les taux de fréquentation ont oscillé entre 60 et 80 % selon les réseaux.
M.-H. P.