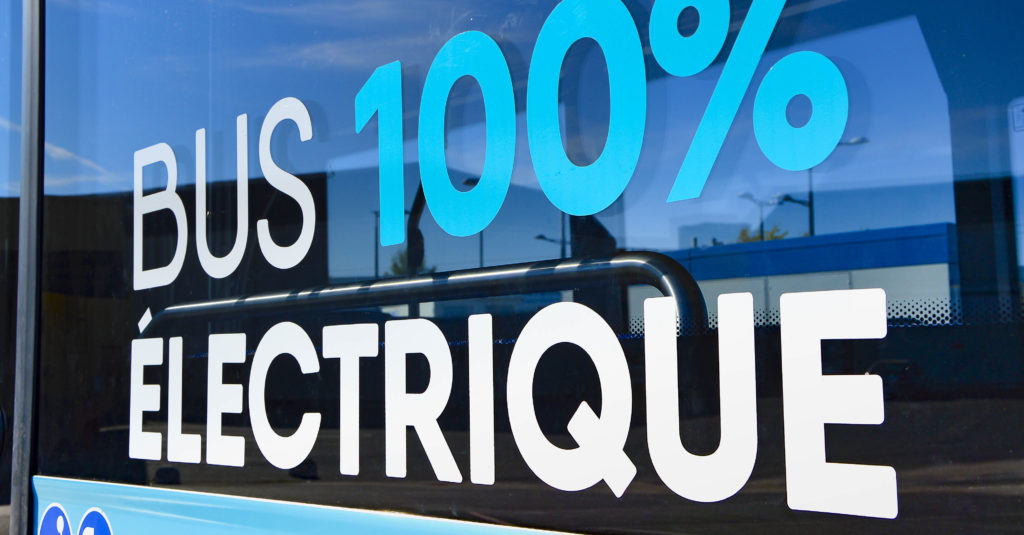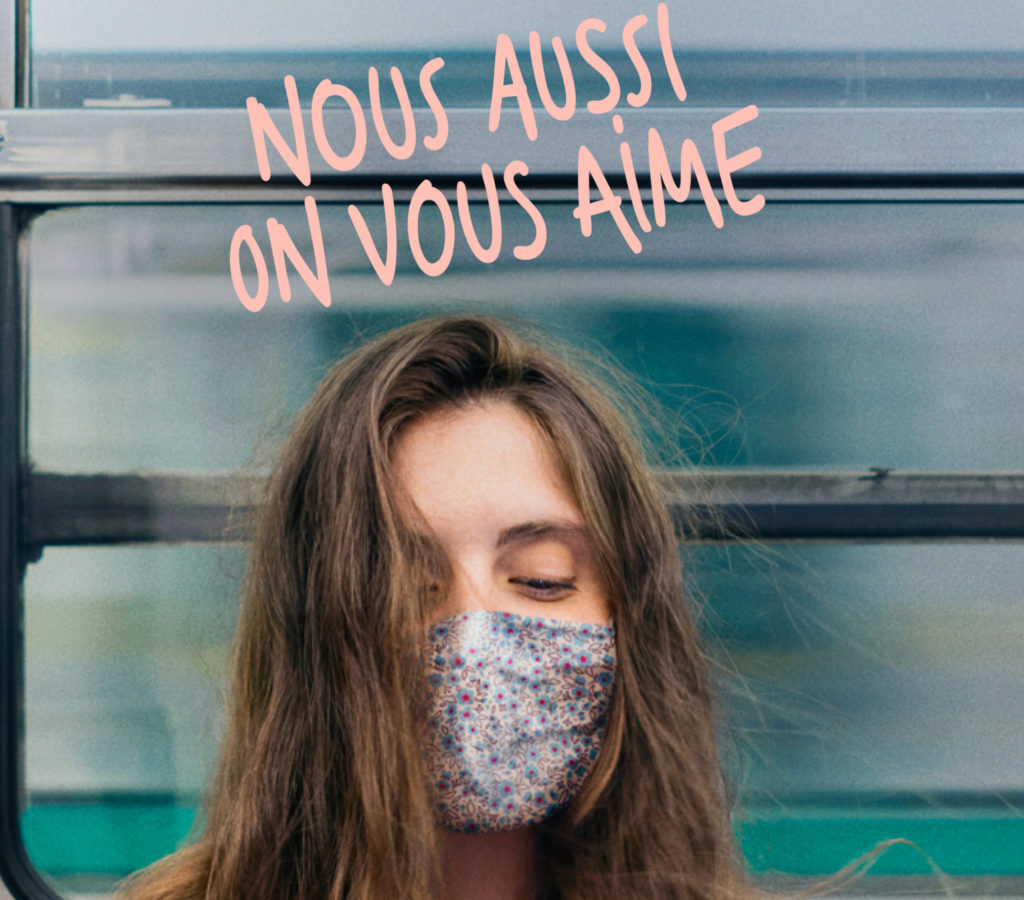La présidente de la région Ile-de-France (et d’IDFM) tacle SNCF Réseau, raconte les négociations avec la SNCF et la RATP, veut « doper » la politique vélo et s’exprime sur la reprise du transport aérien. Une interview organisée le 4 décembre, dans le cadre de l’AJTM (Association des journalistes des transports et des mobilités).
Après une année très difficile, comment s’annonce 2021?
Valérie Pécresse : La situation actuelle est tendue. La crise a privé les transports publics franciliens de 2,6 milliards d’euros de recettes. Soit 25 % du total.
Quand on perd 25 % de recettes, c’est compliqué. Pour compenser ces pertes, j’ai engagé un bras de fer avec l’Etat avec un triple objectif : ne pas baisser l’offre de transport, ne pas augmenter le prix du Pass Navigo (sinon on aurait dû l’augmenter de 20 euros) et maintenir notre plan d’investissement qui court jusqu’en 2028. Grâce à ce programme, tous les trains seront soit rénovés, soit neufs d’ici la fin 2021. Cela concerne plus de 700 rames.
Le gouvernement a accepté de verser en cash un milliard d’euros pour les pertes liées au versement mobilité et 1,6 milliard en avances remboursables (avec un remboursement plus important à partir de 2028, ce qui correspond à la fin de notre programme d’investissement).
Cette solution sert aujourd’hui de modèle aux autres autorités organisatrices des mobilités (qui réclament un plan de soutien au gouvernement, ndlr). J’avais essayé de les emmener avec moi au moment des négociations avec l’Etat mais cela n’a pas été possible, les élections en juin les ont désorganisées et elles attendaient l’arrivée des nouvelles équipes municipales.
Quel est le niveau de fréquentation des transports publics franciliens actuellement?
V. P. : En novembre, la fréquentation atteignait 35 % de niveau habituel,. La première semaine de décembre, ce taux est remonté à 40 %.
La sujet, pour la région, cela va aussi être de faire revenir les touristes. Ce qui passera notamment par la reprise des grands salons professionnels.
Le budget d’IDFM est-il encore menacé en 2021?
V. P. : Pour 2021, nous avons inscrit dans nos comptes un besoin de financement d’un milliard d’euros mais nous sommes encore dans le flou. Tout dépendra de la situation sanitaire et du vaccin. On considère que le virus impactera l’économie jusqu’en juin. Et les touristes ne reviendront pas avant l’été.
On peut aussi considérer qu’avec le télétravail et le lissage des pointes, la crise peut avoir un effet bénéfique sur les transports publics. S’il y a du télétravail un ou deux jours par semaine, je ne crois pas qu’il y aura un impact sur les recettes. Même quand on est en télétravail deux jours par semaine, on continue à utiliser les transports publics aller faire ses courses, emmener ses enfants à l’école ou se déplacer pour ses loisirs… Le pass Navigo dézoné est suffisamment attractif pour que les Franciliens continuent à l’acheter. Il y a une prise de conscience sur le fait qu’on doit pouvoir mieux utiliser les transports.
Mais pour moi, 2021 sera l’année de la qualité du service. Ce qui se retrouvera dans les nouveaux contrats de la SNCF et de la RATP.
Vous allez justement signer le nouveau contrat avec la SNCF le 9 décembre. Qu’est-ce qui va changer et où en êtes-vous du côté de la RATP, avec laquelle les négociations paraissent très tendues?
V. P. : On sait que je me bats et que je suis une négociatrice dure car je crois que les grands opérateurs de transport doivent mettre les clients au centre du jeu.
Dans le cadre de son nouveau contrat, la SNCF proposait la même offre de transport mais pour 200 millions d’euros de plus! C’est pourquoi ça a pris un peu de temps… On a changé la logique pour mettre les clients au coeur du contrat. En tant qu’autorité organisatrice, je suis la première cliente des opérateurs. Parmi les avancées, j’ai obtenu 100 millions d’euros de bonus-malus et un remboursement automatique des voyageurs quand le taux de régularité est inférieur à 80 % pendant au moins trois mois. En contrepartie la SNCF voulait récupérer 100 millions d’euros dans le montant de base du contrat… Aujourd’hui, le contrat avec la SNCF est un bon contrat.
Avec la RATP, on n’est pas en retard. On devait signer en décembre. Il n’est pas impossible que ça prenne deux ou trois mois supplémentaires. Les risques ne sont pas très élevés pour la RATP qui gagne beaucoup d’argent. C’est IDFM qui assume les risques et qui réalise les infrastructures.
Ni la RATP ni la SNCF ne peuvent se plaindre car nous sommes la seule région qui a un taux d’exécution de son contrat de plan Etat-Région atteignant 90% en décembre. Dans les autres régions, ce taux atteint 60 % en moyenne. Nous allons d’ailleurs devoir signer un avenant au CPER d’1,7 milliard pour 2021 et 2022 pour pouvoir continuer les travaux.
Nous nous sommes déjà mis d’accord sur les investissements : ils doubleront dans le prochain contrat SNCF et RATP. Mais prenez garde à ceux qui veulent remettre en cause le financement! Le budget de fonctionnement des transports publics franciliens atteint 10,8 milliards d’euros. Ce sera même 11,8 milliards avec le Grand Paris Express en 2030. On doit donc trouver 12 milliards par an. Il est impossible d’augmenter la contribution des entreprises. Si ce n’est pas les entreprises, qui paiera? Les contribuables? Allez expliquer aux Franciliens qui ont choisi de se déplacer en vélo de payer davantage d’impôts pour les transports publics… La qualité de l’infrastructure se paye. Il faut réfléchir à des recettes nouvelles.
L’appel d’offres pour Nexteo sera-t-il lancé en décembre comme vous le demandiez?
V. P. : Nexteo est voté. L’appel d’offres sera lancé avant la fin de l’année. Le problème maintenant, c’est qu’il faut que SNCF Réseau arrête d’être en retard sur ses chantiers et arrêtent d’avoir des surcoûts de 30 % comme sur Eole.
Nous avions proposé d’avoir un contrat avec SNCF Réseau comme nous en avons un avec Transilien. Mais c’est compliqué car le réseau ferré accueille aussi d’autres trafics, les trains grandes lignes, les trains de fret…
Mais on a un sujet avec SNCF Réseau, un vrai. 800 millions d’euros de régénération sont programmés par an sur le réseau francilien. Mais Réseau n’arrive pas forcément à les réaliser. Il est vrai qu’il doit aussi faire face à des commandes politiques. On lui demande par exemple d’accélérer Roissy-Picardie. Je ne sais pas combien cela concerne de passagers. Mais sur les lignes du RER B et D, on a 1,6 million de voyageurs par jour. Je ne veux pas jouer la grosse région Ile-de-France contre la petite Picardie, mais il faut donner la priorité aux lignes les plus fréquentées.
La commande du nouveau matériel roulant (MI20) pour le RER B se fait attendre. Qu’en est-il?
V. P. : Nous allons voter les crédits le 9 décembre. La RATP doit signer ce marché. Le vrai sujet, ce n’est pas les quelques semaines de retard éventuel de ce marché. Le vrai sujet, c’est la décision du tribunal administratif sur CDG Express. Nous avions obtenu de la SNCF et d’ADP que sur les 2 milliards d’euros du projet, 500 millions soient affectés au RER B. La décision du tribunal suspend non seulement les travaux sur CDG Express mais aussi les travaux sur le RER B (dont la reprise du pont de Soissons à Saint-Denis, indispensable non seulement à CDG Express mais aussi aux RER B). Maintenant l’affaire va aller devant la Cour d’Appel. J’ai écrit à la Cour d’Appel pour expliquer qu’il y a un intérêt primordial à régénérer le RER B avec les 500 millions. Si les travaux sont stoppés, il y aura un vrai retard. Tout le monde n’a pas bien vu les conséquences de cet arrêt qui ne concerne pas seulement les accès de l’aéroport mais aussi les 900 000 voyageurs du RER B Nord.
Quelle est votre réaction sur l’accord sur la gare du Nord entre Paris et la SNCF?
V. P. : Je suis extrêmement satisfaite et soulagée de la fin du blocage pour cette gare qui est en quelque sorte la porte de Paris. Le chantier va enfin pouvoir démarrer, sans sacrifier aux conditions de voyage ni aux ambitions du projet de modernisation de la gare. La région a toujours soutenu ce projet. Je ne pense pas que les commerces du quartier seront lésés.
Je suis satisfaite car on va doubler les escalators et les ascenseurs, ce qui va apporter une plus grande accessibilité à la gare. Et les voyageurs du quotidien ne perdront plus de temps dans leurs acheminements pour prendre leurs trains. Nous resterons vigilants sur ces questions.
Mais au départ, le projet était auto-financé. S’il y a moins de commerces, il y aura moins de recettes pour financer le projet…
Allez-vous poursuivre votre politique en faveur du vélo ?
V. P. : La pandémie, mais aussi avant les grèves à la SNCF et à la RATP, ainsi que l’arrivée du vélo électrique, ont permis de faire bondir l’utilisation du vélo. On recensait 650 000 trajets en vélo chaque jour en Ile-de-France il y a dix ans. Nous en attendons 2 millions en 2021.
L’utilisation accrue s’observe aussi en grande couronne où on ne pensait pas que cela arriverait. Plusieurs actions y ont contribué : les aides à l’achat d’un vélo électrique et le lancement des Véligo qui sont aujourd’hui au nombre de 20 000 et qui facilitent le passage à l’achat d’un vélo personnel. Je rappelle que les Véligo ont représenté le plus gros marché public européen passé pour des vélos électriques en location longue durée. En novembre, on avait versé 66 000 primes à l’achat d’un vélo électrique d’un montant de 500 euros. On en avait budgété 30 000. On va maintenir cette prime car on arrive à déclencher l’acte d’achat avec cette prime.
Pour qu’une politique vélo fonctionne, il faut pouvoir circuler en toute sécurité et disposer de parkings sécurisés. On travaille sur tous ces sujets. Avant la crise, le plan vélo était doté de 200 millions d’euros. Nous sommes en train de doper ce plan. La région veut aider les collectivités à financer leurs politiques en faveur de la bicyclette, comme c’est le cas du Val d’Oise qui travaille sur ses départementales. La région concentre ses efforts pour supprimer les discontinuités dans les cheminements : la subvention est passée de 2 millions à 6 millions d’euros pour supprimer les points bloquants.
Notre volontarisme a rencontré celui du collectif Vélo Ile-de-France qui nous a proposé le RER V. C’est-à-dire 9 lignes pour les vélos qui reprennent les trajets des grandes pénétrantes dans Paris. La région a pris le leadership pour la coordination du projet. Nous prévoyons aussi d’implanter un parking vélo dans chaque gare d’Ile-de-France, avec 140 000 places d’ici 2030. Et j’ai proposé 70 000 places sécurisées le long du tramway parisien.
Selon vous, quel modèle économique faut-il mettre en place pour les transports publics malmenés par la crise?
V. P. : Je suis peut-être déraisonnablement optimiste mais je crois à une vraie tendance de fond à la hausse pour les transports du quotidien. Je vous livre une anecdote : le patron de Vinci Autoroutes m’a raconté avoir constaté une baisse du trafic sur l’autoroute A86 juste après l’arrivée des nouveaux trains Franciliens sur la ligne L. Donc quand la qualité des transports publics s’améliore, on préfère les utiliser.
Je ne pense pas non plus que le transport aérien est mort. Les vols longs courriers vont continuer à augmenter. La Chine, gravement affectée par la crise du Covid, enregistre aujourd’hui un trafic aérien en hausse.
Je ne crois donc pas à une baisse à venir de la mobilité. C’est pourquoi je me mobilise sur la décarbonation des transports. Les véhicules électriques sont trop chers pour les particuliers. La région a donc décidé d’octroyer une prime de 2500 euros à tous ceux qui optent pour le rétrofit transformant une voitures thermique en véhicule électrique. Nous pensons qu’il va y avoir un changement des règles du jeu et nous souhaitons créer une filière industrielle autour de cette technique. C’est toute l’ambition de la reconversion du site de Renault à Flins qui a pour objectif de faire rouler des véhicules 1 million de km en les rétrofitant régulièrement. C’est une lutte contre l’obsolescence des voitures. Si un grand industriel comme Renault croit au rétrofit, c’est une bonne nouvelle. La région pourrait être pionnière en matière de recyclage industriel. Pour moi, c’est un très beau projet.
En parallèle, nous subventionnons aussi l’installation de bornes de recharge électrique sur notre territoire, avec l’objectif d’en tripler le nombre : Il y a 4000 bornes aujourd’hui, nous en aurons 12 000 d’ici à 2023.
Marie-Hélène Poingt