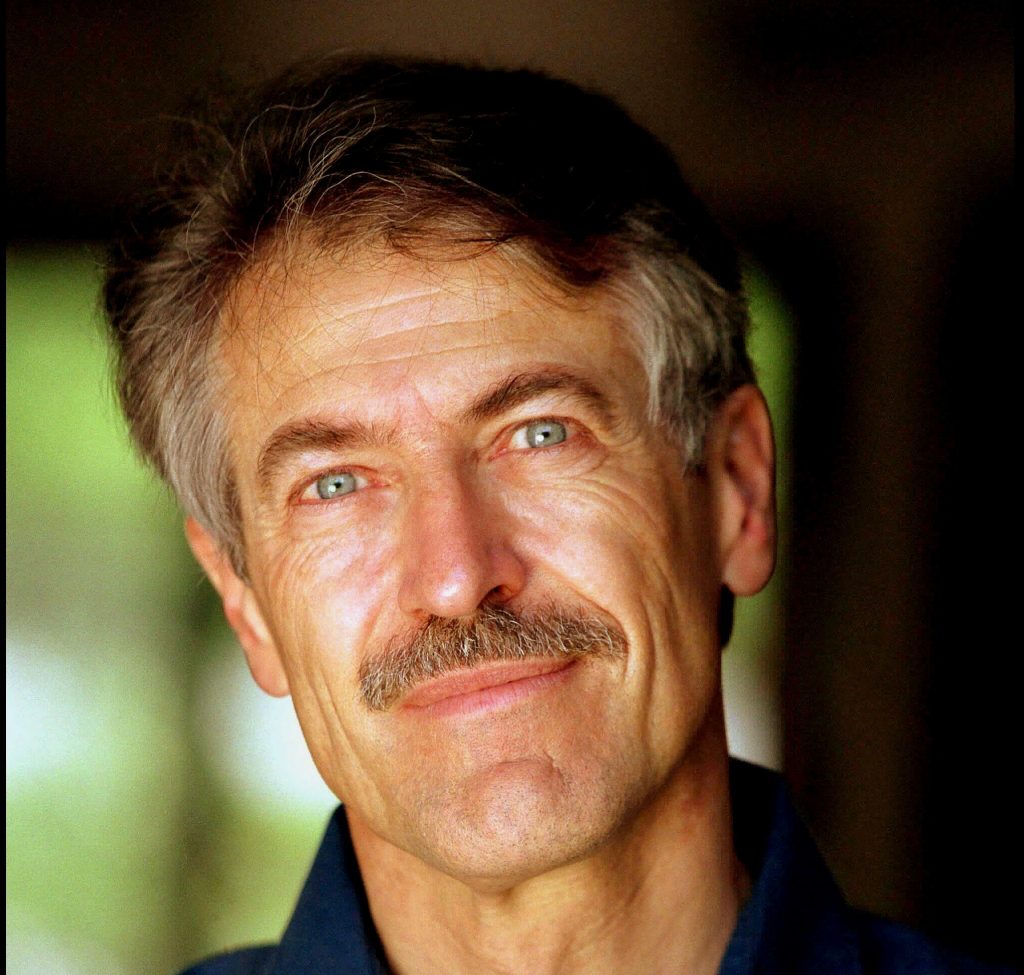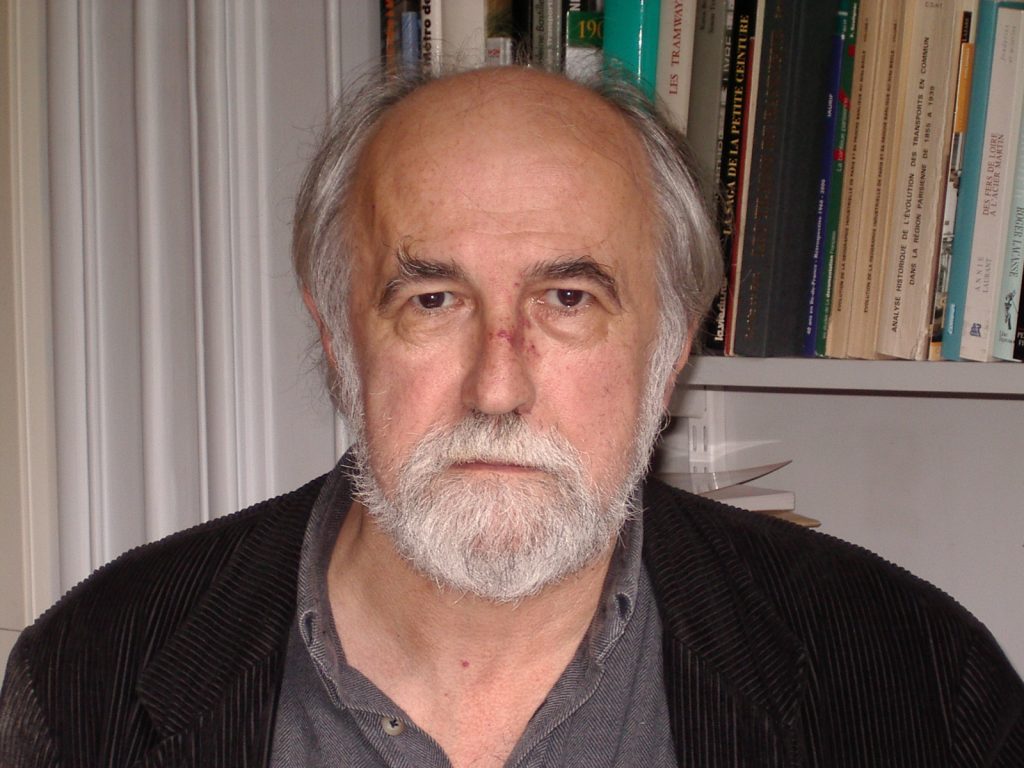Le vice-président du conseil régional de Bretagne, en charge de la mobilité et des transports, livre son analyse des Assises du ferroviaire qui viennent de se conclure. Outre le fait que « c’est plutôt la lutte fratricide entre SNCF et RFF qui a attiré l’attention de tous », il regrette qu’on n’ait pas pensé davantage à associer les régions quand il s’est agi d’imaginer une nouvelle gouvernance pour le système ferroviaire français. • Des assises pour quoi faire ?
Les Assises du ferroviaire se sont terminées le 15 décembre 2011 avec un bilan contrasté. Pourtant, le système ferroviaire français a besoin de réformes profondes pour sortir de l’impasse actuelle, qu’elle soit financière ou organisationnelle, mais aussi pour répondre aux enjeux de mobilité d’aujourd’hui et de demain. C’est vital pour les citoyens et les territoires. La France a besoin de réinterroger son modèle ferroviaire pour le mettre en phase avec ses propres ambitions publiques.
Les quatre commissions des Assises (Europe et Concurrence, Gouvernance, Economie, Filière industrielle) ont travaillé et émis des propositions. Parmi celles reprises par le gouvernement, citons l’expérimentation de l’ouverture à la concurrence pour les TET (trains Corail) et les TER en 2014, la maîtrise de la dette par la mise en sommeil des nouveaux projets d’infrastructures (Snit) pour rechercher de nouvelles méthodes d’évaluation des projets, une nouvelle étape de décentralisation avec des compétences renforcées des régions, et enfin un besoin de regroupement de tous les métiers en lien avec l’infrastructure, pour en finir avec les imbrications multiples ingouvernables.
• Ne pas confondre dette et investissements utiles !
On notera au passage que le gel des projets d’infrastructures nouvelles (Snit) au nom de la dite maîtrise de la dette constitue une illustration de la confusion entretenue entre endettement et réalisation de projets utiles aux populations, car, en réalité, avec des investissements nouveaux, bien maîtrisés par une vraie politique publique, ce ne sont pas des dettes que l’on transfère aux générations futures mais un capital utile pour les décennies à venir. Il est donc urgent aussi de reconsidérer cette question.
A ce stade, on notera aussi le silence sur la gestion de la dette (rien ne change, elle reste en l’état dans le système ferroviaire) et l’absence de propositions pour abonder le système avec de nouvelles sources de financement (versement transport régional, taxes nouvelles…). S’agissant de la dette, le ministère de l’Economie n’accepte pas une réintégration au sein des comptes publics de l’Etat. On paie aujourd’hui l’hypocrisie d’hier sans jamais assainir les finances du ferroviaire, condition pourtant indispensable pour mettre en œuvre des perspectives de développement.
• Des thématiques absentes du débat
Alors que l’on pouvait penser que les débats allaient se cristalliser sur l’ouverture à la concurrence, c’est plutôt la lutte fratricide entre SNCF et RFF qui a attiré l’attention de tous. La SNCF défendant un modèle complètement intégré avec un pilote unique, RFF préconisant plutôt une séparation forte entre le gestionnaire d’infrastructure et le transporteur. L’Etat a renvoyé tout le monde à ses chères études, en demandant des travaux complémentaires pour rechercher une 3e voie avec comme critères essentiels énoncés : haut niveau de sécurité, compatibilité européenne, capacité des pouvoirs publics à intervenir, gagner des marchés à l’export, tenir compte de la particularité des personnels cheminots.
• Ne pas céder aux tentations libérales !
Dans ce panorama composite et encore incertain, la tendance naturelle des tenants du libéralisme est de rechercher des alternatives du côté des options créant l’illusion de recettes nouvelles pouvant parvenir du marché et de la mise en concurrence. Mais parmi les hypothèses à explorer, il faudrait d’abord permettre aux régions d’apporter leur vision pourtant si précieuse des nouveaux enjeux de mobilité et permettant de replacer le ferroviaire, avec les autres modes de transports collectifs, au centre du jeu.
Avant le débat sur le choix des solutions techniques (organisationnelles ou financières) à mettre en place et à partir de son expérience, la Bretagne souhaite qu’il soit tenu compte des principes fondateurs auxquels elle croit fondamentalement pour poser les bases de la refondation du système ferroviaire. Région périphérique, caractérisée par une réalité économique peu captive et sa péninsularité, la Bretagne est très attachée à un modèle ferroviaire fiable, sécure et unitaire ; elle est également attachée à l’exemplarité sociale et au respect du statut des cheminots ; mais, à la lumière de son expérience, elle est en droit d’exprimer dès réserves dès lors que l’on évoque le pilotage de tout l’ensemble ferroviaire par dévolution à un seul acteur ; elle est encore plus hostile, quand certains expliquent les vertus d’une séparation totale, ouverte à la concurrence, sans pilote identifié, chargé de gérer l’ensemble. Les raisons de ces réserves sont illustrées par certaines situations vécues ; on peut ainsi constater, d’une part, ce qu’il est advenu de l’abandon de toute ambition en matière de fret ferroviaire et, d’autre part, ce qu’il en est de la difficulté récurrente à mettre en œuvre les politiques de dessertes et de respect des horaires découlant de l’incapacité du gestionnaire des infrastructures de garantir les conditions de réalisation de travaux.
• Quand la tentation libérale génère une gouvernance aberrante et impossible !
On ne dénombre plus la multiplicité des structures de gouvernance rendant opaques et injustes les décisions en matière de stratégie de développement du ferroviaire. Réseau ferré de France (RFF), qui assure la maîtrise d’ouvrage de la réalisation et de la maintenance des infrastructures en mettant de plus en plus à contribution les finances des collectivités, et singulièrement des régions, fixe, en accord avec l’Etat, les tarifications des « sillons ». Mais la méthode utilisée consiste à facturer plus cher les infrastructures modernisées et financées par ces mêmes collectivités ; or ce sont aussi ces mêmes collectivités qui compensent le financement des TER ! Au fond, donc, plus les collectivités financent la modernisation des infrastructures et plus elles paient cher l’usage qui en est fait en matière de service public, sans que jamais leur avis soit sollicité !
Côté régulation et transport proprement dit, c’est une nouvelle instance (Araf) qui est réputée fixer les contours de ce qui est juste et déontologique en matière ferroviaire, mais les grandes absentes de celle-ci sont les instances publiques qui assurent une part non négligeable des financements.
Côté transporteur SNCF, de nouvelles instances se mettent en place, telle que Gares & Connexions, direction aux contours comparables à une filiale qui rémunère le capital qu’elle consacre à ses investissements à hauteur de 9 % !
Cette institution, qui assure très partiellement le financement de la modernisation des gares, ne parvient à rémunérer le capital investi à hauteur de 9 % qu’en imposant des tarifs d’usage du passage des trains et des voyageurs en gare à des tarifs élevés ; une fois encore, après que les collectivités ont participé au cofinancement de la modernisation des gares, ces dernières sont appelées à payer plus cher les prestations découlant des dessertes qu’elles mettent en place et qu’elles financent ! Les collectivités paient donc deux fois : une fois en investissements et une autre fois à l’usage !
Côté fret ferroviaire, la gouvernance de la stratégie est, de fait, sous la dépendance du groupe Geodis, ce qui aboutit naturellement à un positionnement stratégique de captation de marché plutôt qu’à une stratégie de développement des territoires ! La démonstration est donc faite que cet émiettement des gouvernances, aux connotations libérales, est générateur de gaspillages et d’inefficacités.
• La vraie question politique est celle de l’ambition publique !
La vraie question est celle de l’ambition publique et de la maîtrise par la puissance publique du système ferroviaire. Ce système ferroviaire auquel les Français sont très attachés appartient à la nation, et les élus doivent pouvoir rendre des comptes aux citoyens sur la nature et la qualité du service qui est proposé. N’est-il pas temps d’arrêter le processus d’émiettement des activités consistant à filialiser et à morceler toute une série d’activités ? Autorité de régulation du ferroviaire, Gares & Connexions, Fret SNCF… ces seuls exemples suffisent pour démontrer que le pilotage de l’ensemble ne peut pas être délégué à un tiers ; il doit être organisé par l’Etat et les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les régions. C’est la seule garantie pour que les intérêts collectifs soient préservés et que l’accès à la mobilité ferroviaire pour chaque citoyen ne soit pas soumis aux aléas des simples logiques de marchés des opérateurs quels qu’ils soient. Toutefois, le système a besoin d’unicité et de cohérence en matière de travaux, de sécurité et de fiabilité et de tarifications. Aujourd’hui, RFF, qui porte la dette de près de 30 milliards, emploie environ 1 500 salariés. Par ailleurs, ce sont près de 5 500 cheminot(e)s qui assurent les prestations de programmation des travaux, de gestion, d’organisation et d’élaboration des horaires. Pour des raisons d’efficacité et de sécurité, l’ensemble de ces missions doivent être assurées dans un cadre unique et cohérent. Ce qui semble le plus aisé et le plus efficace serait de verser l’ensemble de ces missions au sein d’un service unique de la SNCF ; mais ceci ne règle pas la question de la gouvernance ni la question de la dette ! Avec l’embarras encombrant que génère la dette et le refus de s’y attaquer, la tentation est grande de suggérer de verser l’ensemble de ces missions au sein de RFF. Mais dans les deux cas la question de fond posée est bien de savoir si oui ou non il y a lieu de mettre en place une gouvernance publique, assumant de part en part l’ensemble des décisions et dispositions organisationnelles s’y rapportant et cela est possible en respectant l’unicité du statut social des cheminot(e)s.
• Un choix de vérité et d’efficacité
Cette volonté affichée de pilotage par la puissance publique n’est pas synonyme de dérive financière ; elle s’inscrit dans un principe de réalité économique pour agir en responsabilité, y compris sur la maîtrise de la dette. Alors que le gouvernement ne gère la dette que par la réduction des dépenses, nous pensons qu’il faut agir simultanément sur les dépenses et les ressources. Si on veut redonner toutes ses chances au développement du ferroviaire en réponse aux attentes des populations, il faudra bien affronter le traitement de la dette historique pour apurer le système.
• Pour une ambition publique nationale et décentralisatrice
Redonner la prédominance de la gouvernance aux acteurs publics se conjugue aussi avec le rapprochement des lieux de décision au plus près des territoires. Les solutions à mettre en œuvre en Alsace ne sont pas nécessairement les mêmes que celles convenant à la Bretagne. Notre modèle centralisé est à ajuster, ce n’est plus à Paris que toutes les décisions doivent se prendre. Les exemples sont nombreux pour démontrer l’inefficacité de ce modèle, que ce soit à SNCF Proximités, qui filtre toutes les initiatives des directions déléguées TER, ou à RFF, qui dispose de peu d’autonomie en région et renvoie à sa structure centrale la plupart des prises de décisions. Pour de nombreux sujets, c’est à la région, autorité organisatrice du transport régional, en concertation avec les collectivités locales, de traiter directement avec SNCF et RFF pour décider du bien fondé des actions à mettre en place localement. Si besoin, la Bretagne est prête à expérimenter une nouvelle forme d’organisation qui donnerait sens à cette ambition publique permettant de proposer un service ferroviaire de qualité, moderne et adapté aux besoins de tous et de tous les territoires.
Mais cette nouvelle phase d’une décentralisation ferroviaire appelle aussi une grande ambition publique nationale pour que l’Etat et les régions assument pleinement leurs responsabilités en matière de gestion de la dette, de fixation des tarifs d’usage des infrastructures, de missions de dessertes du territoire et de stratégie de développement du ferroviaire.