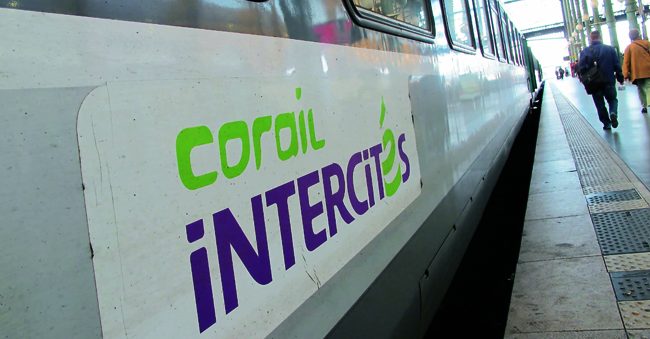
Rendue inéluctable par le règlement européen OSP, la concurrence dans le transport de voyageurs implique une règle du jeu sociale harmonisée. Entre la SNCF et les nouveaux entrants, la guerre de position a commencé. C’est dans un « cadre social harmonisé » que doit être réalisée l’ouverture du marché ferroviaire de voyageurs : l’expression figure dans la nouvelle lettre de mission adressée le 14 février par le président de la République à Guillaume Pepy. Aussi, le 18 février, s’appuyant sur des termes qui étaient en fait déjà les siens, le président de la SNCF a-t-il adressé une lettre à Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l’Ecologie, pour demander à l’Etat d’assurer le « cadrage », avant le « démarrage » de la négociation concernant ce marché.
Car la grande peur de la SNCF, c’est que l’ouverture à la concurrence se fasse dans le transport de voyageurs comme elle s’est faite dans le fret ferroviaire. Le président de la SNCF souligne, dans cette lettre dont nous avons eu copie, que, dans le fret, « les régimes de travail mis en place après négociation entre partenaires sociaux et entérinés par le décret du 27 avril 2010 ont institué un régime à deux vitesses, caractérisé par d’importants écarts de traitement entre les salariés du secteur privé et de la SNCF. Ces écarts de traitement induisent une profonde iniquité juridique, économique et sociale, difficilement supportable à terme par notre entreprise et ses personnels ».
Or, aujourd’hui, écrit Guillaume Pepy, « l’organisation patronale du secteur, l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), estimerait nécessaire d’ouvrir, avec les organisations syndicales représentatives de la branche, de nouvelles discussions sur l’organisation du travail dans le transport international de voyageurs, ouvert depuis décembre 2009 à la concurrence. » La SNCF réagit d’autant plus que « cette négociation influera en pratique sur le contenu des négociations à venir, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs sous contrat de service public (transport régional et trains d’équilibre du territoire) ».
Pour la SNCF, « la volonté de l’Etat d’assurer un “ cadre social harmonisé ” exige, en préalable à l’ouverture de toute discussion, l’affirmation de sa part, vers les parties prenantes, que le champ d’application des négociations à venir doit couvrir l’ensemble des salariés et des opérateurs du secteur ».
Cette décision de l’Etat permettrait, juge-t-il, d’éviter un développement de la concurrence fondé sur le seul « dumping social ».
Pour Guillaume Pepy, « la négociation sur le régime de travail commun et harmonisé doit s’appliquer aux cheminots de toutes les entreprises ferroviaires, en recherchant des facteurs d’amélioration tout en se référant aux règles en vigueur aujourd’hui au sein de l’opérateur historique – notamment dans leur contribution à la sécurité des circulations ferroviaires ».
L’Afra a vivement réagi par un communiqué de presse le 28 février. L’Association française du rail, qui regroupe « les entreprises ferroviaires nouvelles entrantes sur le marché français » (ECR, Trenitalia, Veolia), juge que « la proposition d’un cadrage préalable du dialogue social et d’une supervision par le gouvernement est inacceptable ». Pour l’Afra, « il faut donner sa chance au dialogue social comme cela a été le cas pour la convention collective du fret ».
Quant à l’expression « cadre social harmonisé », l’Afra la reprend à son compte, mais ne l’entend pas de la même oreille que Guillaume Pepy. Elle déplore que « le président de la SNCF interprète cette orientation en exigeant que la négociation couvrant l’ensemble des salariés et des opérateurs du secteur se réfère aux seules règles en vigueur aujourd’hui au sein de l’opérateur historique ».
En outre, toujours selon l’Afra, « cette approche ne tient absolument pas compte des avantages dont bénéficie la SNCF dans le cadre actuel des appels d’offres : connaissance du marché, contrôle des réseaux commerciaux, maîtrise de la gestion des circulations et des gares. Il s’agit donc pour l’entreprise publique d’obtenir un avantage supplémentaire injustifié ».
Sur les deux derniers points on suivra avec intérêt les interventions de l’Araf, l’Autorité de régulation, dont le président, Pierre Cardo, ne cache pas ses doutes sur la viabilité au regard des autorités de la concurrence du système récemment mis en place, pour Gares et Connexions, et même pour la direction de la circulation ferroviaire (DCF), activités qui chacune à sa manière restent intégrées à la SNCF.
Toujours est-il que, pour l’Araf, « une approche qui consisterait à appliquer aux nouveaux entrants les équilibres propres à la SNCF serait la négation même du principe de concurrence ». Les nouveaux entrants sont d’autant plus virulents que le premier marché concerné par les discussions qui vont s’ouvrir sera le transport international de voyageurs, qui, exploité en open access, comporte un risque financier important. Ils soupçonnent en outre la SNCF de vouloir, dès qu’elle aurait fait passer un alignement des conditions de travail sur les siennes dans le transport de voyageurs, revenir sur le volet fret de la convention collective conclu en 2007. Bref, la volonté claironnée de l’harmonisation se manifeste par des désaccords criants.




