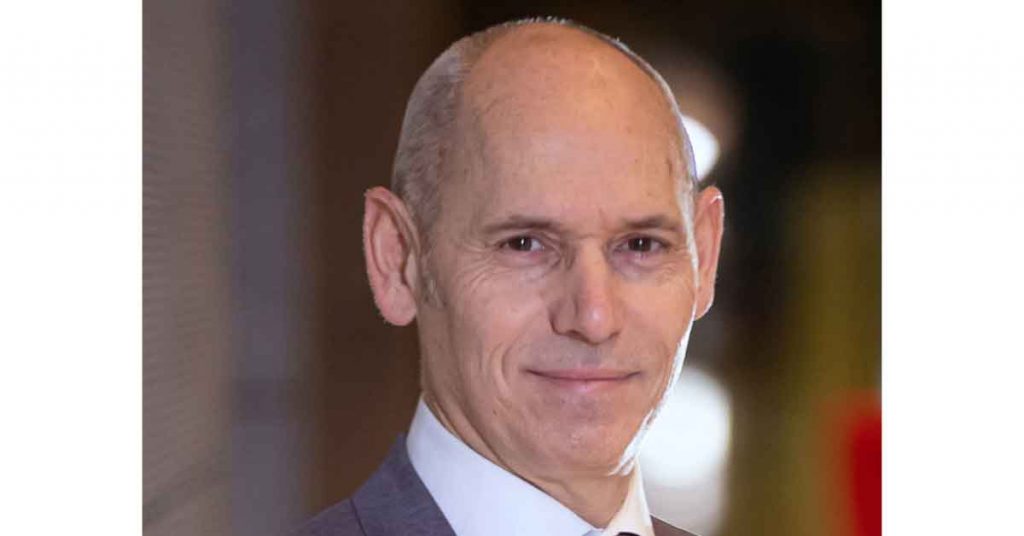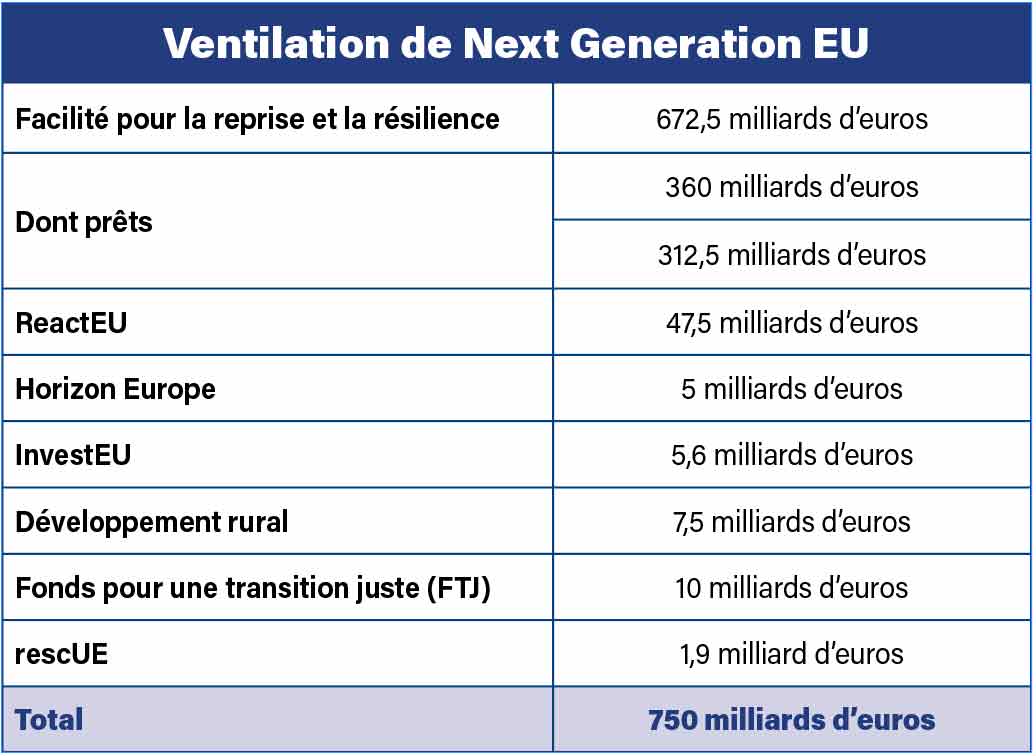Après avoir fait une grande partie de sa carrière dans le secteur du transport de marchandises et de la logistique, Sylvie Charles est depuis mars 2020 à la tête de Transilien. Invitée du Club VRT le 18 février, cette diplômée de Sciences Po et de l’ENA a expliqué comment elle compte transformer la crise sanitaire en opportunités pour le transport de voyageurs en Ile-de-France.
Transilien, qui exploite les trains et RER de banlieue en Ile-de-France, est l’un des plus importants systèmes de mass transit du monde. L’entreprise transporte 70 % des voyageurs de la SNCF sur seulement 10 % du territoire. Soit 3,4 millions de voyageurs chaque jour dans 6 200 trains.
Depuis les années 2000, l’Ile-de-France connaît une concentration des emplois. Le quartier des affaires à Paris en compte 600 000, La Défense 300 000. Ces pôles d’emplois très localisés, que l’on trouve aussi à Plaine Commune ou à Issy-Boulogne, se caractérisent par un poids prépondérant des cadres et sont touchés par une baisse de fréquentation des transports publics plus importante qu’ailleurs dans la région. « On a une polarisation de l’emploi à Paris et en première couronne, tandis que le logement se développe en petite et grande couronne. D’où un énorme besoin de transports capacitaires pour faire fonctionner la région », rappelle Sylvie Charles.
Les Franciliens utilisent les transports publics pour se rendre au travail ou aller étudier, profitant d’une solution rapide et fiable. Une étude de l’Institut Paris Région, réalisée avec Transilien avant la Covid, a démontré, en suivant des voyageurs avec les données GPS de leur smartphone, qu’ils mettaient 17 minutes de plus en voiture qu’en train pour se rendre d’Argenteuil à Paris. Pour être sûrs d’être à l’heure, les automobilistes doivent prévoir 40 minutes de marge. Cette performance explique la part de marché du transport public : de 65 à 80 % le matin. Mais les Franciliens utilisent moins les transports pour sortir ou faire leurs courses. Sylvie Charles l’explique par la surfréquentation de certaines branches aux heures de pointe, qui a un effet désincitatif. Elle voit dans la crise sanitaire et l’expansion du télétravail, des possibilités d’évolution positive. « Dans une région où 45 % des emplois sont télétravaillables, nous avons la conviction que le recours au télétravail pourrait avoir des effets bénéfiques pour les voyageurs sur leurs trajets quotidiens, et qui auront peut-être envie de prendre le train pour d’autres usages le week‑end, pour leurs loisirs par exemple », commente-t-elle.
Télétravail et lissage des pointes
Depuis le premier confinement, l’opinion sur le télétravail a évolué : 90 % des adhérents du Medef Ile-de-France affirment désormais vouloir l’appliquer deux jours par semaine. « La généralisation de deux jours de télétravail répartis sur la semaine, pourrait faire baisser la pointe du matin de 6 à 13 % », assure Sylvie Charles.
“ LA GÉNÉRALISATION DE DEUX JOURS DE TÉLÉTRAVAIL, RÉPARTIS SUR LA SEMAINE, POURRAIT FAIRE BAISSER LA POINTE DU MATIN DE 6 À 13%. ”
Sans remettre en cause la nécessité de certains investissements, cela permettrait de réduire la surfréquentation à certaines heures et offrirait la possibilité à Transilien de proposer de meilleures conditions de transport. Pour plus d’efficacité, la directrice de Transilien souhaite, en complément, lisser les heures d’arrivée et de départ du travail. « Les DRH qui travaillent sur la qualité de vie au travail, ne regardent que ce qui se passe au bureau. Nous discutons avec eux pour les inciter à prendre également en compte la façon dont les salariés s’y rendent. »
Parvenir à décaler les arrivées implique de modifier les habitudes. L’époque y semble favorable. Forts de l’expérience du confinement, les cadres ont pu se rendre compte que, pour certaines tâches, leurs équipes travaillaient mieux chez elles, au calme.
De leur côté, les salariés apprécient de gagner en qualité de vie, en limitant leurs déplacements domicile-travail. Associer télétravail et lissage des horaires de travail, en jouant sur des arrivées reculées d’une demi-heure par exemple, ferait la différence. « Si seulement 10 % des salariés décalaient leurs heures, cela permettrait de réduire le trafic aux heures de pointe, et donc de bénéficier d’un voyage beaucoup plus agréable », affirme Sylvie Charles, convaincue que certaines pratiques mises en place avec la Covid-19 vont perdurer. Transilien prévoit notamment de poursuivre ses efforts en matière de propreté. « Actuellement, pas une rame ne sort sans être nettoyée et désinfectée. » Les mesures de désinfection des trains coûtent 15 millions d’euros par an à l’entreprise. « Mais nos rames sont aussi plus propres en raison de l’interdiction de manger et de boire et en raison de l’obligation du port du masque. » La directrice de Transilien s’interroge sur la poursuite de cette interdiction, qui continuerait à rendre le transport public plus propre et confortable. Cette réflexion est en cours avec les associations d’usagers.
Le voyageur peut aussi être cofacteur d’un déplacement plus agréable, en participant à la baisse du trafic en heure de pointe : Transilien travaille en effet sur une expérimentation de type « Waze » des transports sur la ligne L. « Cette application leur permet de connaître la fréquentation des trains, afin qu’ils puissent éventuellement laisser passer un train trop chargé et prendre le suivant. La généralisation des espaces de coworking dans les gares permet d’y travailler confortablement, en attendant l’arrivée d’un train moins fréquenté, pour voyager dans de meilleures conditions », explique Sylvie Charles.
Reconquête des voyageurs
Malgré ses forces et son évidence en Ile-de-France, le transport de masse vit une période difficile. Avec 45 % de recettes en moins, la crise a lourdement impacté la fréquentation des trains et donc le financement des opérateurs de transports. « En septembre et octobre, le trafic est remonté à 70 % de son niveau habituel. Mais, avec le deuxième confinement et le couvre-feu, nous sommes retombés à 50 % de fréquentation », rappelle la dirigeante. Le Versement mobilité, qui représente 52 % du financement du transport public, a aussi chuté en raison de l’activité partielle et du chômage. Toutefois, en 2020, après négociation de Valérie Pécresse, l’Etat a accepté de le compenser et de réaliser une avance remboursable à IDFM pour la perte des recettes.
Sur les premiers mois de 2021, Sylvie Charles s’attend à une baisse des recettes de 35 à 40 % et espère un rebond par la suite, tout en prévoyant que la situation restera compliquée jusqu’à la généralisation des vaccins. Elle rappelle que les recettes voyageurs contribuent à hauteur de quatre milliards d’euros aux 10 milliards nécessaires au fonctionnement des transports franciliens et revient sur les déclarations sur la gratuité. « Il faudrait compenser ces recettes. Les concitoyens doivent être conscients du fait que rien n’est gratuit. Si on les supprime, il y aura soit moins d’offres, soit plus d’impôts. »
Pourrait-on envisager une nouvelle tarification prenant en compte le télétravail ? « Lorsqu’on va trois jours par semaine au bureau, un pass Navigo reste intéressant », répond Sylvie Charles. L’objectif reste la reconquête des voyageurs. Pour les convaincre que le train est plus sûr et performant que la voiture, Transilien sécurise les transports, veille aux gestes barrières et incite à mieux se répartir dans les rames.
L’entreprise n’hésite pas non plus à verbaliser ceux qui ne respectent pas le port du masque. « Il est de notre devoir de rassurer, car les transports publics ont été suspectés d’être des lieux de contamination, alors que toutes les études réalisées en France et à l’étranger ont démontré que ce n’était pas le cas », assure la directrice.
Nouveau contrat avec IDFM
En fin d’année dernière, Transilien et IDFM ont (enfin) signé un nouveau contrat d’exploitation et d’investissements qui les engage jusqu’en 2023. Un contrat de 12 milliards d’euros, conclu avec un an de retard. « Il était bon de mettre fin à cette situation », souligne Sylvie Charles, qui justifie le temps pris pour y parvenir : « l’Autorité organisatrice avait des demandes légitimes, mais l’exploitant a dû lui expliquer le contexte dans lequel il exerce son activité, afin qu’il soit pris en compte. »
Ce nouveau contrat affiche de fortes ambitions en matière de production et de qualité de service. Avec un système de bonus-malus plus important que précédemment. « Nous étions d’accord sur le fait de viser la régularité à 95 %. Mais IDFM nous demandait de prendre cette responsabilité en grand. » Transilien souhaitait que soient prises en compte les causes d’irrégularité liées à tout ce que l’exploitant ne maîtrise pas, comme l’infrastructure ferroviaire vieillissante ou le contexte sociétal.
« Nous avons obtenu une augmentation de la contribution qui nous est versée, car, en 2019 IDFM a développé de nombreuses innovations et, en 2020, nous avons eu un effet année pleine. Il s’agit aussi de compenser le fait que le nouveau matériel roulant coûte plus cher en maintenance que l’ancien, en raison de la présence de plus d’électronique et de la climatisation notamment », détaille Sylvie Charles. Elle ajoute : « la discussion a été longue mais nous avons trouvé un équilibre satisfaisant pour tout le monde. »
“ LE CHALLENGE DE L’OUVERTURE À LA CONCURRENCE FERROVIAIRE POSE LA QUESTION DE L’ÉQUILIBRE QUE L’ON CHERCHE : VEUT-ON CONTINUER À AVOIR DES EXPLOITANTS AYANT LA CAPACITÉ DE FINANCER DES SAVOIR-FAIRE ET À INNOVER ? OU VEUT-ON CES SAVOIR-FAIRE DU CÔTÉ DE L’ORAGNISME QUI A LA CHARGE D’ORGANISER LES TRANSPORTS ? ”
Ce contrat court jusqu’à 2023, date du début effectif de la concurrence. « Les trams-trains seront les premiers ouverts à la compétition, parce que leur exploitation est plus facilement « détourable ». La partie plus compliquée arrivera après », prédit la directrice de Transilien. Elle poursuit : « ce sera un challenge intéressant, qui pose la question de l’équilibre que l’on cherche : veut-on continuer à avoir des exploitants ayant la capacité de financer des savoir-faire et à innover ? Ou veut-on ces savoir-faire du côté de l’organisme qui a la charge d’organiser les transports ? », souhaitant éviter de « transformer les exploitants en useurs de pneus ».
Les promesses des systèmes de commandement
Si l’implantation de NExTEO est du ressort de SNCF Réseau, Transilien s’intéresse à ce système d’automatisme de contrôle et de supervision qui devrait permettre d’améliorer la régularité et de faire passer davantage de trains. Son premier terrain d’application sera le tronçon central du futur RER E, entre Nanterre et Pantin.
Pour la patronne de Transilien, l’intégrer dans le système est un challenge. « Il faudra faire correspondre entre eux plusieurs systèmes de communication différents. En tant qu’exploitant, on suit cette possibilté de près, car cela aura un impact sur l’exploitation. Notamment sur les gestes de conduite. On est intéressé, car c’est une des briques qui permettra d’améliorer notablement les lignes B et D à partir de 2027. »
Deux lignes le long desquelles sont construits 25 000 logements nouveaux par an et dont la fréquentation a beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Posant des problèmes de régularité quand les arrêts prévus pour durer 30 secondes dépassent la minute. « Le RER NG qui devrait arriver pour la ligne B fin 2025, si Alstom devient raisonnable, permettra aussi d’améliorer le service. »
Cette ligne B est coexploitée par la RATP et la SNCF, tandis que la D est uniquement gérée par Transilien. Mais toutes deux ont la particularité d’avoir un tunnel commun entre Gare de Lyon et Gare du Nord. « Le tunnel dispose de trois gestionnaires, ce qui complique la situation pour l’exploitant : il y a la RATP, au Sud il y a SNCF Réseau Sud et au Nord SNCF Réseau Nord. Un centre de commandement unique faciliterait la situation », estime Sylvie Charles. « Quand il existe différentes parties prenantes, il faut qu’elles travaillent ensemble pour bâtir des scénarios en fonction de différents aléas », ajoute-t-elle.
Le défi des JO
En 2024, Paris accueillera les JO. A cette occasion, Transilien sera soumis à une forte croissance de trafic durant quelques semaines. « C’est une grande responsabilité. Nous devons travailler à bien accueillir une clientèle atypique, parlant toutes les langues. Nous devrons aussi faciliter les accès pour les Jeux paralympiques », prévoit Sylvie Charles, qui précise que ces efforts serviront au-delà des Jeux. Ce challenge est finalement habituel en Ile-de-France, première région touristique au monde. « Relever des défis, c’est notre quotidien. J’ai la chance d’avoir une équipe de très bons professionnels pour y répondre. Et c’est ensemble que nous voulons faire de la pandémie une chance pour le transport public », conclut-elle.
Valérie Chrzavzez-Flunkert
Place aux vélos !
En Ile-de-France, les trains roulent sur des lignes déjà quasiment toutes électrifiées. Pour réduire encore son impact carbone, une démarche est mise en place par Transilien, allant de l’écoconduite, à l’écostationnement en passant par l’isolation des bâtiments ou le retraitement des eaux des stations de lavage.
Côté intermodalité, Sylvie Charles souhaite favoriser l’accès des vélos en gares. Elle reconnaît qu’un gros travail reste à faire. Car si 90 % des habitations et des emplois sont à moins de trois kilomètres d’une gare, seuls 2 % des Franciliens y vont à vélo. La marge de progrès est donc large et passe notamment par la mise à disposition d’abris sécurisés et la création de pistes cyclables pour organiser le rabattement vers les gares.