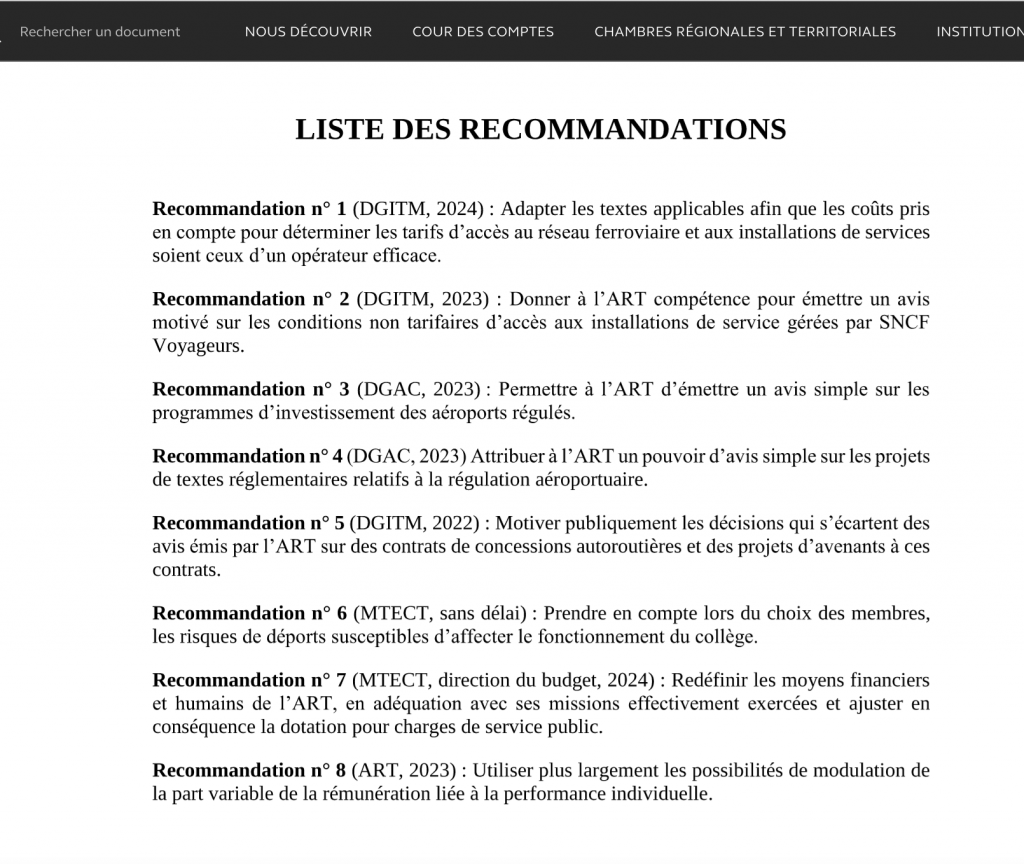Pierre Moscovici et son assemblée de magistrats financiers ont visiblement décidé de mettre les pieds dans les plats. Dans son rapport annuel publié le 12 mars, la Cour des comptes ausculte pour la première fois les politiques publiques consacrées à l’adaptation au réchauffement climatique. Et elle est très sévère avec l’Etat et les collectivités, soulignant « la nécessité que l’action publique en faveur de l’adaptation au changement climatique soit transparente, cohérente et efficiente ».
La veille, l’institution de contrôle financier publiait un autre rapport, sectoriel, sur l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF France. Et elle n’est pas tendre non plus. Qualifiée de « faible valeur ajoutée » (…) L’Agence de financement des infrastructures de transport de France, établissement public administratif créé en 2004, gère un montant d’investissements important (3,3 Md€ en 2022), mais n’emploie que cinq équivalents temps plein, reste étroitement subordonnée à l’administration centrale », matraque le rapport en introduction. Une subordination qui, dans le milieu des transports, vaut à l’Agence le quolibet de « caisse enregistreuse ».
Nouveau départ pour le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) ?
Repris par la rue Cambon dans des termes plus choisis mais assertifs : « Simple caisse de financement permettant à celle-ci de contourner la législation budgétaire, elle doit être supprimée et ses crédits réintégrés au sein du budget général de l’État », recommandent les magistrats financiers. S’ils saluent « l’effort de rationalisation » entrepris par l’Etat « qui s’est traduit par la création du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) et la loi d’orientation des mobilités de 2019, l’État continue de prendre des engagements au coup par coup, sans se référer à une sélection et une hiérarchisation claire des projets et en reportant trop souvent la question du financement », critique la rue Cambon.
Elle préconise de réformer et de renforcer le COI en le dotant « des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, dont le suivi de l’application des décisions d’investissement ». Objectif : une programmation des dépenses d’infrastructures de transport, « plus précise, plus complète, assortie d’un financement identifié, centré notamment sur la régénération et la modernisation d’infrastructures désormais vieillissantes ».
David Valence, député Renaissance des Vosges qui a présidé le COI de 2021 à janvier dernier (il est candidat à sa reconduction) s’en félicite : « Le COI est une structure ad hoc, qui a déjà vu son champ de compétences élargi en 2021, mais qui n’a pas de moyens humains en conséquence. Nous avons produit trois rapports [le dernier en date sur les choix d’investissements de l’Etat pour les infrastructures de transport, avait conduit il y a un an l’ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, à promettre 100 milliards d’euros d’investissement sur 15 ans pour le secteur ferroviaire, ndlr]. Il milite pour la capacité d’autosaisine du COI sur des sujets comme l’avenir des concessions d’autoroutes, la transition écologique de la route et son coût ou encore l’évolution du versement mobilité pour financer les transports publics.
Bon camarade, le député dit ne pas comprendre ce que l’on reproche à l’AFITF : » Le fait qu’elle existe et qu’elle sécurise les dépenses d’infrastructures n’est pas une mince vertu », défend David Valence qui ne voit aucun inconvénient à faire coexister les deux structures. « La Cour des comptes reproche des choses à l’AFIT qui, en réalité, sont liées à l’absence de loi de programmation des infrastructures de transport », ajoute-t-il.
Alors, terminus pour l’AFIT France ? Le tout nouveau président, Franck Leroy, nommé non sans quelques péripéties (lire), appréciera… Et que fera de ces recommandations Patrice Vergriete qui a fait un passage éclair à la tête de l’Agence avant d’être nommé ministre du Logement, puis en février dernier, a pris le portefeuille des Transports ?
Nathalie Arensonas
Lire le rapport complet : ici