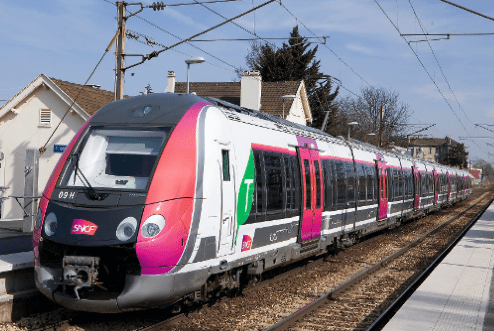« Ça tue plus de gens que le Covid » -– A La Défense, on y va plus en auto, plus à vélo, moins en métro – Robots livreurs objets de thèse – Le Mobiliscope à jour –Retour sur les espaces peu denses – En marche avec l’hydrogène – Leonard s’y met aussi – Et l’Ademe aide au développement.
« Ça tue plus de gens que la Covid »
Transition ou effondrement ? C’est la question que posait l’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris dans son université d’été, sur la question Urbanisme et santé publique… Une université d’été bien décalée dont, Covid oblige, la première séance s’est tenue en novembre 2020 et les trois suivantes en mars dernier. On ne donnera qu’un échantillon d’un ensemble riche : l’intervention de Frédéric Bonnet, Grand prix de l’urbanisme, qui veut « réinterroger la densité ». Connaissant bien les villes nordiques, se référant à Helsinki, ville polycentrique offrant des espaces de densité très riches, et de grands espaces de respiration, il invite à mieux se déplacer, moins se déplacer et à revoir pour cela la répartition des fonctions dans la ville. On en est très loin dit-il, regrettant une « tendance à faire encore de l’urbanisme du XXe siècle ». A mettre encore la circulation des voitures et les infrastructures routières au premier plan. Sauf exception comme à Paris, le vélo dans les villes françaises reste marginalisé. « Ça ne correspond pas aux mantras de la com, mais c’est ce qui se passe », regrette-t-il. Dernier signal d’alarme, l’étude d’une équipe de chercheurs des universités de Harvard, Birmingham, Leicester et Londres publiée le 9 février dans Environmental research. Elle évalue à 8,7 millions de morts en 2018 dans le monde les victimes de la pollution de l’air par les énergies fossiles, deux fois plus qu’on ne l’estimait jusqu’à présent. La nouvelle étude prenant en compte l’impact des particules fines : AVC, crises cardiaques et cancers.
En Europe, le nombre de victimes de la pollution atteignait alors 1,5 million. Or, constate Frédéric Bonnet, « ça tue beaucoup plus de gens que la Covid et on met moins de moyens en face ».
https://cutt.ly/bviosmB
A La Défense, on y va plus en auto, plus à vélo, moins en métro
12 % des personnes qui viennent travailler à La Défense ont récemment changé leur mode de déplacement et 13 % entendaient le faire prochainement. C’est ce qui ressort d’une enquête menée en décembre dernier par Paris La Défense avec l’Ieseg Conseil auprès de 5 500 personnes. 67 % de ceux qui avaient alors déjà changé leur mode de déplacement ont invoqué la crise sanitaire comme principale raison.
Les transports en commun restent le premier mode de déplacement. Et selon le communiqué, « 85 % des salariés interrogés se sentent en sécurité face au risque sanitaire dans les transports collectifs empruntés ». Reste que leur part baisse : 42 % des employés interrogés empruntent le RER, contre 47 % avant la crise, 40 % utilisent le métro contre 44 %. Les déplacements en bus sont stables, à 15 %. 23 % des salariés du quartier d’affaires empruntent désormais leur voiture, contre 16 % avant la crise sanitaire. Le vélo gagne aussi, mais moins : 13 % des travailleurs de Paris La Défense l’utilisent aujourd’hui contre 8 %. La marche affiche également une légère hausse, de 16 % à 18 %. 20 % des salariés interrogés souhaitent la mise en place de davantage d’infrastructures pour les modes de déplacement actifs tels que le vélo ou la trottinette.
https://cutt.ly/kvipAXR
Robots livreurs objets de thèse
La chaire Anthropolis, portée par l’IRT SystemX et Centrale Supélec, s’intéresse à l’utilisation de drones ou de robots pour les livraisons du dernier kilomètre : drones partant d’une base, drones partant d’un camion, ou robots pour le dernier kilomètre.
Une thèse de doctorat soutenue par Shoahua Yu a examiné différents cas d’usage entre un robot et son vaisseau mère. L’ensemble des travaux conduits « ont démontré que les livraisons basées sur des robots pourraient être rentables d’un point de vue opérationnel ».
Pour progresser, l’IRT SystemX ou la chaire Anthropolis pourront s’appuyer sur le projet européen Lead, lancé mi-2020, qui prévoit la création de jumeaux numériques de logistique urbaine à Madrid, La Haye, Budapest, Lyon, Oslo et Porto.
https://cutt.ly/nvipCG7
Le Mobiliscope à jour
Développé par une équipe du CNRS, en utilisant des données du Cerema, et avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, l’outil de géovisualisation Mobiliscope fait apparaître l’évolution de la composition sociale d’une ville ou d’un quartier heure par heure au cours de la journée, en se fondant — sauf pour l’Ile-de-France — sur les données d’enquêtes de déplacement. Sa nouvelle version intègre 49 agglomérations françaises et leur périphérie, soit 10 000 communes, couvrant les deux tiers de la population. Les enquêtes utilisées fournissent, non seulement des informations sociologiques (âge, sexe, CSP), mais aussi les motifs de déplacement et les modes de transport usités. Où il apparaît que la ségrégation sociale se reproduit au cours de la journée en dépit (ou justement à cause) des déplacements quotidiens…
Pourquoi quantifier et qualifier la population ? Cela peut aider à implanter un service ou un équipement au bon endroit et à l’ouvrir au bon moment. Ces questions, soulignent les concepteurs, « font écho aux politiques temporelles qu’un certain nombre de collectivités locales cherchent à mettre en place ». Cet instrument de mesure des inégalités qui pèsent sur la vie quotidienne, est en retour un instrument de suivi de l’efficacité des politiques publiques œuvrant pour une ville inclusive. Le Mobiliscope permet de connaître l’évolution sociospatiale d’une région (ou d’un secteur) et d’affiner au cours de la journée les diagnostics territoriaux, au-delà de seuls diagnostics basés sur la population résidente. A souligner : le Mobiliscope se veut « une alternative libre et gratuite aux services payants et propriétaires qui se développent actuellement autour de la quantification de la population présente au fil du temps ». Bien vu.
Retour sur les espaces peu denses
Olivier Jacquin, sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, est revenu fin mars sur son récent rapport parlementaire Mobilités dans les espaces peu denses en 2040 : un défi à relever dès aujourd’hui. Comment se déplacer demain à la campagne et réparer la fracture territoriale ? La question a pris une tournure cruciale avec la crise des Gilets jaunes.
Or, la rupture d’égalité entre les territoires reste d’actualité : toutes les communautés de communes sont en train de délibérer pour la prise de la compétence mobilités mais nombreuses sont celles qui n’ont pas les moyens de la mise en œuvre de cette compétence…
Olivier Jacquin a pu de nouveau faire part de son constat et de ses convictions : « Le constat est clair : la voiture est utilisée dans plus de 80 % des transports du quotidien, c’est pourquoi il convient de socialiser pour partie sa pratique en partageant sous différents modes son usage, qu’il s’agisse de transports à la demande, d’autopartage ou de la promesse des nouvelles pratiques du covoiturage courte distance dynamisées par le numérique. Enfin, les modes doux ne sont pas exclus à la campagne car près de la moitié des trajets du quotidien font moins de trois kilomètres ».
En marche avec l’hydrogène
Michel Delpon (député LREM de Dordogne) publie Hydrogène renouvelable, l’énergie verte du monde d’après, (Nombre7 Editions). Michel Delpon voit en l’hydrogène la clé de voûte de la transition énergétique. Car les énergies vertes, qui vont s’imposer face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources naturelles, sont produites de façon intermittente : pendant la journée pour l’énergie photovoltaïque, quand il y a du vent pour l’énergie éolienne. C’est ici qu’intervient l’hydrogène, excellent vecteur énergétique qui permet de stocker et transporter l’énergie qui sera utilisée plus tard. Pour Michel Delpon, l’hydrogène, longtemps cantonné à un usage industriel, s’apprête à transformer nos usages énergétiques.
Leonard s’y met aussi
Ce n’est pas Léonard qui dira le contraire. La plate-forme de prospective et d’innovation du groupe Vinci a entamé le 14 avril son nouveau cycle de conférences, La filière hydrogène, acteur-clé de la transition énergétique. Un cycle de six événements se proposant une fois par mois de « parcourir toute la chaîne de valeur de l’hydrogène, ses usages et ses dimensions technique et économique, en dressant l’état des lieux des applications existantes et de la recherche ».
Et l’Ademe aide au développement
S’agissant des applications, précisément, l’Ademe soutient la consolidation de la filière en accompagnant les déploiements d’écosystème hydrogène dans les territoires. L’Ademe le fait via un appel à projets, visant à faire émerger les infrastructures de production d’hydrogène bas carbone et renouvelable, avec des usages dans l’industrie et la mobilité. Une première clôture a eu lieu en décembre 2020 (présélection de sept dossiers), et une deuxième clôture le 16 mars. Celle-ci, selon l’Ademe, a « confirmé la dynamique très forte avec 32 projets candidats ». Les premiers appels à projets de l’Ademe sur la mobilité hydrogène, lancés en 2018, ont permis le déploiement de 19 écosystèmes.
https://cutt.ly/GvislEx
F. D.