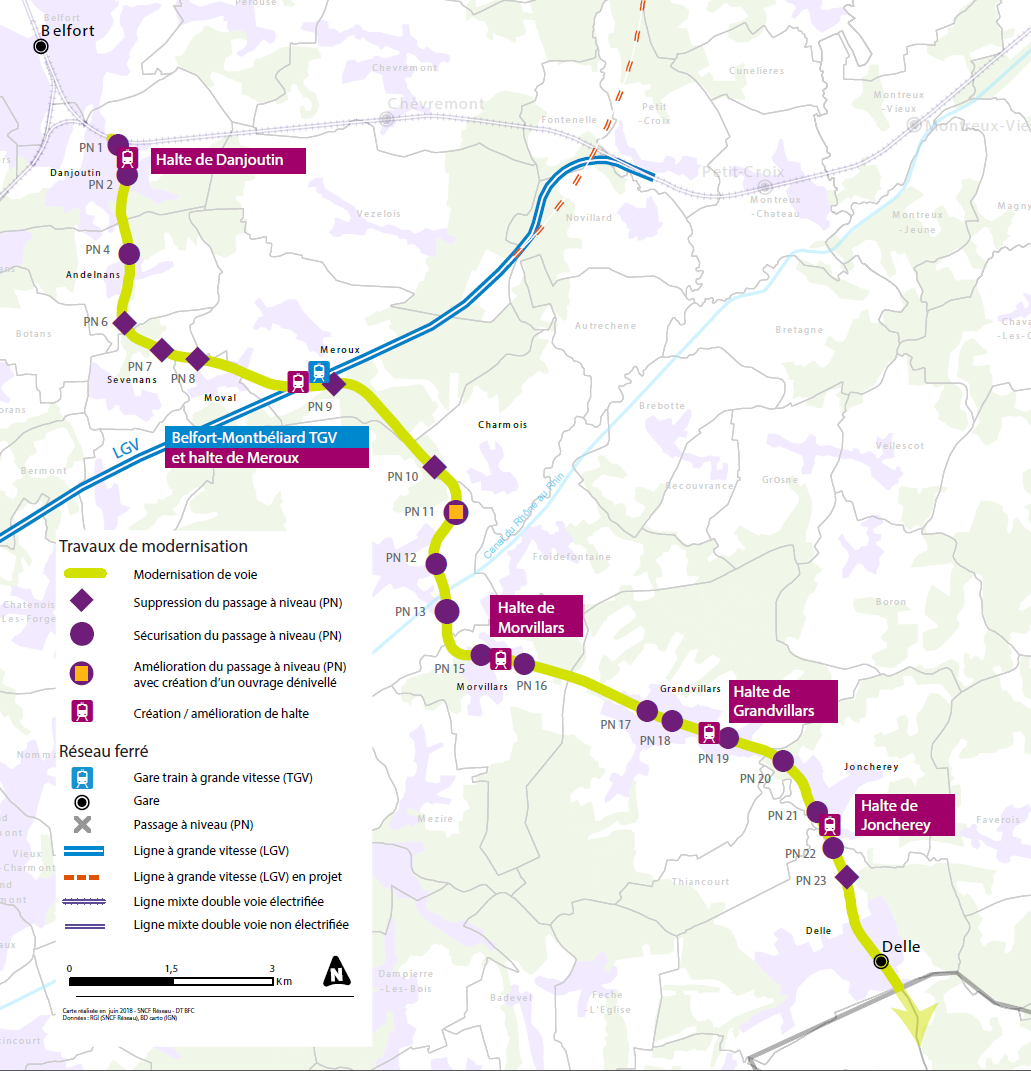Les 9 000 km de petites lignes du réseau vont être désormais traitées en trois blocs : l’un rejoint le réseau national, un bloc intermédiaire sera à responsabilités partagées, le troisième dépendra entièrement des régions. Même si l’Etat entend développer les petites lignes ferroviaires, tout porte à croire que les finances des régions vont être largement sollicitées…
En février 2018, la veille de l’examen par le Parlement du projet de loi sur le nouveau pacte ferroviaire, le rapport Spinetta avait recommandé la fermeture de près de 9 000 km de petites lignes (désormais appelées « ligne de desserte fine du territoire »). Certes, ce rapport avait aussi recommandé la réalisation d’un état des lieux complet de ces lignes avant toute fermeture. Mais c’est peu dire que cette précaution n’avait guère calmé les inquiétudes. Face au tollé, le Gouvernement s’était empressé de refuser la première recommandation, tout en retenant la seconde. Signe de la sensibilité du sujet et, peut-être, d’un désaccord persistant entre le ministère des Transports, conscient de l’état de ces lignes, et le ministère des Finances, soucieux d’orthodoxie budgétaire, la rédaction de cet audit1, confiée au préfet François Philizot, s’est avérée particulièrement laborieuse. Ainsi, il aura fallu attendre le 20 février 2020, date du premier comité interministériel aux ruralités, pour que ce fameux rapport2 sorte des limbes, et encore, dans une version très épurée ne comportant que dix pages… Si l’on ne peut que regretter l’opacité persistante entourant les travaux du préfet Philizot, son rapport « expurgé » a toutefois le mérite de jeter les bases d’une stratégie cohérente, que l’on peut résumer en quatre points principaux.
Premièrement, un ordre de grandeur des besoins de financement est enfin donné : sous réserve de complications techniques, ces besoins sont évalués à 7,6 milliards d’euros jusqu’en 2028.
Deuxièmement, en accord avec les régions, trois blocs de petites lignes sont distingués : un premier bloc, qui ne constitue qu’une « petite partie » des petites lignes, intégrera le réseau structurant3, dont les investissements de renouvellement seront financés à 100 % par SNCF Réseau ; un deuxième bloc, qui constitue « la majeure partie » des petites lignes, continuera d’être cofinancé par SNCF Réseau, l’Etat et les régions, étant précisé que la participation de l’Etat dépendra de l’importance des lignes ; un troisième bloc, qui regroupe les lignes dont le financement incombera à 100 % aux régions4.
Troisièmement, s’agissant du troisième bloc, la gestion de ces lignes sera transférée aux régions, en application de l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 20195. Les régions, en tant que futures gestionnaires, sont donc appelées à étudier toutes les possibilités : maintien du réseau existant, passage au train léger (moins onéreux tant à l’achat qu’en maintenance) ou passage au mode routier.
Quatrièmement, dans une allusion transparente à certaines pratiques passées de SNCF Réseau, dont les relations avec la plupart des régions étaient notoirement exécrables, le rapport Philizot exhorte à un pilotage du système ferroviaire véritablement partagé entre les trois acteurs principaux (Etat, SNCF Réseau, régions). Une fois ces bases posées, il convenait de déterminer la part contributive6 de SNCF Réseau, de l’Etat et des régions pour le deuxième bloc de lignes. S’agissant de SNCF Réseau, les choses paraissent claires : malgré une reprise d’une partie de sa dette par l’Etat, son endettement stratosphérique implique que sa part contributive dans le financement des petites lignes (8 %) reste inchangée, nonobstant l’intégration du premier bloc de lignes dans le réseau structurant. Quant à l’Etat et aux régions, le Gouvernement a annoncé, lors du comité interministériel du 20 février 2020, la négociation dans chaque région de plans d’actions déterminant le périmètre7 de chacun des trois blocs de lignes. Après quoi, la part contributive de chacun des trois acteurs concernés (Etat, SNCF Réseau et régions) sera négociée dans le cadre d’avenants aux contrats de plan Etat-Région 2015-2020, dont le volet « mobilités » sera prolongé jusqu’en 2022, en attendant la signature des prochains contrats de plan Etat-Région 2021-2027.
Cette stratégie pour les petites lignes appelle trois remarques
En premier lieu, il faut reconnaître que l’appréciation de la pertinence de la fermeture ou du maintien de ces petites lignes constitue une question fort délicate. Ainsi, d’un côté, comment ne pas être sensible aux arguments des disciples de l’orthodoxie budgétaire, lorsqu’ils déplorent le coût excessif de ces lignes (qui représentent 40 % du réseau) au regard du faible trafic qu’elles supportent ? En outre, l’argument écologique peut faire long feu pour les 85 % de petites lignes non électrifiées, surtout lorsqu’elles sont peu fréquentées8. Mais, d’un autre côté, apprécier l’utilité des petites lignes uniquement en fonction de critères économiques constituerait sans doute une erreur : d’autres critères peuvent tout aussi légitimement être retenus, tels la sécurité routière, l’environnement ou l’aménagement du territoire. A ce dernier égard, sans doute faut-il se garder de comparaisons hâtives avec certains pays voisins ayant drastiquement réduit le périmètre de leur réseau (Allemagne, Royaume-Uni ou Italie). En effet, la densité de la population en France étant moindre, la question de l’aménagement du territoire s’y pose de manière spécifique. Par ailleurs, la faible fréquentation de certaines lignes résulte non pas d’un tracé obsolète ou inadapté aux besoins de la population, mais d’un cercle vicieux en quatre étapes : le sous-investissement entraîne un fonctionnement erratique, qui entraîne une baisse de l’offre de transport, qui entraîne une baisse de la fréquentation. Ainsi, des petites lignes actuellement peu fréquentées9 pourraient retrouver une incontestable pertinence économique et sociale, pour peu que les travaux de maintenance nécessaires fussent exécutés et qu’une offre plus adaptée fût instaurée.
En d’autres termes, les petites lignes souffriraient davantage d’un manque d’offre pertinente que d’une faible demande10.
Ajoutons que l’équilibre économique dépend aussi de l’efficacité du prestataire, tant les surcoûts d’exploitation11 de SNCF Mobilités12 (devenue SNCF Voyageurs) laissent parfois songeurs, quand ils ne frisent pas la caricature. L’acuité de la question est telle que – singulier paradoxe – on en arrive à se demander si la concurrence (grâce à la baisse des coûts d’exploitation qu’elle induirait) ne pourrait pas revitaliser le secteur.
En définitive, si le maintien de petites lignes peut parfois relever davantage de l’acharnement thérapeutique que d’une saine médication (et, partant, d’un sage usage des deniers publics), il n’en demeure pas moins que l’approche strictement comptable, par son relatif simplisme, n’est rationnelle qu’en apparence.
En deuxième lieu, compte tenu de la diversité des situations, seule une approche casuistique semble pertinente, de sorte qu’il faut se féliciter, avec prudence, de la méthodologie du rapport Philizot (du moins telle qu’elle ressort des dix pages rendues publiques…). En effet, outre qu’elle propose un classement cohérent et consensuel de chaque ligne dans l’une des trois catégories précitées, cette méthodologie vise à déterminer, après négociations et pour chaque ligne, les financeurs et leurs parts contributives respectives. Le cas du train léger13 est à cet égard topique : seule une approche au cas par cas permettra de déterminer la pertinence de ce procédé vanté par le Gouvernement, mais non exempt de critiques. Ainsi est donc récusée (du moins en théorie) l’approche quelque peu technocratique du rapport Spinetta, qui poussait à « sabrer » dans les petites lignes, sans guère de nuance.
En troisième lieu, tout porte à croire que les finances des régions vont être fortement mises à contribution. Certes, l’Etat, directement ou par l’intermédiaire de SNCF Réseau, reste impliqué dans le financement des petites lignes, soit à 100 % pour les lignes du premier bloc, soit partiellement pour celles du deuxième bloc. Certes, le Gouvernement a affirmé que la crise sanitaire ne remettait pas en cause le programme de renouvellement des petites lignes14. Certes, le président de la République lui-même, dans son entretien télévisé du 14 juillet, a déclaré vouloir « redévelopper les petites lignes », tandis que le plan de relance du 3 septembre dernier prévoit pour celles-ci 300 millions d’euros supplémentaires.
Toutefois, outre que, comme vu précédemment, le troisième bloc sera à 100 % à la charge des régions, la détermination de la part contributive de l’Etat et des régions au titre du deuxième bloc demeurera l’objet d’intenses négociations, dont on pressent qu’elles aboutiront probablement à un effort financier substantiel de celles-ci15.
Ajoutons que le transfert de gestion signifie que l’AOT bénéficiaire16 devient gestionnaire d’infrastructure de plein exercice, donc en charge des nombreuses et épineuses questions techniques inhérentes à cette fonction, ce qui pourrait rebuter même les régions les mieux disposées. Ainsi, il conviendra d’attendre l’issue des négociations entre l’Etat et les régions, dans le cadre des plans d’actions et des futurs contrats de plan Etat-Régions 2021‑2027, afin de savoir si le rapport Philizot aura constitué, pour les petites lignes, un remède adéquat ou la cigarette du condamné.