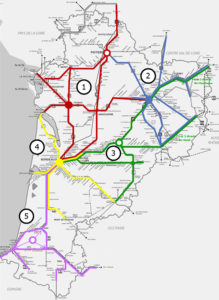Retoquées il y a tout juste un an, les règles de séparation comptable présentées à nouveau par SNCF Mobilités à l’Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) ont été plus chanceuses un an après. Dans un communiqué du 7 février 2019, le gendarme du rail annonce que cette fois, c’est validé.
Que s’est-il passé entre les deux versions et quels sont les enjeux de la séparation comptable de SNCF Mobilités, surtout dans la perspective de la future ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs ?
Comptes séparés pour chaque activité
Si la loi impose à l’opérateur ferroviaire historique un strict cloisonnement financier de ses activités sous monopole pour plus longtemps encore (Intercités, Transilien, TGV, TER) et celles qui sont déjà en concurrence (Fret SNCF, dont le fret routier opéré par Geodis), c’est pour prévenir les risques de discrimination pour l’accès au marché, de subvention croisée et de distorsion de concurrence. En particulier en ce qui concerne les frais financiers, l’impôt sur les sociétés et les charges de structure de SNCF Mobilités alloués à chacune des activités.
Pour que les barrières comptables soient bien étanches, SNCF Mobilités doit donc présenter des comptes séparés pour chacune de ses activités de transport de voyageurs, de transport de fret, mais aussi en tant que gestionnaire des gares de voyageurs, de centres de maintenance ferroviaire et de stations de combustible, toujours dans son giron. L’objectif est de pouvoir reconstituer les comptes de chaque activité comme s’il s’agissait d’activités autonomes. « La séparation comptable vise à favoriser les conditions d’un égal accès au marché, alors que domine un opérateur historique qui continue à exercer plusieurs activités, sous monopole et en concurrence, et permettre de s’assurer qu’aucun fonds public n’est transféré de l’une à l’autre », explique l’Arafer dans son dossier consacré au sujet sur son site Internet.
En 2018, l’autorité de régulation avait demandé à SNCF Mobilités de mieux séparer comptablement ses activités et de présenter de manière claire et détaillée les allocations au sein de l’Epic et les refacturations entre activités séparées, de manière à offrir une vision globale des flux financiers entre toutes ses activités. Visiblement, c’est chose faite puisque l’entreprise ferroviaire vient de recevoir le feu vert du régulateur. Elle a jusqu’au 30 juin 2019 pour lui transmettre ses comptes séparés pour l’exercice 2018.
Pour rappel, l’Arafer avait validé en 2014, non sans péripéties, le référentiel de séparation comptable de Gares & Connexions. Et celui de SNCF Infra la même année, avant que la branche ne soit intégrée à l’Epic SNCF Réseau, suite à la réforme ferroviaire d’août 2104.
Nathalie Arensonas