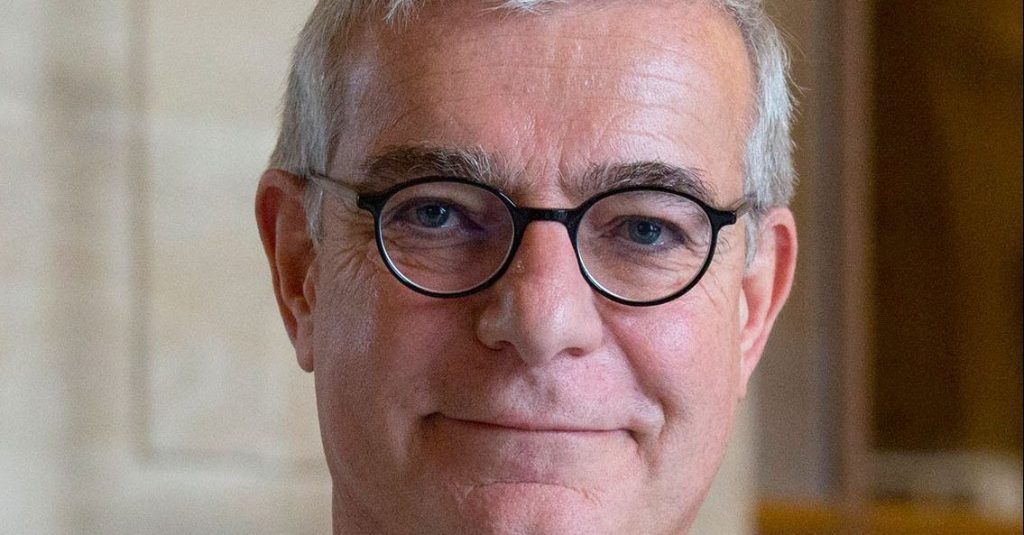L’ambiance se tend à la SNCF. Après un mouvement social le 21 juin en Ile-de-France, plusieurs appels à la grève se sont succédé à la SNCF : le premier, le 1er juillet, lancé par la CGT-Cheminots, puis il y a eu un préavis de grève pour les 3 et 4 juillet, en plein week-end de grands départs, chez l’opérateur Ouigo, déposé par trois autres syndicats mais finalement retiré après l’obtention notamment d’une prime pour les contrôleurs.
En interne, on estime que les salariés se montrent surtout inquiets par la perspective de l’ouverture à la concurrence qui va devenir effective très prochainement. La Région Sud en particulier devrait désigner, avant la fin de l’année, le ou les nouveaux opérateurs pour les deux premiers lots qu’elle ouvre à la concurrence. Si c’est la SNCF qui remporte un lot, elle devra alors créer une société dédiée pour exploiter les lignes. Comme elle devra le faire à chaque fois qu’elle remportera un contrat dans n’importe quelle région. C’est une des obligations imposées par les autorités organisatrices qui demandent de la transparence et estiment qu’elles seront alors mieux en mesure de contrôler l’ensemble des ressources affectées à l’exploitation des lignes.
Mais ces changements à venir créent des interrogations à l’intérieur de la SNCF. Les salariés se demandent quelles seront leurs conditions de travail au sein de ces nouvelles filiales (qui seront des SA, filiales de la SA SNCF Voyageurs), commente un dirigeant de l’entreprise. Selon lui, le salarié de la SNCF conservera tous ses avantages (salaire, parcours professionnel…) à une exception près : dans le cadre d’une entreprise dédiée, il verra forcément ses conditions de travail évoluer, l’organisation du travail ne pouvant plus être la même dans une petite entreprise.
Thomas Cavel, le secrétaire général de la CFDT-Cheminots, pointe toutefois un cadre social inachevé pour la branche. « Le calendrier de l’ouverture à la concurrence continue à être déroulé sans entraves, alors que le calendrier des négociations sociales, lui, n’avance pas », s’indigne-t-il. D’où un courrier tripartite signé par la CFDT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire et Sud Rail pour demander la relance du dialogue social au cours d’un rendez-vous au ministère qui devrait se tenir le 9 juillet.
Pour Didier Mathis, le secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire, la crise sanitaire a permis d’atténuer les tensions en interne. « Mais avec la reprise, les tensions pourraient remonter », estime-t-il. Le responsable syndical a envoyé fin juin une longue lettre à ce sujet à Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, s’inquiétant d’un climat social « délétère ». Il estime que le mode de représentation des salariés, avec les CSE qui fonctionnent de manière très hétérogène sur les territoires, sont « une des causes majeures de dégradation du climat social ». Selon lui, les signaux ne remontent plus aux organisations syndicales via les instances qui existaient jusqu’alors. « Tous les projets de réorganisations qui sont actuellement menés par les SA contribuent à désorienter les salariés du Groupe. Parce qu’il vient remettre en cause une organisation du travail pour la remplacer par une autre, un projet de réorganisation commence par être un projet de désorganisation », écrit-il. Ces restructurations organisationnelles sont « incessantes à la SNCF depuis 2002 », poursuit-il . Et d’enfoncer le clou : « (…) la montée des discours managériaux sur l’autonomie s’accompagne d’un développement encore plus important des processus totalement déshumanisés ». D’où la nécessité, affirme-t-il de remettre les organisations syndicales, qui jouent le rôle « d’amortisseur social », au centre du jeu.
« Jean-Pierre Farandou est conscient des tensions », affirme encore Didier Mathis, qui a été reçu par le patron de la SNCF suite à ce courrier. Les prochaines négociations salariales seront l’occasion, selon lui, d’envoyer un premier signal et « éviter d’aboutir à une huitième année sans hausse généralisée des salaires ». Toujours au chapitre salarial, la CFDT-Cheminots veut aussi obtenir « la reconnaissance de l’engagement » pour les cheminots qui ont constitué les salariés dits de la deuxième ligne durant la crise Covid.
Enfin, un autre sujet pourrait attiser les tensions : l’avenir des facilités de circulation, qui fait actuellement l’objet d’un audit gouvernemental dans le cadre de l’ouverture à la concurrence. Un dossier brûlant de plus dont se serait bien passée la direction qui cherche aujourd’hui avant tout à reconquérir les voyageurs. Et qui s’attend -pour le moment- à faire mieux cet été que l’été dernier au cours duquel la SNCF avait transporté 85 % de son trafic estival habituel.
Marie Hélène Poingt
La défenseure des droits critique les modalités d’achats de billets dans les petites gares
Saisie par des voyageurs, la Défenseure des droits a leur donné raison en constatant que « la transformation d’un nombre croissant de gares en Points d’Arrêt Non Gérés (PANG) est de nature à rendre plus difficile l’accès aux titres de transport ». Conséquence, les voyageurs ne peuvent pas toujours acheter de billets avant de monter dans le train et doivent s’acquitter d’une majoration tarifaire auprès du contrôleur à bord, ou pire encore, risquent de se faire verbaliser en cas de contrôle, a-t-elle considéré fin juin.
Selon elle, « l’absence d’alternative à l’achat de titres dématérialisés entraine donc des difficultés particulières pour les usagers résidant dans des zones blanches ou grises et paraît de nature à aggraver des inégalités territoriales préexistantes ».
La Défenseure des droits recommande donc notamment à la SNCF de modifier les modalités de régularisation des voyageurs empruntant des trains au départ de ces gares et de limiter la suppression des guichets dans ces gares et la transformation de ces gares en « PANG », en particulier sur le réseau TER. Sinon, ajoute-t-elle, il est nécessaire de mettre en place des distributeurs automatiques de titres de transport et de veiller à en assurer une maintenance permanente.
Des organisations syndicales ont apporté leur soutien à ces recommandations, notamment l’Unsa-Ferroviaire qui demande à la SNCF de privilégier les points de vente physique et de « redimensionner efficacement le réseau », tandis que la CFDT-Cheminots a rappelé qu’elle demande depuis plusieurs années la « réhumanisation » des gares et des trains.
Interrogé par BFM sur le sujet, Jean-Baptiste Djebbari a rappelé que le gouvernement allait consacrer sept milliards d’euros à la redynamisation des petites lignes et de plus de 1000 gares. Ce plan de relance pour les petites lignes a déjà été annoncé il y a deux ans. Il concerne les accords qui sont signés au fur et à mesure avec les régions pour la sauvegarde de leurs petites lignes. Selon une porte-parole, cette somme devrait être doublée puisqu’elle ne concerne que la part de l’Etat, les régions étant aussi appelées à mettre la main à la poche.
Ses services expliquent également que le ministre des Transports faisait allusion au programme 1001 gares lancé par Gares & Connexions pour revivifier des m2 carrés devenus vacants dans de petites gares en les ouvrant à des activités locales (commerçants, associations, tiers-lieues, acteurs culturels…) Sur les 607 gares recensées sur la plate-forme mise en place, 85 projets ont déjà été lancés et une trentaine est en cours de signature.