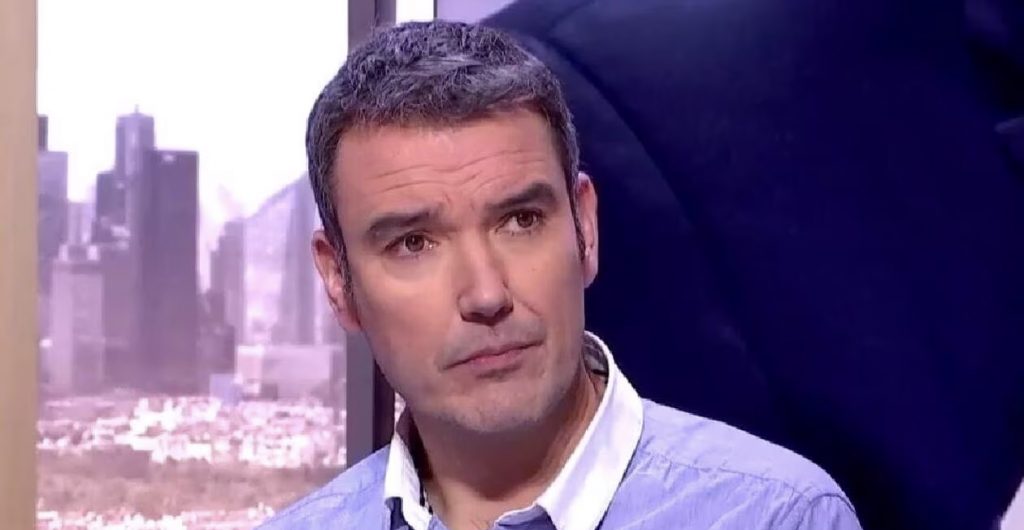Ambition France Transports a livré son verdict. Après deux mois et demi de travaux « à marche forcée », pour accoucher d’un modèle « pérenne pour les vingt prochaines années », Dominique Bussereau, son président, et Philippe Tabarot, ministre des Transports, ont livré le 9 juillet leurs conclusions. Elles constituent selon eux « une boussole lisible et utile pour le gouvernement » dont VRT détaille les principales annonces.
Une loi cadre, « historique pour les transports » selon Philippe Tabarot, sera soumis aux parlementaires en 2026, et donnera corps aux conclusions d’Ambition France Transports. Préparé dès la rentrée par les députés qui se porteront volontaires, le projet prendra en compte les nouveaux équilibres du système pour décider de grandes orientations. Un second texte, qui fera suite au premier, constituera lui « un jalon programmatique ». Il s’appuiera sur une revue des grands projets confiée au Conseil d’orientation des infrastructures, le COI, présidé par David Valence. Cette loi de programmation, attendue en 2026, fixera une trajectoire d’investissements précise. « Certains plans, pris par le passé, ont laissé un goût amer. Le nôtre constituera une très grande avancée », assure le ministre.
De nouveaux modes de concessions autoroutières vont être dessinés. La conférence a donc acté le principe des concessions, régulièrement mis en cause, mais « dans un cadre renouvelé ». Le périmètre géographique des nouveaux contrats sera plus restreint. Les conditions de leur rentabilité vont être revues. Leur durée sera plus courte et des clauses de revoyure tous les cinq ans vont être introduites. La puissance publique sera aussi associée au capital. En clair, l’Etat sera actionnaire des prochaines sociétés concessionnaires. Enfin, des recettes tirées des redevances, estimées à 2,5 milliards d’euros par an, seront fléchées « à 100% » dans les transports. « Nous prendrons tout le temps de préparation nécessaire à l’élaboration de ces nouveaux contrats », promet le ministre. Les actuels se termineront entre 2032 et 2036.
Le projet de loi de finances 2026 ne devrait reprendre aucune mesure issue des travaux de la conférence. « Nous ne pouvons pas nous dispenser de participer au redressement des comptes publics », a justifié le ministre. « Dans le combat que je mène pour le PLF actuel, je souhaite un financement supplémentaire sur nos routes, je ne peux pas dire à quelle hauteur, … Mais il faut arrêter cette dette grise », a pourtant insisté Philippe Tabarot. Il entend défendre une revalorisation des crédits dédiés à la régénération du réseau routier national dans le cadre du budget de l’Agence française des infrastructures de transport, l’Afitf, ainsi que l’abondement du programme Ponts. Pour rappel, l’an dernier, l’Etat avait ponctionné les recettes initialement fléchées aux infrastructures.
Le recours à des fonds privés va s’accélérer. Pour que les transports soient plus efficients, la mise en place de nouveaux projets de cofinancement devrait être encouragée, notamment dans le ferroviaire. Les auditions des représentants de différents fonds d’investissement, lors de la conférence, ont confirmé l’appétit de structures privées pour les partenariats publics privé, les PPP, dans le secteur des infrastructures.
Le principe d’une écotaxe est écarté. Les poids-lourds étrangers ne seront pas soumis à contribution à l’exception des régions frontalières qui en font la demande à l’image du Grand Est où le dispositif est testé.
La gratuité des tarifs doit être limitée. Avec un niveau de tarification parmi la plus faible d’Europe, les autorités organisatrices de mobilité (AOM) ont tendance à abuser des tarifs planchers, ont souligné les participants de la conférence. Si la liberté tarifaire accordée aux régions n’est pas remise en cause, la recommandation a été clairement faite aux AOM de mieux faire payer, le client. Les enjeux se chiffrent en milliards d’euros. « La gratuité n’est pas pertinente », a tranché Dominique Bussereau, président d’Ambition France Transports qui est favorable à plus de souplesse autour du dispositif Versement Mobilité. Cet appel à la revalorisation des tarifs épargne la SNCF « dont les billets sont déjà assez chers », estime l’ancien ministre.
Demi-victoire pour la SNCF. Jean-Pierre Farandou alerte depuis des mois sur la nécessité de trouver 1,5 milliard d’euros supplémentaire pour la régénération et la modernisation du réseau après 2027. Son groupe y contribue déjà via le « fonds de concours », caisse abondée par toutes ses entités. Le PDG reconduit obtient que la future loi cadre « grave dans le marbre », cette enveloppe d’1,5 milliard. Elle doit faire l’objet d’un triple effort : de la part de la SNCF, de la part du privé et de celle de l’Etat via de nouveaux leviers comme les certificats d’économie d’énergie (CEE).
Les services express régionaux métropolitains, appelés aussi RER métropolitains, portent « l’un des acquis majeurs de la conférence », s’est félicité Philippe Tabarot. Le dispositif, destiné à accélérer la mise en place d’offres de transport urbain commune à plusieurs territoires, « connait déjà un succès remarquable », selon le ministre. Ils vont bénéficier d’un geste de l’Etat (déjà annoncé) qui prendra en charge les études de préfiguration, ce qui est déjà le cas à 50% des sommes engagées. Pas sûr que les collectivités locales, qui attendaient beaucoup de la conférence, soient aussi enthousiastes sur ses conclusions que le ministre.