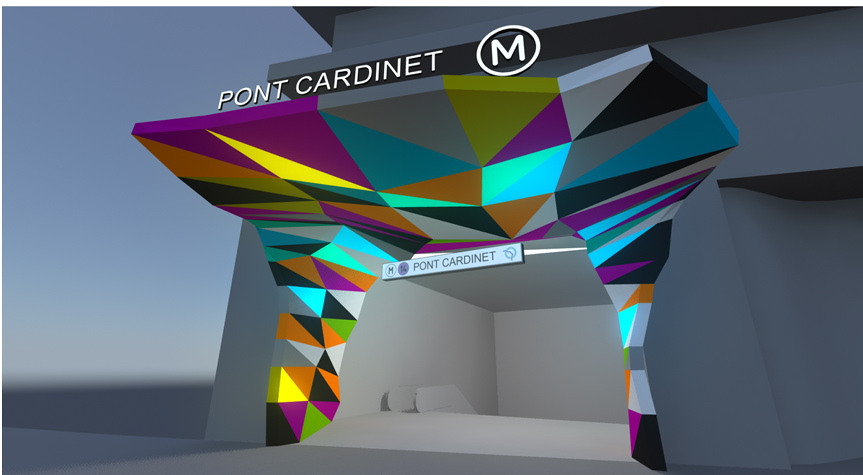Le poste de commande centralisé, ou PCC, de la ligne 1 du métro parisien est opérationnel depuis quelques mois. Mais seulement pour gérer de façon « traditionnelle » la ligne la plus chargée de la RATP. Il prendra tout son sens fin 2012, quand toutes les rames MP 05 seront déployées pour circuler en complète autonomie sur la ligne entièrement automatisée. Ce sera le cœur, voire la véritable tour de contrôle de la ligne 1 automatisée du métro parisien, fin 2012. Sans attendre cette échéance décisive, le poste de commande centralisé (PCC) est déjà discrètement en place depuis juin dernier et gère l’exploitation, encore « traditionnelle », des rames avec conducteurs sur la ligne la plus chargée du métro parisien – 725 000 voyageurs quotidiens et des « pics » à 900 000. Installé boulevard Bourdon, à proximité de la Bastille à Paris, le PCC nous a ouvert ses portes le temps d’une visite, avant de les refermer aussitôt pour peaufiner ses essais.
Car si sa mise en service est à coup sûr essentielle dans le processus d’automatisation de la ligne, ce n’est encore qu’une étape. La prochaine, ce devrait être en juin 2011, lorsque les premiers MP 05, ces nouvelles rames « dernier cri » sans conducteurs seront introduites dans le circuit.
Ce sera alors le démarrage d’une « période mixte » de quelques mois, durant laquelle le PCC devra orchestrer simultanément la circulation des rames MP 89 avec conducteurs et des rames MP 05, sans conducteurs. « Juxtaposer ainsi les deux systèmes, c’est un événement mondial », s’enthousiasme Pierre Mongin, patron de la RATP. Et dès que seize rames automatiques seront opérationnelles, il sera possible d’exploiter la ligne entièrement en automatique. Ce sera, dans un premier temps, seulement pendant les périodes nocturnes à faible trafic. Et c’est en décembre 2012, lorsque l’ensemble du parc de 49 nouvelles rames MP 05 de six voitures sera en circulation, que le PCC gérera la totalité du trafic en mode automatique, avec son système d’automatisation de l’exploitation des trains (SAET), soit selon l’appellation consacrée en « fonction navette ». Totalement opérationnel, il permettra alors le contrôle des fonctions de pilotage, l’optimisation de la marche des navettes ainsi que l’observation de « l’échange voyageurs » à l’ouverture et à la fermeture des portes palières, en relation avec le mouvement des navettes.
Sans attendre, le PCC intègre déjà, par anticipation, les fonctions du nouveau poste automatique. Depuis juin en effet, les équipements de pilotage automatique ont été installés, puis testés de nuit. On y trouve naturellement aussi les fonctions traditionnelles d’un PCC : le suivi des trains, la régulation du trafic et la gestion de l’énergie de traction, auxquelles sont ajoutées des fonctions d’aide à l’exploitation, de supervision et de régulation de la circulation des trains, avec des technologies et équipements de télécommunication de pointe.
Et sur le vaste tableau de commande optique (TCO) placé face aux « superviseurs d’exploitation », on observe bien sûr la représentation graphique de la ligne avec des traits verts, rouges et jaunes, permettant de suivre l’évolution des rames en circulation – jusqu’à 45 trains en heure de pointe –, indiquant la régulation du trafic, l’alimentation électrique, les divers raccordements avec les autres lignes de métro, les deux terminus…
Ce tableau possède également dans sa partie supérieure, et c’est novateur, des vidéos prises en direct qui couvriront à terme l’ensemble des 25 stations de la ligne par le biais de caméras orientables, voire « zénithales » lorsqu’il y a de larges courbes, comme à la station Bastille, avec la possibilité de zoomer. « Avec ce mur d’images, le voyageur est entré dans le poste de commande », commente Philippe Mancone, directeur de la ligne 1 du métro. « C’est la première fois qu’il se trouve physiquement au centre de la gestion de la ligne. On voit, en direct, sur les quais, l’impact physique lorsque se pose le moindre problème. Culturellement, c’est un changement fondamental pour la RATP. » Cela doit aider à adapter l’offre à la demande, introduire de nouvelles rames dans le circuit en fonction de ce qui se passe sur la ligne, qu’on voit en direct à la télé… Comme l’illustre Gérald Churchill, chef de projet de l’automatisation, « les fonctions des conducteurs ont d’une certaine façon été rapatriées au PCC. Pour bénéficier de la vision qu’il avait, voir ce qui se passe sur les quais, il fallait que les yeux du conducteur soient rapatriés au poste de commandement. »
Dans le processus d’automatisation en cours de la ligne, la mise en service de ce PCC d’un nouveau type est « un maillon majeur » pour un projet que Pierre Mongin, présente comme le « plus complexe et pointu du monde en technologie dans les transports urbains ». Sur cette ligne plus que centenaire, chargée tout au long de l’année, au tracé compliqué en certains secteurs, tel Bastille, l’automatisation doit apporter, comme le souligne Gérald Churchill, « davantage d’adaptabilité, le trafic pouvant être calé en fonction des événements ».
Concrètement, le système va permettre de concentrer davantage de trains aux heures de pointe, augmentant ainsi la capacité de production, avec la possibilité de faire se succéder les rames toutes les 85 secondes, contre 105 au minimum actuellement. Ceci tout en offrant une meilleure régularité, « un système beaucoup plus stable », en particulier grâce à l’installation, en cours, de façades de quais dans l’ensemble des stations.
La mise en place de cette automatisation représente d’autant plus un challenge technique qu’elle s’effectue sans interruption dite majeure de trafic, soit surtout les week-ends et sur des durées les plus limitées possible. Un récent sondage aurait d’ailleurs montré que ses interruptions sont bien « comprises » des voyageurs, lesquels estiment à une large majorité, à l’heure de tous les désagréments, que cela « va dans le bon sens pour moderniser le métro. »
.jpg)