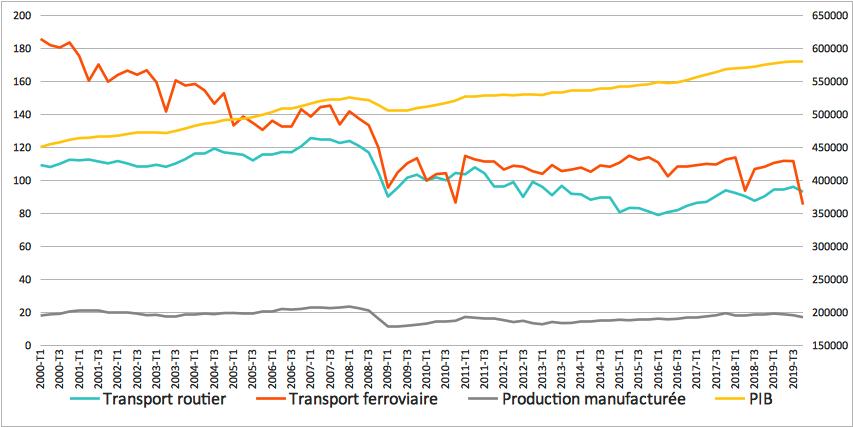Les petites lignes ferroviaires ont souffert d’un désinvestissement chronique, qui les laisse aujourd’hui dans un état de délabrement généralisé au grand dam des élus. Les petites lignes ferroviaires peuvent-elles connaître un renouveau ? Oui, ont répondu sept experts lors de la table ronde qui a précédé la remise des Grands Prix des Régions. Un élu s’est aussi invité au débat.
« Il y a 12 000 km de lignes UIC 7 à 9 en France, un quart dédié au fret et 9 200 km empruntées par des trains de voyageurs. Principalement des TER, mais aussi des trains nationaux, des lignes terminales TGV et du fret », détaille François Philizot, préfet interministériel, auteur d’un rapport sur le sujet. Ce réseau, qui a 38 ans d’âge moyen, est dégradé, obligeant souvent d’y réduire la vitesse des trains, et 40 % de ces lignes risquent une fermeture dans les 10 ans.
Pour l’éviter, un plan de régénération a été lancé en 2018. Il prévoit de réaliser 7,6 milliards d’investissements en 10 ans. « On est passé de 250 millions de travaux par an à 400, mais on est encore loin de ce qu’il faudrait réaliser pour parvenir à les régénérer en une décennie, car il reste 6,4 milliards de travaux à réaliser », souligne François Philizot. « Et comme ce réseau est composé à la fois de lignes s’inscrivant dans de grandes étoiles ferroviaires autour de grandes villes, tandis que d’autres sections sont des itinéraires interrégionaux unissant des grandes métropoles, et d’autres encore des sections terminales où circule un train par jour dans des zones peu denses, cela complique la façon de concevoir un grand soir des petites lignes. »
En effet, si en moyenne 400 000/voyageurs/an circulent sur ces lignes, la plus fréquentée en compte deux millions et la moins circulée 4 000. Le gouvernement prévoit de réintégrer dans le réseau structurant 1 000 km, soit 14 de ces lignes assurant une cohérence de grands itinéraires interrégionaux et une desserte d’itinéraires nationaux de premier rang. Ce qui veut dire que leur régénération incombera intégralement à SNCF Réseau. Sur les 6,4 milliards qui restent à engager, un milliard sera consacré à ces lignes.
Une deuxième catégorie de lignes porte sur 12 000 km identifiés. Il est prévu une prise de responsabilité par les Régions, partant du principe que ce réseau à un intérêt très local. « C’est un point de départ qui peut s’enrichir. Une fois que les Régions auront fait l’apprentissage de leurs nouvelles responsabilités, d’autres lignes pourront basculer dans leur giron et celui des exploitants qu’elles auront choisis », précise François Philizot.
Enfin, une troisième catégorie est envisagée, pour laquelle l’Etat propose de poursuivre le dispositif actuel : c’est-à-dire continuer à porter l’essentiel de la charge de la maintenance, soit un montant annuel de l’ordre de 700 millions par an financé à 85 % par l’Etat, le reste par les régions. « Sur la régénération, ce que nous proposons, c’est que les Régions restent financeurs principaux, à hauteur de 65 %, avec la possibilité de moduler la participation de l’Etat en fonction de l’intérêt des lignes. Nous avons signé des conventions avec deux régions et les discussions se poursuivent avec toutes les autres. Le plan de relance vient sécuriser la trajectoire financière et les investissements d’urgence avec une enveloppe qui permet de les traiter », conclut François Philizot.
S’inspirer du rapport du Cerema…
Pour exploiter les petites lignes, Vincent Pouyet, directeur général France du loueur de matériel ferroviaire, Alphatrains, préconise de s’inspirer du rapport Cerema. « Les lignes de dessertes fines souffrent plus souvent d’un déficit d’offre que de demande », rappelle-t-il en citant le rapport. « Cadencer l’offre diminue le coût unitaire et augmente le trafic ». Et de poursuivre : « un système frugal pour baisser les coûts peut être envisagé avec les équipements existants, une infrastructure légère et une signalisation simple. »
Selon Vincent Pouyet, le rapport propose de reprendre les recettes qui fonctionnent dans d’autres pays et à les adapter. « En Allemagne, cette recette consiste à offrir un cadencement d’au moins un train par heure, avec une exploitation locale par un exploitant dédié à une ligne ou quelques lignes, avec une flotte dédiée et du matériel utilisé à son maximum », constate le directeur d’Alphatrains qui propose de réévaluer la pertinence de certaines lignes françaises en difficulté, en appliquant cette méthode, pour voir quel résultat on obtient. Le rapport Cerema pointe aussi la manière dont l’infrastructure est tarifée. « Les Régions payent l’effort de régénération et le coût des péages dépend de l’utilisation. Le reste est pris en charge par l’Etat. Les coûts d’une infrastructure sont majoritairement fixes. » C’est pourquoi, Vincent Pouyet, suggère d’examiner le coût global d’une ligne pour évaluer sa pertinence. « Y faire circuler 2 ou 30 trains par jour, a peu d’impact. Si un acteur prenait la gouvernance de l’ensemble de ces coûts, les évaluations financières et techniques de ces lignes seraient totalement différentes », assure-t-il. Le sujet du matériel roulant vient loin après l’offre pour redynamiser une ligne. Parce que le matériel a un coût fixe, Vincent Pouyet encourage une utilisation maximale. « La désaffection des petites lignes vient d’une offre trop faible, alors que l’infrastructure et le matériel sont là », constate-t-il avant d’ajouter : « en France, on peut réaliser d’énormes économies sur l’achat et la rénovation, car nous ne retrouvons pas chez nous les économies constatées en Allemagne. »
…et des expériences menées à l’étranger
En 2019, Edouard Hénaut, directeur général de Transdev a réalisé une enquête mettant en évidence l’attachement des Français au réseau ferré, mais aussi au fait qu’ils veuillent plus de fréquences et une meilleure qualité de service. Les Français se prononcent pour la réouverture de lignes et déplorent les fermetures de gare de proximité, mais 70 % d’entre eux considèrent le train surtout utile pour des trajets longs.
Pour leur faire aimer le train du quotidien, Edouard Hénaut table sur l’ouverture à la concurrence, plébiscitée par 75 % des Français et met en avant son expérience acquise en Suède et en Allemagne. « En Allemagne, où la concurrence a été ouverte en 94, Transdev s’est attaché à avoir des lignes avec des équipes dédiées, une logique de territoire très ancrée, et une offre permettant d’intégrer toutes les stratégies intermodales de déplacement, parce que dans les espaces à faible densité, la voiture, le car, le vélo, ou le TAD peuvent être des solutions pour rejoindre un axe ferroviaire structurant », explique-t-il.
Pour réussir l‘intégration d’une ligne et la rendre attractive, Transdev mise sur le cadencement, sur l’intermodalité et sur une exploitation frugale donc moins coûteuse. « En 1996, dans la Banlieue de Stuttgart nous avons rouvert une ligne de 17 km fermée depuis 66. Nous avons proposé un service client amélioré, un train toutes les 30 minutes, une optimisation de la maintenance des voies, l’exploitation du service de transport et mis en place de l’intermodalité pour permettre le rabattement. Dès la première année, nous avons fait voyager 3 700 passagers par jour. Aujourd’hui, il y en a 10 000 ».
Fort de cette expérience, Transdev se prépare à répondre aux consultations des autorités organisatrices en France. Mais Edouard Hénaut rappelle que les Régions attendent le décret portant sur l’article 172 de la LOM et il regrette que le décret gares soit passé inaperçu. « Une gare ferroviaire c’est un pied dans la porte des réseaux locaux de transport collectif, mais leur gestion sera celle d’une structure ferroviaire, plus que d’un pôle intermodal car le projet de décret n’est pas de nature à apporter de la simplicité aux conditions d’accès aux gares ». Il le juge peu orthodoxe vis-à-vis du principe de séparation infrastructure et exploitation, et pas de nature à apporter de la transparence sur les conditions d’accès et l’impartialité. Selon lui, « Gares et connexions n’est pas la bonne entité. ».
Une politique de décentralisation
« La volonté politique de réinvestir la desserte fine des territoires est en cohérence avec la stratégie du président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou : une SNCF des territoires, acteur de la transition écologique, plus digitale et plus humaine », affirme Franck Lacroix, directeur général adjoint SNCF, en charge des territoires, également directeur des TER. Pour inventer la SNCF des territoires, l’organisation a été décentralisée. « Nous avons créé 45 directions de lignes réparties sur l’hexagone. » Et pour mieux répondre à la demande, la SNCF propose une ingénierie de l’offre. « Pour être capable de concevoir une offre répondant aux besoins de mobilité des territoires dans leur diversité, nos équipes développent depuis deux ans des solutions de rupture, et dont on compte se servir dans les appels d’offres. »
Pour relancer ces lignes, Franck Lacroix mise sur l’innovation technologique et souhaite mobiliser l’ensemble de la filière industrielle sur cet effort de recherche et d’innovation. « Il faut innover sur la substitution au diesel, avancer sur les batteries, l’hydrogène, le train hybride, le biogaz, sur l’automatisme, créer des navettes autonomes pour augmenter la fréquence. Il faut avoir une démarche modulaire, faire de l’expérimentation du design to cost pour aller vite, parce que les Régions nous le demandent. Il y a une opportunité à saisir tous ensemble, Etat, Régions, entreprises ferroviaires et constructeurs de matériel, toute une gamme à créer entre le train régional classique et la navette routière. Nous sommes prêts à créer une union industrielle pour mener ce projet. »
La ligne du Blanc-Argent, un modèle à suivre
Keolis travaille en complémentarité avec sa maison mère, la SNCF. Didier Cazelles, directeur général adjoint de la branche territoires de Keolis met en avant son expérience acquise en France et aux Pays-Bas. Et notamment le succès en Centre-Val de Loire, de la Compagnie du Blanc Argent, filiale de Keolis depuis 1999. « Cette société de 65 salariés exploite une ligne de 60 km assurant 225 000 voyages par an. On s’occupe de la gestion, du petit entretien de voie, de circulation, de l’entretien de l’infrastructure, de la maintenance du matériel, de la conduite et de la gestion des gares », décrit Didier Cazelles qui a la conviction que sur ces petites lignes, il faut de la rapidité, de la fréquence, du confort et une offre intermodale. Bref, grâce à une infrastructure de bonne qualité, il faut mettre au point un modèle d’exploitation allégé, adapté au cas par cas avec des standards de maintenance, permettant un coût optimisé pour la collectivité. « Sur la Compagnie du Blanc Argent, les conducteurs sont formés en quatre semaines, parce qu’on se limite aux stricts besoins. Chaque salarié est capable d’exercer deux à trois métiers : conduite de train, de car, agent de gare, accompagnement de train… ce qui permet de jouer à fonds la carte de la polyvalence sur l’exploitation opérationnelle, dans une logique économique, mais aussi de qualité de service. On n’a jamais supprimé un train pour un problème de conducteur », souligne Didier Cazelles. Mais, ajoute-t-il, « il faut articuler d’autres systèmes de mobilité de bout en bout autour de l’épine dorsale ferroviaire, pour créer une demande et du trafic ». Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, Keolis répondra aux appels d’offres, soit avec la SNCF, soit seule. Les deux entreprises ne seront jamais en concurrence. Ainsi, par exemple, sur les lots que Grand Est souhaite ouvrir à la concurrence, c’est ensemble qu’elles travaillent.
Régionéo, le nouveau venu
RATP Dev exploite depuis plus de 15 ans des services interurbains sur le territoire et ses équipes se préparent à l’ouverture à la concurrence depuis deux ans. Pour être plus efficace sur le transport ferroviaire et répondre aux appels d’offres pour les TER, RATP Dev s’est alliée avec Getlink, premier gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en France, qui exploite notamment le tunnel sous la Manche. Les deux entités viennent de créer Régionéo, un opérateur ferroviaire, dont Ronan Bois, a pris la présidence. « On regarde les différents appels d’offres et le Grand Est est le premier dossier sur lequel Régionéo s’est mobilisé. On veut apporter de l’excellence opérationnelle pour rétablir la qualité attendue par les passagers et briser la spirale négative qui a conduit à la fermeture de lignes. Il y a une dimension d’investissement non négligeable à la relance des petites lignes. On y travaille et on est à même d’apporter une solution et même de participer aux financements », assure celui qui est également président de RATP Dev Rail.
Régionéo cherche à repenser le service ferroviaire intégralement. « Nous voulons chercher de l’efficacité dans l’organisation de la production du train, travailler avec les Régions, comprendre ce qu’elles souhaitent, être un partenaire avant d’être un exploitant et faire du sur-mesure ». Le tout nouveau président assure que ses équipes se mettent en ordre de marche pour anticiper tout un tas de solutions en prenant le meilleur de RATP Dev et de Getlink pour proposer aux Régions de refaire du train « la colonne vertébrale d’un plan mobilité régional et d’y raccrocher tous les autres modes de transport ».
Prudence sur les débouchés d’un nouveau train
Si plusieurs intervenants ont évoqué la possibilité de recourir à des matériels roulants plus légers pour rouler sur les petites lignes, reprenant l’idée du gouvernement qui souhaite le lancement d’une filière industrielle autour du train léger, Pierre Michard, vice-président des Ventes et des services de Bombardier France et Benelux, se montre prudent. « Nous sommes partie prenante de ce sujet des petites lignes. Nous sommes partenaires des régions depuis 30 ans. Nous avons 60 % du parc TER. Mais sur la conception de nouveaux trains, on est prudent. Avant de partir tête baissée sur un concept de train léger, il faut savoir qu’il y a de très grandes diversités de besoins et qu’on risque de créer du matériel sans avoir un volume industriel suffisant. Je ne suis pas sûr qu’il soit pertinent de créer un train léger, car son développement demanderait beaucoup d’investissements, sans avoir l’assurance de trouver des débouchés suffisants ».
Reste que Bombardier veut être acteur du débat au travers de l’innovation. « On travaille au train autonome, qui peut faire partie du panel de solutions, au verdissement du parc sans avoir à électrifier des kilomètres de lignes. On regarde ce qui peut être fait sur la maximisation de l’actif en place. Il y a beaucoup de matériel dans les régions. Nous allons avoir 1 000 trains à rénover dans les 10 ans. Il faut regarder comment on peut les réadapter sur certains usages ». Bombardier veut aussi aller chercher des gains du côté de la maintenance, pour contribuer à rendre ces lignes plus dynamiques. « On a des solutions à proposer ». Et il ajoute : « C’est dans cette optique qu’on discute avec les différents opérateurs ».
Interrogation sur les capacités financières des régions
Un huitième intervenant s’est invité sur la scène, Franck Dhersin, présent dans la salle. Le vice-président chargé des Transports de la région Hauts-de-France s’est interrogé sur la capacité des régions à financer les petites lignes comme le prévoit le plan gouvernemental. « On demande aux Régions de récupérer une situation liée à 40 ans d’incurie des politiques de droite comme de gauche. La difficulté des petites lignes, ce n’est pas la faute de la SNCF. Avec quel argent voulez-vous qu’on relance ces lignes qui nécessitent un milliard d’investissement dans chaque région. L’aménagement du territoire, c’est le rôle de l’Etat. Pour les régions aussi la situation est très difficile financièrement. Ouvrir à la concurrence, d’accord, mais comment rentabiliser autant d’investissements ? » a-t-il lancé. Le débat n’est pas clos.
Valérie Chzravez