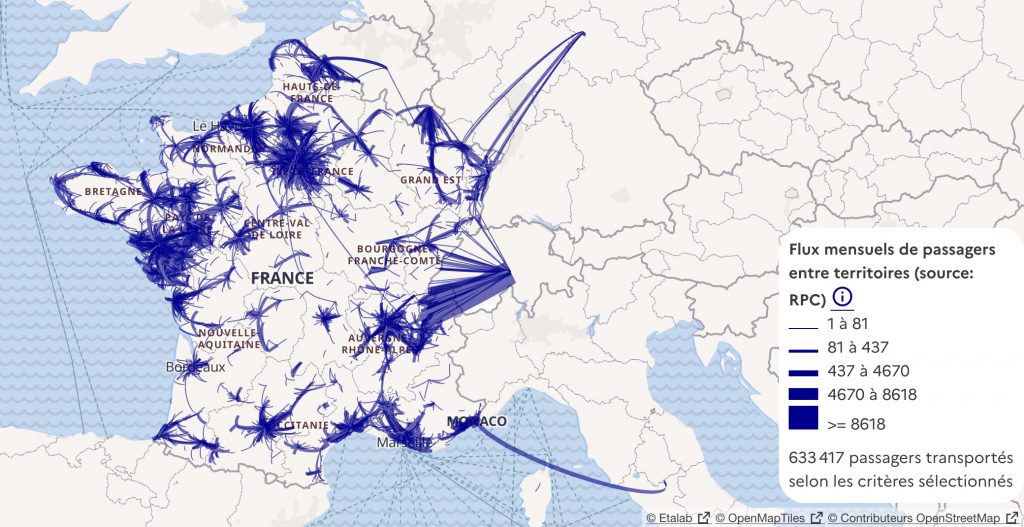Avec + 4°C d’ici à la fin du siècle (scénario envisagé par le Conseil national de la transition écologique), et alors que le Sud Est de la France vient de connaitre des journées caniculaires, le pays sera plus touché que prévu par le réchauffement climatique. Montées des eaux, inondations, chaleurs extrêmes, mouvements de terrain, incendies… Les événements météorologiques extrêmes risquent de se multiplier et de détruire bâtiments et infrastructures. A quel point les gares sont-elles exposées aux risques climatiques physiques ?
L’agence de notation extra-financière EthiFinance (elle certifie les financements obligataires à partir de critères environnementaux et sociaux) a établi un classement en mai 2023. Dans le top 10 des gares exposées au risque de vagues de chaleur, celles d’Arles, Tarascon, Beaucaire, Mont-de-Marsan, Avignon centre et TGV. Au risque de tempêtes, rafales de vent, celles de Brest, Cherbourg, Roscoff, Modane, Landerneau. À la hausse du niveau de la mer, celles du Havre, du Verdon, de Batz-sur-Mer. Au risque d’inondations fluviales, la gare de Paris-Austerlitz. L’exercice basé sur des modèles climatiques, indices météorologiques de flux, fichiers d’alertes européennes, fait sourire Raphaël Ménard, patron d’Arep, agence pluridisciplinaire et internationale d’architecture des gares, filiale de SNCF Gares & Connexions : « Les gares, ça parle à tout le monde, et c’est un bon coup de pub pour cette agence de notation et de conseil », balaie l’architecte-ingénieur qui affirme « avoir une longueur d’avance sur la cartographie des vulnérabilités ». Gares & Connexions a confié à son agence une mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage sur l’étude des vulnérabilités des gares au réchauffement climatique. Les résultats sont attendus fin 2023.
Sur demande de la Ville de Paris, Arep travaille déjà d’arrache-pied sur l’adaptation des six grandes gares parisiennes. Un « atlas bioclimatique » est sorti en début d’année pour dresser une trajectoire de la transition écologique d’ici à 2030, puis à 2050. Ce document d’une centaine de pages identifie les actions à mener pour réduire la consommation d’énergie – tout en produisant de l’énergie –, abaisser les émissions de CO2, retrouver de la biodiversité, et enfin, bannir les îlots de chaleur afin de diminuer les températures dans les gares et sur leurs parvis.
Comment ? Avec de la végétalisation, des ombrières, des matières et de la colorimétrie qui jouent sur le niveau d’albédo. C’est-à-dire le niveau de réflexion de la lumière, lequel dépend directement de la couleur et de la matière des surfaces. D’énormes travaux d’adaptation sont nécessaires dans les gares parisiennes. Ils sont documentés dans l’atlas : solarisation avec la pose de panneaux photovoltaïques, végétalisation et cool roofing (revêtements anti-chaleur) « permettent de gagner plusieurs degrés à la baisse. Le Musée national des Beaux-Arts d’Anvers l’a fait, nous en discutons avec la Ville de Paris, par exemple pour la gare du Nord », explique Hiba Debouk, directrice déléguée territoires chez Arep.
Schéma d’éclaircissement
Pour faire baisser la température des rails, l’Italie et la Belgique avaient misé sur la peinture blanche, avant d’abandonner l’idée car cela coûte cher (il faut repeindre souvent), et rend la détection des fissures difficile. Repeindre les toits des gares en blanc pour faire baisser la température ? Raphaël Ménard milite pour « un schéma d’éclaircissement » des toitures pour combattre la chaleur dans les bâtiments. Le principal frein est patrimonial et esthétique. Surtout pour les gares classées ou inscrites au titre des monuments historiques: la France en compte une cinquantaine et les Architectes des bâtiments de France (ABF) veillent au grain. Si la gare d’Angoulême, site patrimonial, accueille des panneaux photovoltaïques sur son toit, avec la bénédiction des ABF, accepteront-ils un jour que le toit d’une gare parisienne soit de couleur blanche ? « Il y a au moins 50 nuances de clarté », tempère Raphaël Ménard. « Nous avons demandé l’aide de la Ville de Paris pour être accompagnés auprès des ABF, mais franchement, c’est compliqué », témoigne Hiba Debouk.
Quid des verrières des grandes halles voyageurs (GHV) en cours de réfection dans les gares de Lyon, Saint-Lazare et Austerlitz ? Objets patrimoniaux par excellence, les GHV font aussi l’objet de frictions avec les gardiens du temple : « Ils comprennent bien qu’il y a un sujet réchauffement, témoigne Emilie Hergott, directrice de l’ingénierie chez Arep. Sur les surfaces vitrées, on peut jouer sur des verres à couche avec des facteurs solaires plus ou moins élevés qui ne laissent passer que 25 à 30% de l’énergie solaire. ou bien avec des films pris dans le feuilletage du verre. Mais pour les GHV des gares parisiennes, en train d’être rénovées, c’est trop tard, le coup est parti », explique-t-elle. Le temps des projets n’est pas celui de l’urgence climatique…
« Bien sûr, on peut ventiler, brumiser, mais ce n’est pas la panacée. On peut aussi traiter le confort des espaces d’attente avec des voiles d’ombrage et du mobilier dont les matières libèrent un effet frais », détaille Emilie Hergott.
Quand la mer monte
Contre la montée des eaux, Gares & Connexions ne peut que garantir la poursuite des opérations ferroviaires : « Dès 2015, nous avons travaillé sur le plan de continuité d’activité en cas d’inondations, et toutes les gares ont été passées au crible pour analyser l’inondabilité et leur résistance au risque, notamment dans les régions les plus exposées », explique Alain Guiraud, directeur du management des risques chez SNCF Réseau, auquel est rattaché le gestionnaire des gares. La gare d’Austerlitz rattrapée par les flots de la Seine, il n’y croit pas : « Il s’agirait d’une montée des eaux lente, le plan de continuité d’activité prévoit un scénario de 24 h ou 48 h pour une mise sous cocon des installations critiques inondables : les éléments électriques notamment, explique-t-il. Le système ferroviaire est nativement exposé au risque inondation puisque les villes et leurs gares sont souvent installées dans les anciens lits des fleuves », poursuit le risk manager.
Le nouveau sujet, c’est le gonflement, puis le retrait de l’argile après de forts épisodes pluvieux, de type cévenol, suivis de périodes de sécheresse. « Avec des risques d’affaissement : cela peut arriver sur des piles de ponts, mais nous commençons à étudier les fondations des gares », ajoute Alain Guiraud.
La foudre, les orages comme ceux que connaît la France depuis mai ? « C’est du grand classique, nous avons des paratonnerres, des parafoudres ». Mi-juillet, ils ont été particulièrement sollicités sur le front Est de l’Hexagone, balayé par une tempête orageuse.
Nathalie Arensonas
Retrouver notre dossier sur les gares dans le numéro de rentrée de Ville, Rail & Transports