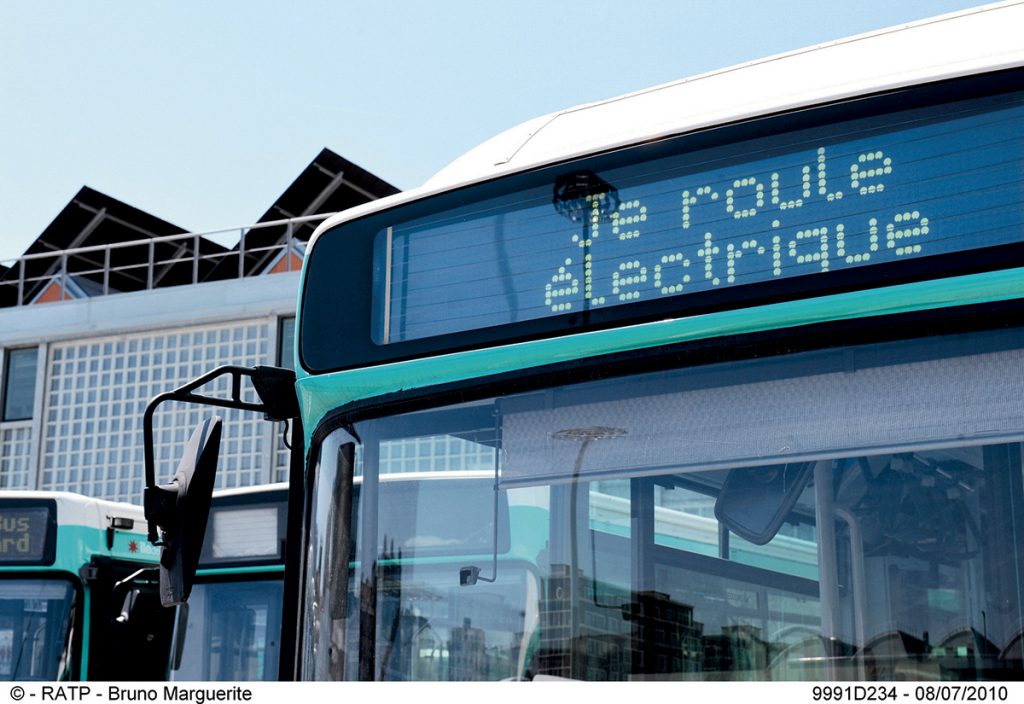Étape hautement symbolique dans le déroulement du programme Bus 2025 de la RATP, le millième autobus électrique a été livré à Point-du-Jour, huitième dépôt converti à cette énergie. Depuis 2015, les émissions de dioxyde de carbone des bus à Paris ont déjà diminué de moitié.
Les ambitieux objectifs du programme Bus 2025, consistant à décarboner tous les autobus exploités en Île-de-France par la RATP, sont en passe d’être atteints. C’est donc sur fond de satisfaction, et devant un parterre d’invités auxquels s’était jointe Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et d’IDFM, que la RATP a officiellement présenté son millième véhicule électrique, le 5 février dernier, au Centre Opérationnel Bus (COB) de Point-du-Jour, à Paris. Ce dernier venait, à son tour, d’être converti à cette énergie.
Une dizaine d’années plus tôt, la Régie s’était vu confier par Île-de-France Mobilités le pilotage de l’ensemble des travaux relatifs au programme Bus 2025. Mission désormais accomplie : « Ce programme devrait être entièrement soldé et terminé au plus tard pour 2026, a précisé Jean Castex, PDG du groupe RATP. J’ai tenu personnellement à ce que l’ouverture à la concurrence ne soit pas un prétexte pour le décaler ; l’intégralité des centres-bus sera bien convertie dans les temps impartis, y compris ceux qui pourraient, demain, être exploités par d’autres opérateurs ».
Pourtant, l’affaire n’aura pas été simple. « Nous avions des impératifs de sécurité, et il a fallu prendre toutes nos précautions, rappelle Jean Castex. Mais c’est le respect rigoureux de ces règles qui assure la crédibilité du service public. L’autre contrainte -et c’est là tout notre art- était d’arriver à faire cohabiter ces conversions avec la poursuite de l’exploitation. Pendant les travaux, la vente continue ! C’est grâce à la qualité du travail de nos agents que nous sommes parvenus, aujourd’hui, à un taux de réalisation de 70 %. Entre 2015 et maintenant, les émissions de CO2 de nos bus ont diminué de 55 %. Ainsi, la région parisienne est devenue la première agglomération en Europe, en termes de conversion de sa flotte de bus… ».
L’Île-de-France, championne d’Europe de la décarbonation des bus
Les travaux de la RATP s’inscrivent dans un vaste plan de la Région Île-de-France visant à réaliser la transition énergétique sur l’ensemble des autobus et autocars du réseau francilien. A ce titre, Île-de-France Mobilités doit investir, au total, 5,7 milliards d’euros. Ce montant se subdivise en 1,5 milliard pour la conversion des dépôts existants ou bien la construction de nouveaux établissements ; 1,5 milliard également pour l’achat des 3800 premiers véhicules électriques ou au biométhane et 2,7 milliards qui serviront au renouvellement des 7000 véhicules restants.
L’objectif est d’atteindre une flotte de bus 100 % propre, dès cette année dans les zones les plus denses et d’ici à 2029 sur le reste de l’Île-de-France. Pour l’heure, ce sont déjà plus de 4000 véhicules propres -électriques ou GNV/biométhane- qui circulent sur l’ensemble du territoire de la Région. « Nous sommes champions d’Europe dans la décarbonation des bus », assure Valérie Pécresse.
Une subvention européenne de 55 millions d’euros
Quant au programme Bus 2025 lui-même, engagé depuis maintenant une dizaine d’années, il a consisté à convertir progressivement l’ensemble des Centres Opérationnels Bus (COB) aujourd’hui exploités par la RATP pour le compte d’Île-de-France Mobilités. A raison de 50 % de ces dépôts à l’électrique et 50 % au biométhane.
Ce programme correspond, à lui seul, à un investissement de 600 millions d’euros pour les travaux d’infrastructure nécessaires dans les centres-bus, auxquels s’ajoute 1,2 milliard pour l’acquisition des nouveaux véhicules. Dans ce cadre, la Commission européenne a octroyé 55 millions d’euros de subventions à la RATP.
La Régie exploite actuellement en Ile-de-France 1000 bus électriques et 1320 bus au GNV/biométhane. En y ajoutant les hybrides, cela représente déjà 70 % du parc à disposition. Notons que, sur le créneau particulier des articulés de 18 mètres, l’hybridation n’aura pas vocation à disparaître rapidement au profit de l’électrique, dans la mesure où la RATP considère que l’autonomie des véhicules proposés sur le marché demeure encore insuffisamment maîtrisée, face aux performances spécifiquement requises pour l’exploitation du réseau parisien.
Huitième centre-bus de la RATP converti à l’électrique
Point-du-Jour est un Centre Opérationnel Bus de la RATP dont l’entrée principale se situe sur la place de la Porte de Saint-Cloud, dans le 16ème arrondissement parisien. Il avait été initialement construit en 1900, sous la forme d’un dépôt de tramways, pour le compte de la CGO (Compagnie Générale des Omnibus), et abrita les motrices de la ligne Concorde-Versailles. En 1934, ses installations se voient reconverties pour accueillir des autobus. Et dans les années 70, un important ensemble immobilier est édifié, entre la rue Michel-Ange et l’avenue de Versailles, qui vient enserrer les emprises, et recouvrir totalement l’ancienne cour du dépôt, où se trouvent l’accès principal et les postes de charge en carburant.
Aujourd’hui, Point-du-Jour gère trois lignes intra-muros (22 Gare Saint-Lazare – Porte de Saint-Cloud, 52 Opéra – Parc de Saint-Cloud, et 72 Gare de Lyon – Parc de Saint-Cloud), deux lignes de banlieue (171 Pont de Sèvres – Château de Versailles, et 260 Suzanne Lenglen – Boulogne Gambetta), ainsi que deux services urbains (Boulogne-Billancourt et Meudon). Ses installations s’étendent sur quelque 12000 m2. Il utilise un parc de 110 voitures standard de 12 m, dont 65 électriques, et 35 hybrides ou thermiques, auxquelles s’ajoutent les midibus affectés aux deux services urbains précités. Désormais regroupé avec le COB de Croix-Nivert (situé dans le 15ème arrondissement) pour former l’unité opérationnelle Paris-Sud-Ouest, ses personnels comptent 358 machinistes-receveurs, 15 techniciens de maintenance, et 11 encadrants. L’unité Paris-Sud-Ouest exploite, au total, 19 lignes, qui transportent, chaque année, plus de 40 millions de voyageurs.
Dans le cadre du programme Bus 2025, Point-du-Jour vient donc de vivre la troisième grande transformation de son histoire, avec sa conversion en centre-bus électrique. C’est le huitième Centre Opérationnel Bus a avoir ainsi été traité, après ceux de Lagny, Corentin, Les Lilas, Pleyel, Lebrun, Vitry et Malakoff. Et c’est justement Croix-Nivert qui sera le tout prochain dans la liste à se convertir à l’électrique, avec effet durant ce premier semestre.
Désormais, Point-du-Jour exploite un parc substantiel d’autobus Heuliez GX 337E livrés par le constructeur Iveco. Le millième bus électrique de la RATP est justement l’un d’eux, porteur du numéro de coquille 2267. Il a reçu, sous sa ceinture de caisse, un pelliculage de couleur vert pomme, recouvrant en partie la livrée Île-de-France Mobilités, avec le slogan « Bienvenue à bord du 1000ème bus 100 % électrique ». Cet autobus circulera, pour un mois, sur la ligne 52. Se serait-il fait un peu attendre ? « Nous adorons Iveco mais comme nous sommes son premier client, nous voudrions être livré à l’heure… », pointe Valérie Pécresse, Sans doute les difficultés d’approvisionnement que rencontrent actuellement tous les constructeurs…
« Nous nous sommes roulés par terre dans le bureau de Nicolas Hulot »
L’une des difficultés majeures rencontrées lors de ces conversions réside dans la situation géographique singulière de tels établissements, étroitement enclavés dans un tissu urbain particulièrement dense. En raison de la proximité des habitations, la sécurité y devient un enjeu prédominant. Par exemple, il aura fallu installer un système d’extinction automatique d’incendie, essentiellement constitué d’un réseau maillé de canalisations avec sprinklers, qui a été monté sous la charpente du hall de remisage. « Le vrai sujet, c’est bien la transformation des dépôts, insiste Valérie Pécresse. Dans le bureau de Nicolas Hulot, alors ministre de l’Environnement, nous nous sommes littéralement roulés par terre, avec Catherine Guillouard, l’ancienne présidente-directrice générale de la RATP, pour ne pas devoir faire une déclaration d’utilité publique sur chaque dépôt, comme initialement demandé. Sinon, nous aurions pris des années de retard ! « , raconte-t-elle. Finalement, après six mois de négociation avec le ministère, il a été convenu que ce serait une simple déclaration de travaux, mais en respectant, bien sûr, toutes les règles de sécurité. « Nous avons ainsi pu tenir les délais, si bien qu’à la fin de cette année, 100 % du parc de l’Île-de-France sera « zéro carbone » avec, à Paris, une majorité de bus électriques et quelques autres au biogaz et, en grande couronne, du biogaz et des biocarburants », souligne la patronne de la région.
Un important corollaire de ces aspects sécuritaires est le degré de perception des risques ou supposées nuisances de tels dépôts par les instances dirigeantes au niveau local. « Ce sont des infrastructures critiques.Aussi faut-il encore que les maires acceptent de nous céder, si nécessaire, des terrains ; j’ai encore des points de blocage pour certains dépôts en banlieue», rappelle encore Valérie Pécresse,
Un changement fort mal venu dans la réglementation européenne
Les travaux de conversion du COB de Point-du-Jour, entrepris dès 2021 par la RATP pour le compte d’Île-de-France Mobilités, se sont achevés en août 2024. Ils auront coûté 28,6 millions d’euros. Les raccordements « haute tension » ont été réalisés par Enedis, « compagnon de longue route, avec qui nous avons appris à travailler ensemble, dans cette grande aventure », selon les mots-mêmes de François Warnier de Wailly, directeur du programme Transition énergétique sur le réseau de surface pour le groupe RATP.
Quelque 50 collaborateurs d’Enedis ont directement participé à ces travaux. Une nouvelle distribution électrique alimente les 90 bornes de recharge, qui ont été installées dans le hall de remisage du dépôt.
Parallèlement, la RATP a converti, à ce jour, dix centres-bus au GNV/biométhane : Créteil, Bussy-Saint-Martin, Massy, Nanterre, Thiais, Aubervilliers, Flandre, Saint-Maur, Pavillons-sous-Bois et Fontenay. Mais un changement d’orientation au niveau européen pourrait bien remettre en question la pérennité de cette solution. « Arrêtons de changer tout le temps les réglementations ! On se tire une balle dans le pied, fustige Valérie Pécresse. La Région a payé pour l’installation de méthaniseurs sur son territoire, et voilà qu’on nous dit maintenant qu’on ne pourra plus acheter de bus au biogaz à partir de 2030 ! Le 100 % électrique n’est pas forcément la meilleure solution, et une telle situation est tout aussi pénible pour Iveco, qui a investi, de son côté, dans le biogaz ». Si une telle interdiction d’achat devait in fine s’imposer, elle mettrait clairement à mal, sur l’agglomération parisienne, le choix du mix énergétique initial…