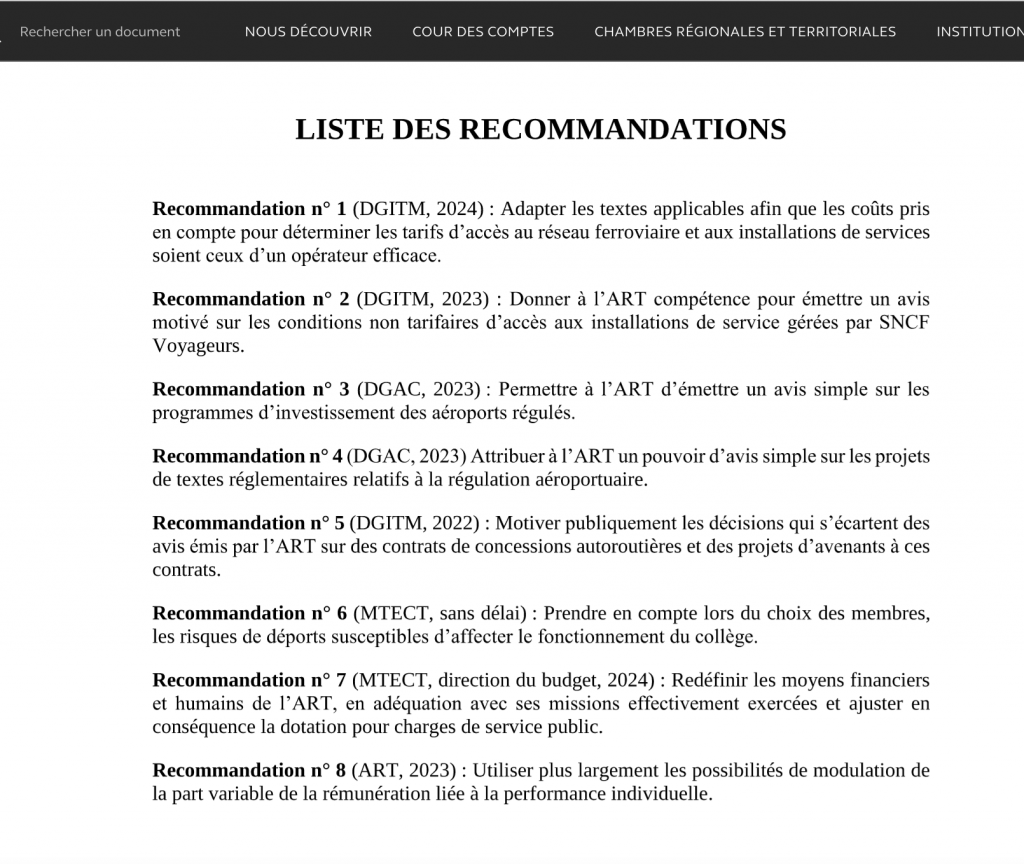« Pas de panique », c’est le mot d’ordre général. Emmanuel Macron l’a professé depuis Washington, où il se trouvait dimanche 4 décembre en visite d’État. Le lendemain, Xavier Piechaczyk, le patron de RTE, gestionnaire du réseau d’électricité, le répétait sur France Inter. Le gouvernement a annoncé que les risques de coupures de courant concernaient principalement les moments de pics de consommation, qui coïncident aux heures de pointe dans les transports : entre 8 et 13 heures, 18 et 20 heures. Les transporteurs planchent sur différents scénarios.
L’alimentation des caténaires SNCF maintenue
En cas de délestages cet hiver, l’approvisionnement du réseau ferroviaire est un sujet électrique. Mais impossible de connaitre les pistes de réflexion envisagées par le gouvernement, RTE et SNCF Réseau qui planchent actuellement sur le sujet. Ensemble et, sans qu’aucune information ne filtre, ils travaillent « à une stratégie nationale d’approvisionnement électrique du réseau ferroviaire. Des informations plus précises pourront être données dès lors que ce travail sera finalisé », se contentait de répondre le gestionnaire d’infrastructures ferroviaire en ce début décembre.
C’est en effet le gestionnaire des voies qui sera chargé d’informer les transporteurs (SNCF Voyageurs, Trenitalia, opérateurs de fret…) en cas de coupures temporaires.
Les sujets à régler sont multiples : l’alimentation en haute tension des caténaires SNCF sera maintenue, mais une partie du réseau en basse et moyenne tension, pourrait être affectée, comme les postes d’aiguillage, l’éclairage des quais, des gares, l’alimentation électrique des technicentres où sont entretenus les trains. Et les passages à niveau, épineuse question. Pour continuer à fonctionner, il faut que les batteries des barrières tiennent le coup plus de deux heures, durée des délestages évoquée par le gouvernement. Si les batteries sont déchargées, le passage à niveau se mettra, par sécurité, automatiquement en situation abaissée. Stoppant durablement la circulation automobile. Et des automobilistes impatients pourraient être tentés de forcer le passage…
Après le démenti du gouvernement en septembre dernier suite à l’annonce par nos confrères du Parisien que la SNCF travaillait, à la demande de l’exécutif, sur un plan de transport dégradé, autrement dit moins de trains et l’abaissement des vitesses, en cas de sévères pénuries d’électricité, la compagnie ferroviaire reste extrêmement prudente.
Le métro peu touché
À la RATP, on se contente de dire qu’en cas de mesures de délestage qui se traduiraient par de longues coupures d’électricité, le métro parisien devrait « être, a priori, peu impacté en raison d’une alimentation électrique en circuit fermé ». Concrètement, l’opérateur qui exploite un service d’importance essentiel dispose de sept postes haute tension directement alimentés par RTE, chargé du transport de l’électricité. En cas de délestage, c’est Enedis (chargé de la distribution d’électricité) qui gèrera les coupures, les rails du métro continueront donc d’être alimentés par les postes à haute tension, eux-mêmes alimentés par RTE.
« Ces infrastructures à haute tension offrent une alimentation très puissante et permet de distribuer l’électricité sur une grande de partie du réseau de métro », explique un expert chez EDF. « Toutefois la RATP pourrait être contrainte de mettre certains équipements des stations et des gares à l’arrêt : ascenseurs, escaliers mécaniques, distributeurs de billets, éclairage par exemple », précise le transporteur. Créant des perturbations certaines sur le réseau du métro.
En revanche, le réseau de tramways de la RATP et « quelques points » du réseau RER de la RATP [Paris intra-muros et petite couronne, ndlr] « pourraient être impactés », indique l’opérateur qui dit « travailler actuellement avec Enedis pour identifier les secteurs qui pourraient être impactés en cas de mesures de délestage ».
Quant aux autobus, dont une part conséquente roule au diesel (72 % des véhicules sont dans ce cas en France), ils ne devraient logiquement pas subir d’impact. De même que les bus électriques chargés avant de prendre la route.
La régie, qui a signé la charte Ecowatt, dit par ailleurs poursuivre ses efforts pour réduire sa consommation d’énergie.
Du côté de Keolis, on répondait début décembre que « les choses n’étaient pas complètement stabilisées » et que l’entreprise avait formulé plusieurs demandes auprès des préfets et des distributeurs d’électricité : pas de délestage pour les métros, qui doivent être considérés comme prioritaires, « en cohérence avec leur statut d’opérateur d’importance vitale » car « cela pourrait exposer, en cas de coupures inopinées, à des évacuations par les tunnels toujours problématiques ». Keolis exploite les métros de Lille, Lyon et Rennes.
Des bus de substitution sur les lignes de tramway
« Il n’y a pas de règle nationale, les mesures de délestage seront décidées au niveau préfectoral », explique Keolis. Le délestage éventuel pour des tramways serait opérationnellement moins critique, selon l’opérateur, « même si cela serait très perturbant pour les usagers ». La filiale de la SNCF qui exploite ceux de Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Nancy, Orléans, Strasbourg, Tours et le T9 en Ile-de-France, insiste sur la nécessité de disposer, au plus tard la veille, à 17 heures, d’une information précise sur les heures de délestage du lendemain. « Nous ne pouvons pas faire des annonces aux voyageurs sur la seule base d’un risque potentiel de délestage ».
Transdev qui exploite des réseaux de tramways dans plusieurs villes françaises (Nantes, Rouen, Saint-Etienne, Mulhouse, Grenoble, Avignon…) « se prépare à l’éventualité de coupures partielles ou totales de l’alimentation électrique. Des discussions sont en cours avec les autorités organisatrices de transport pour préparer des plans de transports adaptés (PTA), à l’instar d’autres situations qui génèrent des perturbations, comme les travaux par exemple », veut relativiser la filiale de la Caisse des Dépôts.
« Si les alertes sont lancées à J-3 comme le prévoit le dispositif Ecowatt, cela permettra aux réseaux d’organiser des PTA et d’informer les usagers des conséquences avant les coupures », explique Transdev. Les délestages pourraient se traduire, par des réductions de fréquences de passage des trams, pour s’adapter à la baisse de la puissance électrique disponible, la mise en place de services partiels ou bien de bus de substitution.
« En cas de coupure impactant les systèmes de sécurité, au premier desquels la radio, des interruptions temporaires de l’ensemble des services pourraient avoir lieu », prévient également Transdev.
Nathalie Arensonas