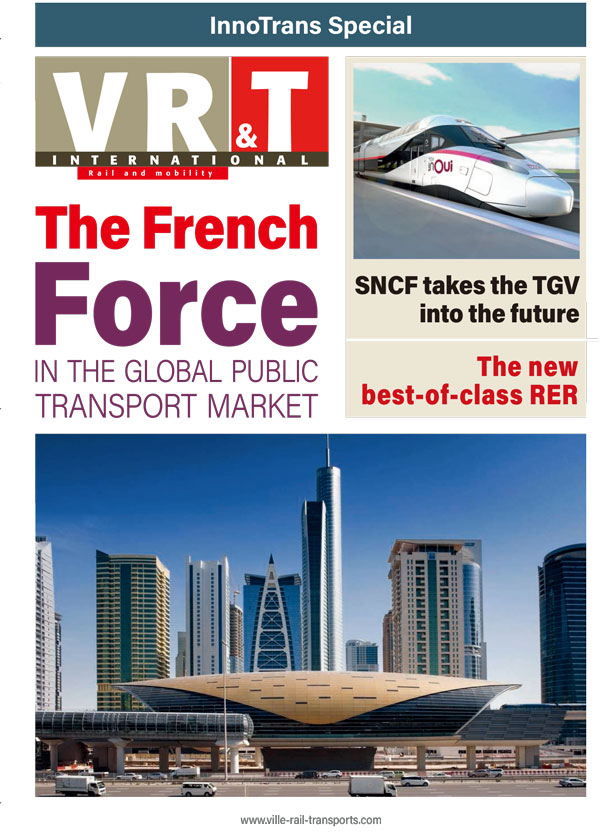-

« Trottinettes : toutes les villes connaissent les mêmes problèmes qu’à Paris »
Mis à jour le 20 septembre 2023
Quelques jours après la fin des trottinettes en libre-service à Paris, Julien Chamussy, cofondateur de Fluctuo, startup spécialisée dans l’analyse des données des services de mobilité partagée, livre...
-

Après la retraite des trottinettes à Paris, Lime mise tout sur ses vélos
Le 1er septembre prochain, plus une seule des 1 500 trottinettes en libre-service ne pourra théoriquement circuler dans les rues de Paris. Elles seront progressivement retirées de la...
-

Pour la première fois, l’opérateur de vélos et de trottinettes Lime assure être rentable
C'est une première depuis sa création en 2017 : Lime, la start-up californienne de vélos et trottinettes électriques en libre-service qui a, comme ses concurrents, connu des débuts...
-

La société Smoove-Zoov envisage de rapatrier sa production de cycles dans 12 à 18 mois
Mis à jour le 02 février 2022
Si la crise sanitaire a permis de booster l'utilisation du vélo, elle a aussi eu un effet révélateur sur le degré de dépendance des fabricants de vélos vis-à-vis...
-

Bientôt un parking à trottinettes tous les 150 mètres à Paris
Mis à jour le 18 octobre 2019
Très souvent interpellée sur les nuisances générées par l’afflux de trottinettes, la mairie de Paris a décidé de prendre le problème à bras-le-corps sans attendre la future loi...
-

Oribiky gonfle sa flotte de vélos électriques et partagés
Mis à jour le 07 mars 2019
Des vélos bleus, blancs, rouges en libre-service et à assistance électrique (VAE) ont fait discrètement leur apparition dans les rues de Paris et en première couronne fin 2018....

Recevez chaque mercredi
le sommaire de notre LETTRE CONFIDENTIELLE
et soyez informé des dernières actualités essentielles
de la mobilité et des transports.