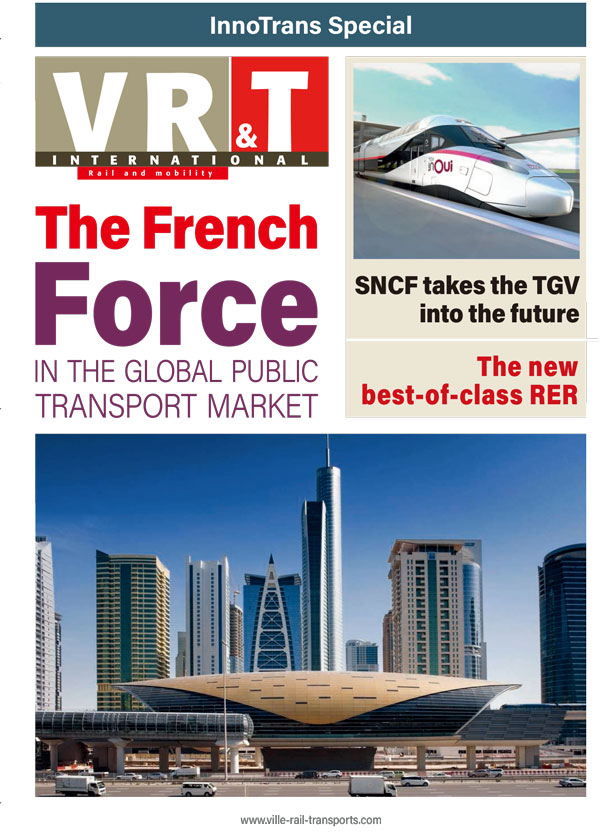-

La vitesse limitée à 30 km/h à Lille
Depuis le 19 août, hormis sur les grands boulevards, les véhicules ne doivent pas dépasser le 30 km/h dans le centre de Lille au lieu de 50 km/h...
-

Les utilitaires diesel bientôt interdits à Strasbourg
Les véhicules utilitaires diesel seront interdits au centre-ville de Strasbourg en 2021. Pour les camionnettes de livraison dépourvues de pastille Crit’Air ou correspondant à la catégorie 5 (véhicules...
-

Le premier radar piéton s’installe à La Grande-Motte
Le premier radar piéton a été installé cet été à La Grande-Motte, près de l’Office de tourisme. Equipé de cinq caméras (deux sur le piéton, deux sur le...
-

Zone à circulation restreinte : Paris accélère, la métropole s’apprête à démarrer
Mis à jour le 09 juin 2017
Six mois après l’interdiction de circuler aux véhicules non classés, c’est-à-dire ne bénéficiant d’aucune vignette Crit’Air, soit les voitures de plus de 20 ans, la Ville de Paris...
-

La nouvelle bataille du stationnement
Mis à jour le 17 juin 2017
La dépénalisation du stationnement programmée le 1er janvier prochain se prépare en ce moment. Les grandes métropoles qui ont fait le choix de déléguer le contrôle du stationnement payant...
-

Vélib’, un contrat à 500 millions d’euros
Mis à jour le 01 juin 2017
C’est le plus gros marché de vélos en libre service du monde si l’on excepte la Chine, indique Sébastien Fraisse, le directeur général adjoint d’Indigo en présentant le...

Recevez chaque mercredi
le sommaire de notre LETTRE CONFIDENTIELLE
et soyez informé des dernières actualités essentielles
de la mobilité et des transports.