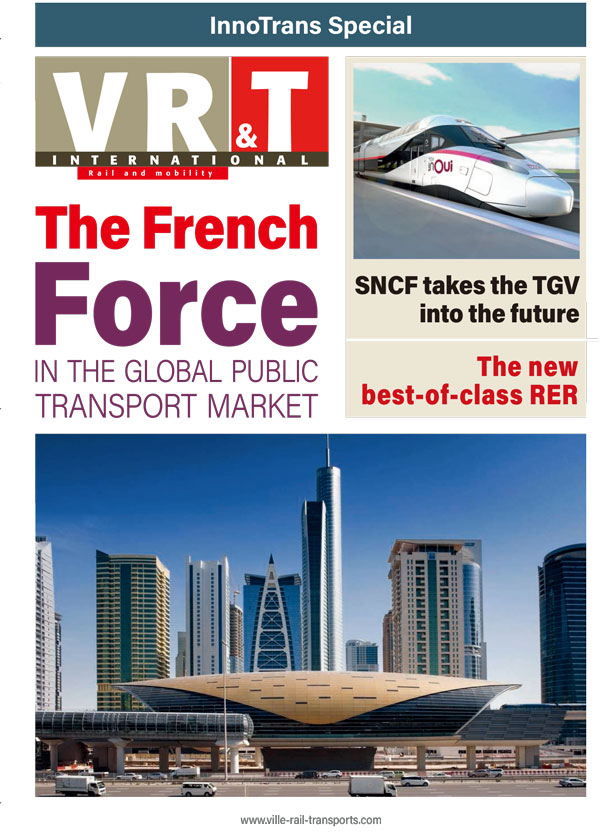-

Appel à manifestation d’intérêt pour une station de production d’hydrogène vert à Toulouse
Mis à jour le 07 janvier 2020
Toulouse Métropole et Tisséo Collectivités doivent lancer début 2020 un appel à manifestation d’intérêt relatif à la conception, la fourniture, l’installation, la maintenance et l’exploitation d’une station de...
-

Vélib’, un contrat à 500 millions d’euros
Mis à jour le 01 juin 2017
C’est le plus gros marché de vélos en libre service du monde si l’on excepte la Chine, indique Sébastien Fraisse, le directeur général adjoint d’Indigo en présentant le...
-
Le T6 prolongé de 2,6 km
Mis à jour le 23 mai 2017
Le prolongement du Tram 6 devait être prolongé de 2,6 km (dont 1,6 km en tunnel) jusqu'à Viroflay Rive Droite, le 28 mai... Le premier tronçon de cette...
-

Les opérations anti-fraude se multiplient à la SNCF
Mis à jour le 23 mai 2017
Scène inhabituelle le 3 novembre en gare de Paris-Nord où la SNCF a organisé ce qui serait sa plus grosse opération de lutte anti-fraude : près de 500...
-

Transports : les usagers veulent d’abord une baisse des prix
Mis à jour le 23 mai 2017
La baisse des prix est la principale attente des utilisateurs de transports en commun, selon l'enquête annuelle réalisée par l'association de consommateurs et usagers CLCV, publiée le 26...
-
A quoi ressembleront les stations du Grand Paris
Mis à jour le 23 mai 2017
La RATP a fait appel à trois cabinets d?architectes pour imaginer la station de métro de l?avenir. Résultats : trois visions radicalement distinctes, éloignées sans doute de ce...

Recevez chaque mercredi
le sommaire de notre LETTRE CONFIDENTIELLE
et soyez informé des dernières actualités essentielles
de la mobilité et des transports.